Pensées aléatoires : sur les épaules des géants
Quand on écrit, quand on est auteur, on construit sur les épaules des géants qui nous ont précédé, avec plus ou moins de bonheur ; on écrit avec leur regard perché, lui, sur notre épaule. Il découle que quand on écrit, quand on est auteur, il est indispensable d’être mégalomane – pour s’en foutre – ou inconscient – pour ne pas s’en rendre compte. Mais la littérature, l’art, n’est pas pour autant une hiérarchie. C’est une fraternité, une longue chaîne dont on a le droit de vénérer ou détester certains maillons à titre personnel, mais tous lui appartiennent, tous participent à ce grand dialogue, et il ne faut jamais l’oublier : on y a sa place, mais pas davantage, ni moins, non plus. Les jugements dits objectifs relèvent de l’histoire ou de l’université ; et même alors, ils relèvent de l’époque, de l’exposition, de l’étude qui fait mûrir la réflexion, d’étape en étape. À ce titre, la recherche aussi donne une main au passé et tend l’autre vers l’inconnu.
Quoi qu’il en soit, je ne suis ni l’histoire ni l’université. Je ne suis que moi, ce qui est à la fois immense et rien. Je vis avec mes opinions, et agis en conséquence aujourd’hui ; quand il sera temps de rendre un jugement, je ne serai déjà plus là, mais ailleurs à faire autre chose, avec erreur ou bonheur. C’est une des différences entre le critique public et l’artiste. Que tous s’informent mutuellement, mais que tous évitent, peut-être, de prendre la place les uns des autres – y compris quand – et ce n’est nullement impossible ni rédhibitoire en soi – ils résident au sein de la même personne.

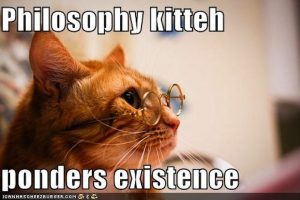
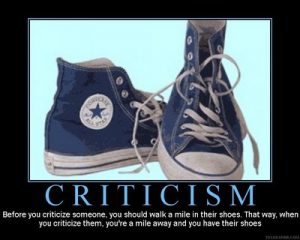


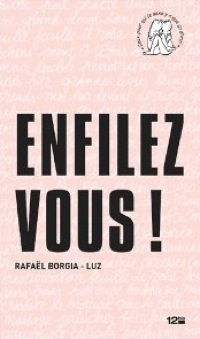

 Établissons, comme on dit chez les gens qui réfléchissent pour de vrai, une typologie des tropes présentés :
Établissons, comme on dit chez les gens qui réfléchissent pour de vrai, une typologie des tropes présentés : Reprenons au scénario, puisqu’il en faut un (hélas – on verra pourquoi). Baby Doll, une jeune fille bien comme il faut, se voit privée de son héritage à la mort de sa mère par un beau-père tyrannique. Afin de l’empêcher de parler, celui-ci la fait interner dans un asile où elle sera lobotomisée dans cinq jours. Cinq jours, c’est le temps à sa disposition pour orchestrer son évasion avec quatre complices. Elle se met à s’imaginer (à métaphoriser) son statut comme celui d’une danseuse de cabaret-slash-bordel, d’où elle doit s’évader également (ça valait bien la peine de changer de niveau de réalité). Sa façon de danser hypnotique, véritable combat pour la vie, se métaphorise à nouveau, cette fois en combats complètement délirants où elle forme, avec ses quatre copines, un commando d’élite spécialisé dans les missions extrêmes (c’est là que film part en live avec ses combats au katana contre des zombies allemands propulsés à la vapeur sur fond de bataille aérienne entre des méchas et des biplans).
Reprenons au scénario, puisqu’il en faut un (hélas – on verra pourquoi). Baby Doll, une jeune fille bien comme il faut, se voit privée de son héritage à la mort de sa mère par un beau-père tyrannique. Afin de l’empêcher de parler, celui-ci la fait interner dans un asile où elle sera lobotomisée dans cinq jours. Cinq jours, c’est le temps à sa disposition pour orchestrer son évasion avec quatre complices. Elle se met à s’imaginer (à métaphoriser) son statut comme celui d’une danseuse de cabaret-slash-bordel, d’où elle doit s’évader également (ça valait bien la peine de changer de niveau de réalité). Sa façon de danser hypnotique, véritable combat pour la vie, se métaphorise à nouveau, cette fois en combats complètement délirants où elle forme, avec ses quatre copines, un commando d’élite spécialisé dans les missions extrêmes (c’est là que film part en live avec ses combats au katana contre des zombies allemands propulsés à la vapeur sur fond de bataille aérienne entre des méchas et des biplans). Une énormité que le scénario et les effets, par ailleurs, ne savent pas gérer. Les deux véritables morceaux de bravoure du film – un combat au katana sur un lac gelé contre d’immenses statues et la bataille contre les zombies mentionnée plus haut – sont les deux premières incursions dans le délire total du film, qui, là, susciteront effectivement gloussements réjouis et un amusement véritable. Mais les suivantes peinent à les égaler, progressivement de moins en moins impressionnantes : en grillant toutes ses bonnes idées d’entrée, Sucker Punch s’essouffle, incapable de surenchérir sur les critères qu’il a lui-même fixés. Les effets sont-ils magnifiques ? Oui, absolument. Y a-t-il des cascades éblouissantes, des trouvailles de chorégraphie, des ralentis esthétiques ? Oui. Mais trop, au point de se noyer les uns dans les autres et de ne plus susciter la surprise
Une énormité que le scénario et les effets, par ailleurs, ne savent pas gérer. Les deux véritables morceaux de bravoure du film – un combat au katana sur un lac gelé contre d’immenses statues et la bataille contre les zombies mentionnée plus haut – sont les deux premières incursions dans le délire total du film, qui, là, susciteront effectivement gloussements réjouis et un amusement véritable. Mais les suivantes peinent à les égaler, progressivement de moins en moins impressionnantes : en grillant toutes ses bonnes idées d’entrée, Sucker Punch s’essouffle, incapable de surenchérir sur les critères qu’il a lui-même fixés. Les effets sont-ils magnifiques ? Oui, absolument. Y a-t-il des cascades éblouissantes, des trouvailles de chorégraphie, des ralentis esthétiques ? Oui. Mais trop, au point de se noyer les uns dans les autres et de ne plus susciter la surprise Que reste-t-il de Sucker Punch ? Principalement l’impression d’un film assis entre deux chaises, d’un divertissement qui aurait pu être absolument jouissif s’il n’avait voulu se donner un alibi d’intelligence, d’un traitement sur la perception de la réalité loupé à cause de tous ses chemins de traverse ; dans la même veine, il reste un scénario un peu globiboulbesque, tour à tour abscons et cousu de fil blanc. Une bande-originale excellente qui fait beaucoup pour porter un rythme imparfait (écoutable en ligne
Que reste-t-il de Sucker Punch ? Principalement l’impression d’un film assis entre deux chaises, d’un divertissement qui aurait pu être absolument jouissif s’il n’avait voulu se donner un alibi d’intelligence, d’un traitement sur la perception de la réalité loupé à cause de tous ses chemins de traverse ; dans la même veine, il reste un scénario un peu globiboulbesque, tour à tour abscons et cousu de fil blanc. Une bande-originale excellente qui fait beaucoup pour porter un rythme imparfait (écoutable en ligne 

 Encore un film dont la bande-annonce, l’affiche et le titre (sérieux, Dragons, moins original c’est pas possible) ne me faisaient absolument pas envie. Un village de gros bourrins vikings qui chassent le dragon, un ado malingre mais forcément plus malin que les autres, une jolie blonde qui méprise le héros, et puis une amitié inattendue se tisse entre l’homme et l’animal, ça sentait le téléphoné, le vu mille fois, le prétexte à cascades à coups d’images de synthèse bien léchées, le petit message gentillet à la fin.
Encore un film dont la bande-annonce, l’affiche et le titre (sérieux, Dragons, moins original c’est pas possible) ne me faisaient absolument pas envie. Un village de gros bourrins vikings qui chassent le dragon, un ado malingre mais forcément plus malin que les autres, une jolie blonde qui méprise le héros, et puis une amitié inattendue se tisse entre l’homme et l’animal, ça sentait le téléphoné, le vu mille fois, le prétexte à cascades à coups d’images de synthèse bien léchées, le petit message gentillet à la fin.
