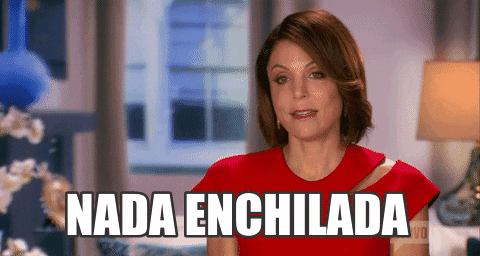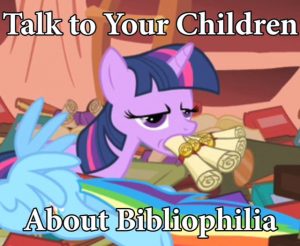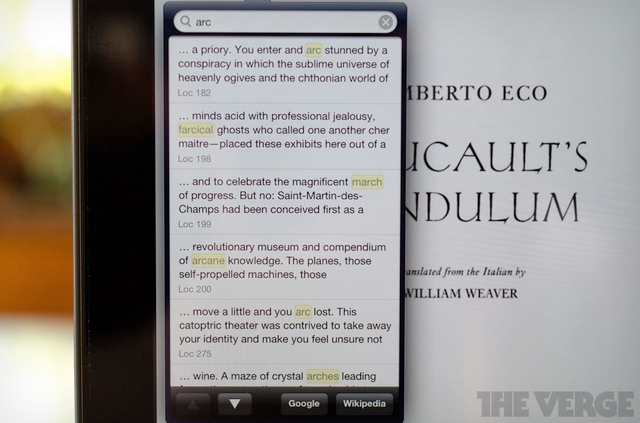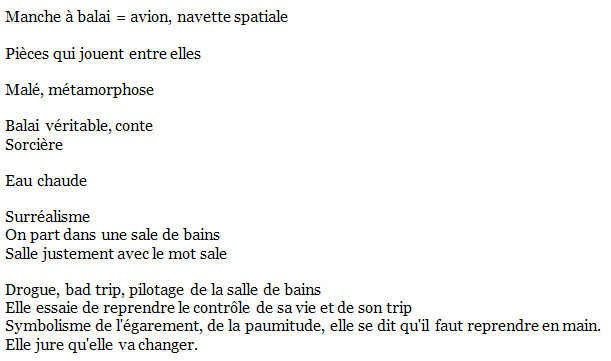Une liste de lecture pour Léviathan (“La Voie de la Main Gauche”)

J’en avais proposé une pour « Les Dieux sauvages », une liste de lecture (oui, bon, une playlist) d’inspirations musicales-slash-bande originale fantasmée si j’avais tout le budget de la défense américaine et que tout le monde veuille bien travailler avec moi, y compris des gens qui ne sont plus de ce monde, bref, vous voyez l’idée. Bien sûr, je suis peut-être le seul à y voir (entendre) ce que j’y entends (vois), mais avec l’existence des services de streaming, je trouve sympa de pouvoir partager les morceaux qui ont pu spécialement influencer la genèse d’un travail.
Il en existe à présent une pour tout l’univers de « La Voie de la Main Gauche » (la trilogie « Léviathan » et le recueil numérique Quatre voies de la Main Gauche). C’est écoutable librement sur Apple Music ou ci-dessous (ou directement sur mon profil, ici). Je les étoffe régulièrement.
<iframe allow="autoplay *; encrypted-media *;" frameborder="0" height="450" style="width:100%;max-width:660px;overflow:hidden;background:transparent;" sandbox="allow-forms allow-popups allow-same-origin allow-scripts allow-storage-access-by-user-activation allow-top-navigation-by-user-activation" src="https://embed.music.apple.com/fr/playlist/la-voie-de-la-main-gauche/pl.5090fecaad0042bfb539d327e6ebe0ac"></iframe>Rappelons aussi qu’il existe une véritable bande originale inspirée par la saga “Léviathan”, composée par Jérôme Marie et disponible en CD et en ligne ici !