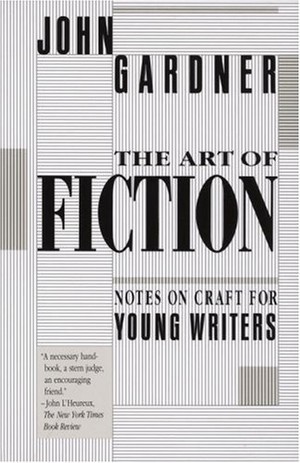Question : du pouvoir des noms
 Une question qu’on m’a présenté de visu lors d’un atelier d’écriture, cette fois ; j’avoue que je ne me l’étais jamais posée en ces termes, mais comme toujours, si une personne s’y trouve confronté, j’imagine qu’elle n’est pas la seule :
Une question qu’on m’a présenté de visu lors d’un atelier d’écriture, cette fois ; j’avoue que je ne me l’étais jamais posée en ces termes, mais comme toujours, si une personne s’y trouve confronté, j’imagine qu’elle n’est pas la seule :
Je me demandais comment on choisit le nom d’un personnage. Est-ce qu’il y a des règles ? Comment y arrive-t-on ?
Comme pour tout en art, il n’y a pas de règles gravées dans le marbre. En revanche, il y a un certain nombre de lignes directrices qui peuvent rendre la vie plus facile, à l’auteur comme au lecteur.
Je pense que la première et la plus importante – et là, oui, cela s’apparente peut-être à une règle – c’est d’avoir un nom qui « sonne » juste pour toi, l’auteur. Certains personnages se présentent à soi déjà complets, et ils ont fréquemment le nom qui leur va ; ou même, certains patronymes peuvent obséder l’esprit, exigeant qu’on raconte l’histoire de la personne qui va derrière. J’aurais tendance à recommander fermement de ne pas modifier ces noms-là : ils portent une charge émotionnelle inconsciente et une envie qu’il serait dommage d’assécher. Les noms sont, il me semble, quelque chose d’éminemment personnel en écriture ; leur sonorité et peut-être, même, le passé qui s’y trouve attaché porte des résonances insondables, même pour l’auteur (si, par exemple, tu as été harcelé en maternelle par un sale garnement appelé Innocent, cela ne t’évoquera pas un pape). Elizabeth George parle d’un cas où elle n’est arrivée à cerner l’un de ses personnages qu’après l’avoir changé de nom.
Néanmoins, il existe un certain nombre de critères plus objectifs. Si les noms portent des connotations pour l’auteur, il en est de même pour le lecteur – et avec les connotations viennent des attentes. Par exemple, un homme nommé Wilston Herbertshire Ruperford IV ne vient manifestement pas du même milieu social que Bob Lalose. Note ce que je viens de faire : ces noms sont visiblement outranciers et n’existent pas (on l’espère). Si je mets en scène Bob Lalose, on se doute aussitôt que l’on a affaire à une satire ou à une comédie. Mais je pourrais parfaitement faire de Bob Lalose un playboy avocat pilote de F1 à qui tout réussit parce que, obsédé par son ridicule état-civil, il ne supporte pas l’échec. Voilà qu’on pourrait basculer dans la chronique sociale. Si je présente un clochard nommé Wilston Herbertshire Ruperford IV (alors qu’on s’attendrait à un chevalier d’industrie), une foule de questions surgit : s’agit-il d’un riche héritier qui a tout perdu ? Est-ce un nom qu’il s’est donné tout seul – et est-il alors un peu cinglé ? Le nom peut évidemment être pris à contrepied pour surprendre le lecteur – comme dans l’exemple du sale garnement appelé Innocent. Bref, dans tous les cas, le nom n’est pas neutre : même s’il est quelconque, il révèle quelque chose au sujet de son porteur – un type a priori quelconque (mais peut-être appelé à un grand destin).
Le nom révèle beaucoup d’autres indices : l’origine culturelle (Jean-Alfred Mastard contre Daisuke Takashi), l’âge (en France, on imagine Jennifer plus jeune que Gertrude), même le caractère (Ophélia sonne plus romantique que Marcel). Ce n’est évidemment pas une science exacte et il ne faut surtout pas en faire un code (ce qui se verra tout de suite), mais, employés correctement, ces indices peuvent parachever l’image du personnage auprès du lecteur en lui fournissant une ancre cohérente.
Pour parvenir à ce résultat, je ne connais guère d’autre méthode que celle de l’essai / erreur : réfléchir à l’origine sociale et culturelle et jongler avec les prénoms et patronymes courants ; prendre une grande feuille blanche et isoler les syllabes qui séduisent l’oreille, puis tenter une myriade de variations autour jusqu’à parvenir au résultat qui « sonne » juste. Et, évidemment, s’autoriser à changer en cours de route si l’on perd cette « connexion » avec le personnage que l’on construit. Le lecteur ne verra peut-être pas quelle différence cela peut bien faire que l’héroïne s’applle Cailtyn ou Kathleen mais, dans l’écriture, cela peut bien signifier la différence entre une identification réussie et poussive.
Photo via le site de la ville de Saint Palais sur Mer.