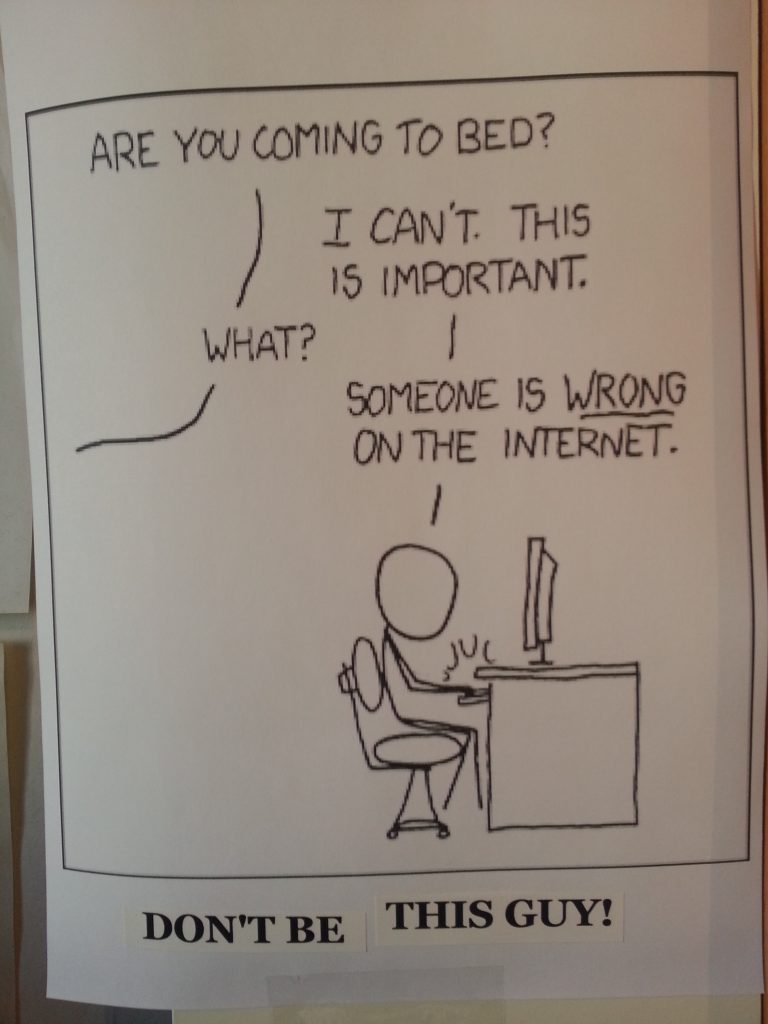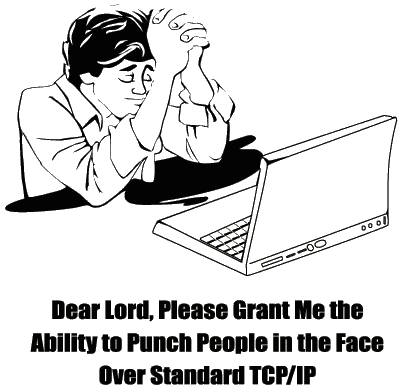Ignorer la précarité des auteurs conduira la langue française à disparaître

Image d’origine Gunnar Ries [CC BY-SA 2.0]
Rendons d’abord ce qui appartient à qui de droit à, heu… bref. Samantha Bailly (autrice et présidente de la Charte des auteurs jeunesse ainsi que de la Ligue des auteurs professionnels) disait l’autre jour :
Hier, j’ai annoncé que nombre de mes pairs arrêtaient leur métier : écriture, traduction, dessin. Pas le choix, avec le 1er janvier, l’insecurité globale face aux non réponses, beaucoup ont dû faire le choix d’abandonner leur métier. Peut-être de façon temporaire. Ou pas
— Samantha Bailly (@Samanthabailly) December 13, 2018
Voilà voilà.
Pour résumer mon avis en deux mots (ou plutôt 280 caractères) :
Sans déconner c’est aussi carrément le sort de la langue française qui se joue. Avec l’internationalisation, nous sommes de plus en plus nombreux à pouvoir écrire en anglais. Ce peut être un choix esthétique, ou une nécessité économique : le public y est mécaniquement plus vaste. https://t.co/oFkDkINf9q
— Lionel Davoust (@lioneldavoust) December 13, 2018
Au bout d’un moment, il y a une équation simple. Si tu peux vivre de ton métier créatif, c’est parce que deux conditions se rencontrent :
- Tu as assez de public pour générer du revenu
- Le système te laisse le faire, voire t’y aide, mais dans tous les cas ne te pète pas les genoux à coups de barre à mine
J’aime assez combien on se glorifie de la francophonie, mais hélas, trois fois hélas, voyagez un peu et constatez combien cette belle illusion ne tient absolument pas dans les domaines de la culture populaire (dont l’imaginaire représente une part écrasante – coucou Star Wars, Marvel, Game of Thrones, Harry Potter etc.). La culture dominante, comme presque toujours, est de langue anglaise, et là-dedans, américaine. Je m’esbaudissais cette année de trouver Maurice Druon dans une petite librairie australienne en rayon fantasy (yeah), mais dire qu’il fait figure d’exception est un aimable euphémisme.
Coucou les pouvoirs publics, j’ai une putain de révélation qui va vous asseoir, accrochez-vous : les effectifs du public francophone n’ont aucune mesure avec le public anglophone. Ouais, je sais, c’est puissant, mais j’ai fait des études, c’est pour ça. Un public plus vaste entraîne mécaniquement un marché plus vaste et/ou plus rentable, et aussi davantage de moyens (où sont le Doctor Who, le Game of Thrones de la télé française ?). Donc, tu veux protéger ton marché culturel, tu l’aides un peu, ne serait-ce qu’en ne le matraquant pas avec des cotisations qui doublent du jour au lendemain ou en le laissant dans l’expectative quant aux changements de régime fiscal.
Il y a un truc capital à piger aujourd’hui : la mondialisation va dans les deux sens. C’est-à-dire, on reçoit la culture anglophone, mais évidemment, le public va aussi vers elle. Et mécaniquement, après, à la louche, vingt ans d’accessibilité du cinéma et de la télé sur les réseaux pirates (soit une génération), on constate une aisance toujours plus importante du public français avec la langue anglaise. L’attitude des années 90 “jamais je regarderai un film avec des sous-titres, c’est trop chiant” est devenu aujourd’hui “jamais je regarderai un film doublé, c’est trop naze”.
Ce qui veut dire que, mécaniquement, on sera de plus en plus nombreux à pouvoir écrire en anglais. On peut faire ce choix pour des raisons esthétiques, mais on peut aussi le faire pour des raisons économiques, parce qu’on en a marre du marché de niche et qu’on a un peu d’ambition pour la portée de son art (c’est pas forcément un mal, l’ambition). Quand je me suis mis un peu à la musique à côté, la langue de ma communication ne s’est pas posée un seul instant : c’était l’anglais, parce que, tu fais de l’électro et tu veux communiquer en français, HAHAHA, non, sérieusement ?
Je vais te le dire très clairement, auguste lectorat, et avec des gros mots : cet état de choses, ça me fait chier. J’ai parfaitement conscience que le dire n’y changera rien. Mais j’entends constamment des jeunes, y compris dans les cursus de traduction, m’expliquer que, quand même, l’anglais, c’est plus cool, on peut dire plus de trucs, c’est plus explicite (hint : absolument pas, mais c’est un autre débat) et que le français c’est ringard. Ça n’est pas nouveau, mais si on sape et démotive méthodiquement les auteurs, c’est l’assurance progressive de voir toutes les forces vives lâcher le français pour aller vers les terres plus vertes de la langue anglaise. Or : ce phénomène est déjà en cours. Encore une fois, je ne dis pas que tous les auteurs français qui ont fait le choix d’écrire en anglais le font pour ces raisons ; ce peut aussi être un choix esthétique. Mais la raison économique existe aussi, déjà, maintenant, la possibilité est réelle, et si on n’agit pas – genre en foutant la paix aux auteurs, juste, pour commencer –, c’est l’assurance d’accélérer encore la fuite des cerveaux.
Or une langue sans auteurs, c’est une langue morte. Aussi simple que ça. Le Québec l’a parfaitement compris, par exemple, en subventionnant son industrie littéraire pour lui permettre de résister et de faire vivre sa langue face à l’anglais. Avec un très beau succès, dirais-je en plus.
Pour ma part, il y a vingt ans, je me suis posé la question de la langue dans laquelle j’écrirais, étant à peu près capable de faire les deux, et j’ai opté pour le français. Un choix que je refais à peu près tous les cinq ans, résolument, parce que le français est une langue puissante, nuancée, évocatrice, créative, et qu’on peut lui faire faire des trucs de malade ; parce que j’ai aussi envie de croire en un imaginaire de langue française fort et fier capable d’offrir autre chose que les importations américaines, que c’est le pays où je suis né, et que bon, tout simplement, j’ai envie de lui être fidèle – ainsi, et ça n’est pas anodin, qu’à toi, auguste lectorat, qui me suis fidèlement. Mais je t’avoue qu’il y a certains jours où c’est plus difficile que d’autres de résister à l’envie de faire un gros fuck – en bon anglais dans le texte – à tous ces énarques.
Allez, j’arrête la diatribe ici, mais il est probable que je l’étudie plus en détail ; gardons cela dans un coin de notre tête, qui est ronde, alors où se trouve le coin… ? Bref, demain, c’est le message annuel de déconnexion, mais les bisous n’attendent pas le nombre des heures, alors, déjà, par anticipation : bisous.


 Sur
Sur  Je reçois de loin en loin quelques questions sur le métier de la traduction, et je voudrais remercier Marielle Carosio, qui termine son parcours en métiers du livre, pour les siennes, excellentes et qui m’ont donné l’occasion de faire ce que j’avais envie de faire depuis un moment : proposer un petit tour d’horizon de là où j’en suis arrivé dans mes réflexions sur le métier sur son approche et sa technique, pour servir, eh bien, à qui cela pourra servir, surtout à un moment où je traduis de moins en moins et viens de mettre un terme à la majorité de mes interventions extérieures en M2 à la fac d’Angers (on peut pas tout faire, ma bonne dame. Je vous parle beaucoup sur ce blog, ma bonne dame, il faudra quand même que je vous rencontre un jour.)
Je reçois de loin en loin quelques questions sur le métier de la traduction, et je voudrais remercier Marielle Carosio, qui termine son parcours en métiers du livre, pour les siennes, excellentes et qui m’ont donné l’occasion de faire ce que j’avais envie de faire depuis un moment : proposer un petit tour d’horizon de là où j’en suis arrivé dans mes réflexions sur le métier sur son approche et sa technique, pour servir, eh bien, à qui cela pourra servir, surtout à un moment où je traduis de moins en moins et viens de mettre un terme à la majorité de mes interventions extérieures en M2 à la fac d’Angers (on peut pas tout faire, ma bonne dame. Je vous parle beaucoup sur ce blog, ma bonne dame, il faudra quand même que je vous rencontre un jour.)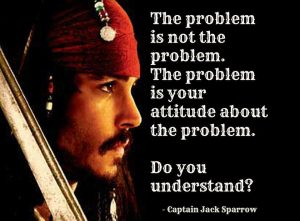 Viens, mon pirate. Viens, et assieds-toi, qu’on discute. Cela me démangeait depuis longtemps qu’on ait une petite conversation, toi et moi. C’est toujours un peu difficile de te parler, ou de parler de ce que tu représentes, sans susciter des levées de boucliers ou risquer de voir, pour citer Kipling, mes paroles “travesties par des gueux pour exciter des sots”, mais je crois avoir enfin compris, après notamment un séjour en monastère bouddhiste : il ne s’agit pas de t’agresser mais de te parler franchement, parce que l’expérience prouve que, finalement, nos métiers sont assez mal connus, et il y a peut-être, tout simplement, des choses que tu ignores.
Viens, mon pirate. Viens, et assieds-toi, qu’on discute. Cela me démangeait depuis longtemps qu’on ait une petite conversation, toi et moi. C’est toujours un peu difficile de te parler, ou de parler de ce que tu représentes, sans susciter des levées de boucliers ou risquer de voir, pour citer Kipling, mes paroles “travesties par des gueux pour exciter des sots”, mais je crois avoir enfin compris, après notamment un séjour en monastère bouddhiste : il ne s’agit pas de t’agresser mais de te parler franchement, parce que l’expérience prouve que, finalement, nos métiers sont assez mal connus, et il y a peut-être, tout simplement, des choses que tu ignores.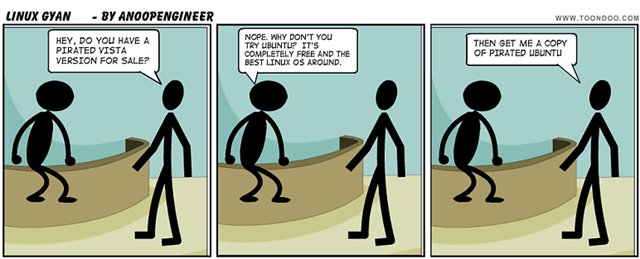

 Autrefois, quand le monde était jeune (le XXIe siècle devait à peine balbutier et l’iPhone n’était pas sorti, c’est vous dire), j’étais secrétaire du Prix Imaginales, que j’ai contribué à fonder. Quelques années plus tard, j’ai quitté mon poste et fus remplacé, si ma mémoire est bonne, par Stéphane Manfrédo.
Autrefois, quand le monde était jeune (le XXIe siècle devait à peine balbutier et l’iPhone n’était pas sorti, c’est vous dire), j’étais secrétaire du Prix Imaginales, que j’ai contribué à fonder. Quelques années plus tard, j’ai quitté mon poste et fus remplacé, si ma mémoire est bonne, par Stéphane Manfrédo.