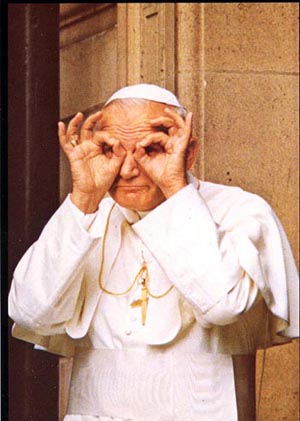Savoir ce pour quoi l’on est fait (comme écrire)
L’atelier à distance sur la création de monde imaginaire s’est récemment conclu, avec beaucoup de travail et de réflexions pour tout le monde, moi y compris (merci à tous les participants pour leur fidélité et leur dur labeur). Un certain nombre de questions ont été soulevées bien au-delà de la thématique, et parmi celles-là, l’une d’elles m’a semblé particulièrement importante et universelle, sur la vocation et le bien-fondé d’écrire, au point de mériter un développement à part entière (la “résistance” évoquée est en référence à La Guerre de l’Art, chroniqué ici, soit : cette force qui bizarrement nous détourne de toutes les tâches créatrices que nous sommes censés vouloir faire).
Quand on écrit que la résistance est souvent présente quand on veut se réaliser en tant qu’artiste, qu’en est-il de ce principe qui dit qu’on devrait faire ce pour quoi on est doué, ce qu’on fait facilement sans trop d’effort, en gros savoir où est notre talent ? (Un des 4 piliers de l’Ikigai). La résistance masque-t-elle le talent ? La résistance est-elle la preuve que l’activité ne doit pas être poursuivie selon ce principe ? Comment sais-tu que tu es fait pour écrire ?

De manière très frontale, je ne crois ni
- Au talent
- Ni à la vocation.
C’est-à-dire que je ne crois pas à des forces externes, “imposées” d’en-haut par une forme de prédestination, qui dicteraient ce qu’il est recommandé, ou, disons, possible de faire avec plus ou moins de facilité1. Je n’y crois pas de la manière suivante : je ne crois pas que ces forces, si elles existent, soient accessibles et donc opérantes pour former un parcours qui a du sens. Donc, autant les remiser avec le mystique – c’est comme l’idée de dieu : si il ou elle existe, okay, mais mon sentiment et ma quête vis-à-vis de ce concept, pour le bien que je peux en retirer, ne m’aidera pas à changer ma roue crevée ni à écrire mon livre (à part, précisément, par le bien que ça me fait d’y penser).
Le sens, le talent, la vocation, à la place, se recherchent (et, pour part, se décident).
Sur la question du talent. Les facilités existent peut-être cependant, mais elles ne servent à rien tant que l’on ne cherche pas à les mettre en application ; elles ne sont par ailleurs rien, à mon humble avis, devant le travail (Mozart a quand même dû apprendre le solfège). Or, comme le travail est la seule variable d’ajustement à notre disposition (voir l’épisode s03e20 de Procrastination, “Talent Vs. Travail”), que le talent existe peut-être, ou pas, mais qu’on ne l’influe pas, alors il vient que la question, pour moi, ne sert pas la pratique créatrice, et qu’il sera toujours plus pertinent de consacrer un éventuel temps perdu à s’interroger sur l’existence ou pas d’un talent à travailler dur, c’est-à-dire non pas se demander ce pour quoi l’on serait fait, mais à travailler ce que l’on veut faire.
Par rapport à ces facilités (ce “talent” ?), faisons également une distinction entre l’activité et l’ambition. À quarante balais, avec une protrusion discale et des épaules qui rouillent, c’est probablement foutu pour me lancer dans une carrière internationale d’haltérophilie, en revanche rien ne m’empêche, si je le souhaite, de pratiquer dans mon garage, dès lors que je suis réaliste vis-à-vis de mes ambitions. Heureusement, l’activité intellectuelle offre beaucoup moins de limitations (presque aucune, suis-je tenté de dire). Mais attention : tout le monde peut-il écrire ? Oui, bien sûr, et y trouver du plaisir et du sens, tout à fait. Tout le monde peut-il écrire quelque chose susceptible d’intéresser des lecteurs qui paieront pour – en gros, en faire une activité professionnelle ? Je n’en sais rien, mais je sais une chose : pour y parvenir, il faudra un certain investissement de travail (que, pour ma part, j’ai toujours pensé accessible à toutes et à tous). Bref, tout le monde peut dessiner des bonshommes bâton, mais on s’accordera pour dire que ça ne fera pas forcément le concept art du prochain Disney sans un boulot conséquent pour relier le départ à l’arrivée.
Sur l’idée de vocation. Beaucoup de travaux récents tendent à montrer que l’on n’est pas tant passionné par quelque chose dont l’on peut ensuite faire une activité, mais que l’on devient passionné par ce que l’on fait bien – soit, ce que l’on travaille.
En résumé, je ne sais pas que je suis fait pour écrire, parce que je ne sais pas si je suis fait pour quoi que ce soit dans l’absolu ; la question ne m’intéresse pas, ne m’intéresse seulement que ce que je veux faire, et ce pour quoi je suis prêt à me donner les moyens d’avancer (cela va ensemble ; le désir doit s’accompagner d’une bonne dose de volonté).
Il vient ici un point capital à préciser : je ne sais absolument pas si j’ai même raison de fonctionner ainsi. En revanche, je sais que cette façon d’agir m’offre de l’expérience, c’est-à-dire à l’enseignement retiré de l’action, ce qui est, en fin de compte, la seule chose que l’on puisse tester, observer, ressentir, et donc apprendre, pour évoluer. J’aime les trucs opérants qui m’enseignent des leçons parce que cela dessine l’étape suivante.
Soit :
- L’action commence toujours par une certaine mise en danger, suscitée par une sortie de la zone de confort ;
- L’enseignement est ce que l’on retire de l’action, informant les actions suivantes.
Or, l’enseignement est à la fois
- Externe (que faire pour mieux agir sur cette chose que je veux faire – qu’ai-je appris ?)
- Interne (que ressens-je à l’application de cette action ; en gros, a-t-elle du sens ?).
J’écris parce que je repère, dans cette activité pourtant difficile qui appelle très largement mes Résistances personnelles, une forme de sens, que je ne saurais pas définir, mais qui est, faute de mieux, important. C’est ainsi que je les surmonte, jour après jour. Peut-être s’effritera-t-il un jour ; si c’est le cas, il sera temps de passer à autre chose. Mais pour l’heure, je sens que l’écriture a encore bien des choses à m’apprendre, et m’offre l’occasion de partager toujours mieux un certain nombre de questions nécessaires. (J’insiste – de questions, pas de réponses.)
Pour moi, il y a deux types de difficultés :
- La difficulté dans la réalisation, parce que l’on s’attaque à quelque chose de complexe et de difficile, mais où le sens se trouve, est bonne. J’adhère à la vision nietzschéenne selon laquelle « rien de ce qui est important ne vient sans surmonter quelque chose » (Ainsi parlait Zarathoustra) ; je pense en outre que la difficulté est inhérente à la création car il s’agit, justement, de défricher des terrains inédits, en tout cas pour soi (… c’est bien pour cela que c’est de la création – si le territoire était cartographié, où serait la création ?)
- La difficulté viscérale, qui crie la révulsion, le hérissement, l’hostilité est mauvaise – elle est le signe d’une déconnexion entre, disons, l’aspiration personnelle et le moment. Cette révulsion (plutôt qu’une difficulté) est un indicateur précieux, tant dans la création (ce que je fais en ce moment ne correspond pas à mon intention, donc ça ne vaut rien) que dans l’activité (si écrire / peindre / jouer du violon ne m’apporte pas un sens ou une joie finaux, dans le sens de Marie Kondo2, en dépit de la difficulté, alors peut-être faut-il lâcher cette activité).
À chacun de savoir, de tester où il ou elle se trouve entre les deux ; mais cela, avancerais-je encore, ne se fait qu’au prix d’un peu d’effort et de persévérance, de confrontation au monde. Je pense fermement qu’agir, écrire, créer – et même, vivre – ne vient pas sans une forme d’effort et d’action.
En résumé : deux intellectuels assis vont toujours moins loin qu’un con qui marche. J’ignore si je suis intellectuel ou con donc, dans le doute, je marche.
- Pressfield va plus loin et dit même que la Résistance est un indicateur sûr de l’importance d’une tâche : qu’il faut aller là où elle est la plus forte. Je suis quand même partisan d’un certain principe de plaisir dans l’action ; voir plus bas. ↩
- Citer Nietzsche et Marie Kondo dans le même article : check. ↩