“Rémunérer les auteurs en festival ?” Table ronde aux Imaginales 2015
Ce débat des Imaginales 2015 portait sur la rémunération des auteurs en festivals littéraires, question déjà abordée ici dans cet article. Il faisait intervenir Jeanne-A Debats, Jean-Claude Dunyach, Alain Grousset et Lionel Davoust. Modération : Stéphanie Nicot.
La captation en a été réalisée par le site de référence ActuSF et est disponible en intégralité sur cette page. À noter qu’ActuSF a récemment consacré un copieux dossier à cette question.
Extrait vidéo :






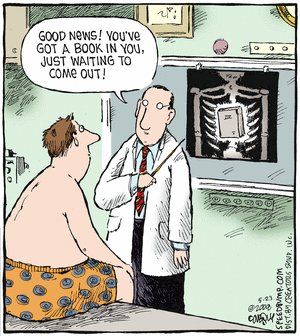

 Une question reçue soulevant un point assez peu connu du grand public concernant la rémunération des auteurs et des créateurs, et sur lequel il me paraît indispensable de faire un point :
Une question reçue soulevant un point assez peu connu du grand public concernant la rémunération des auteurs et des créateurs, et sur lequel il me paraît indispensable de faire un point :
