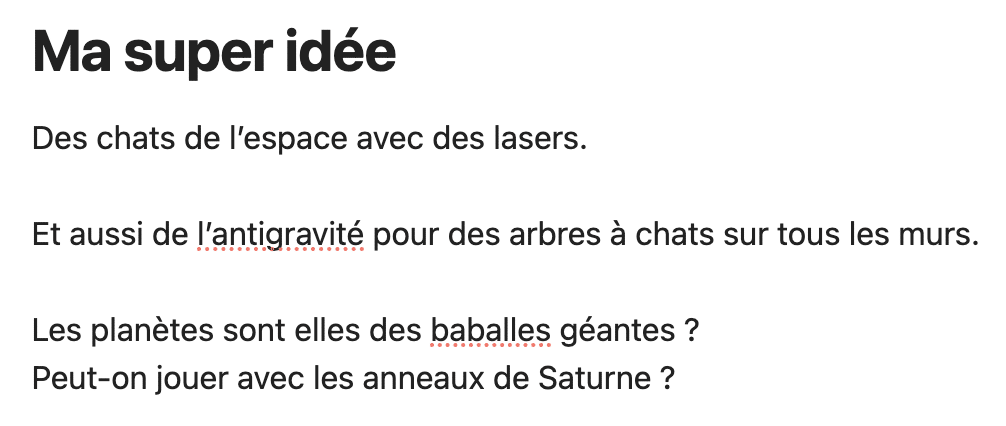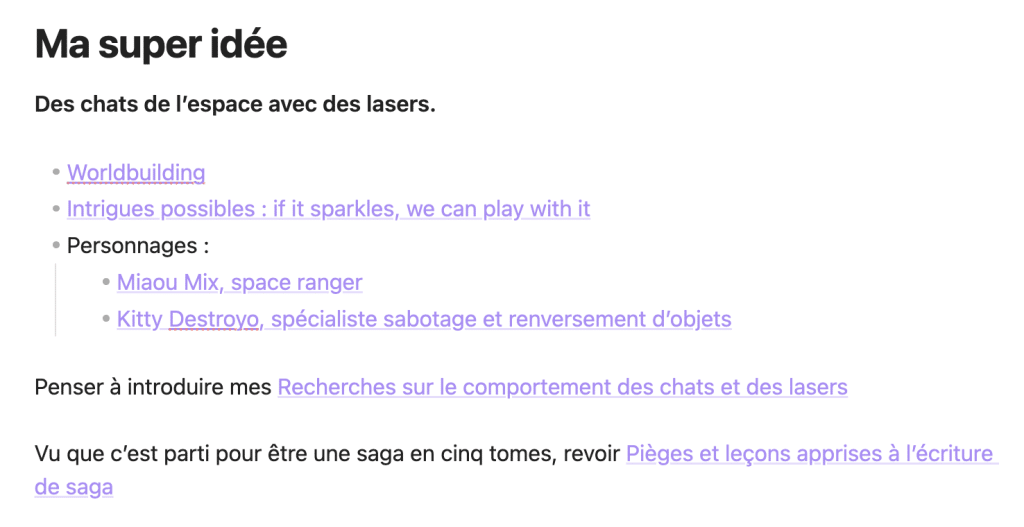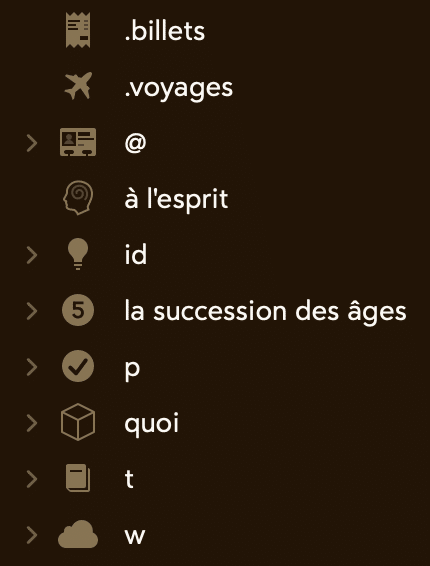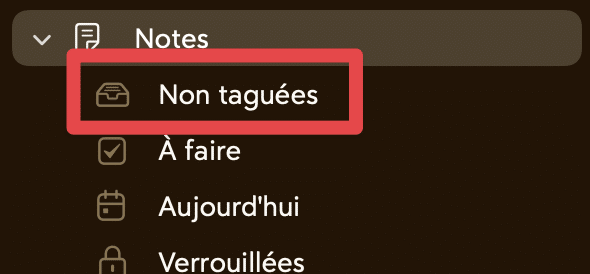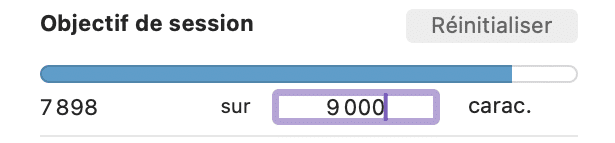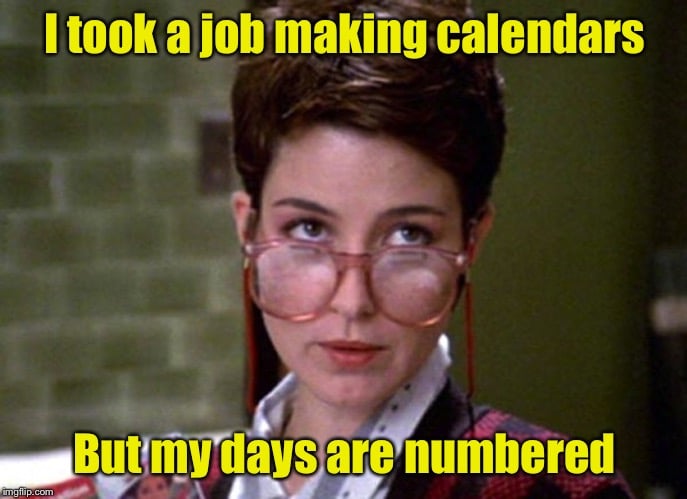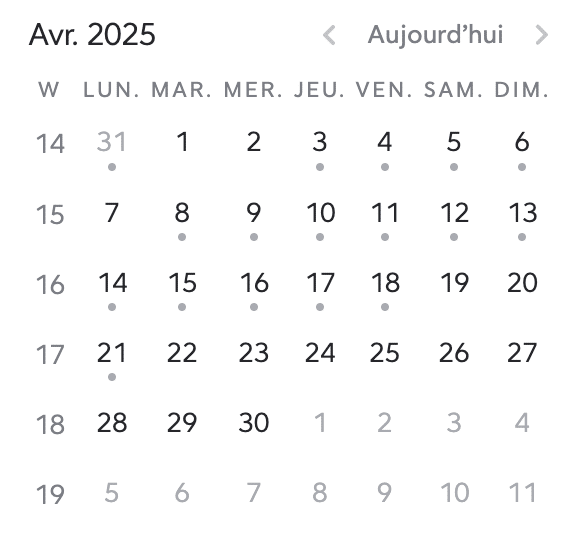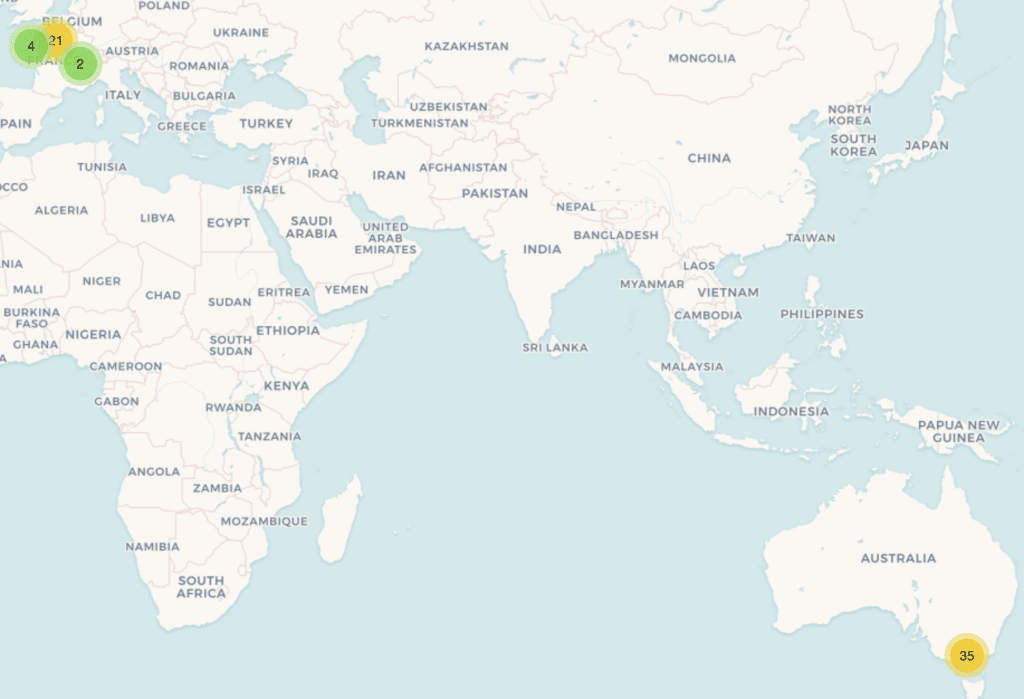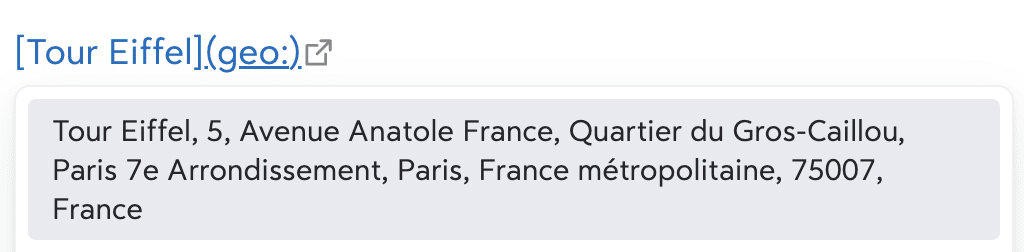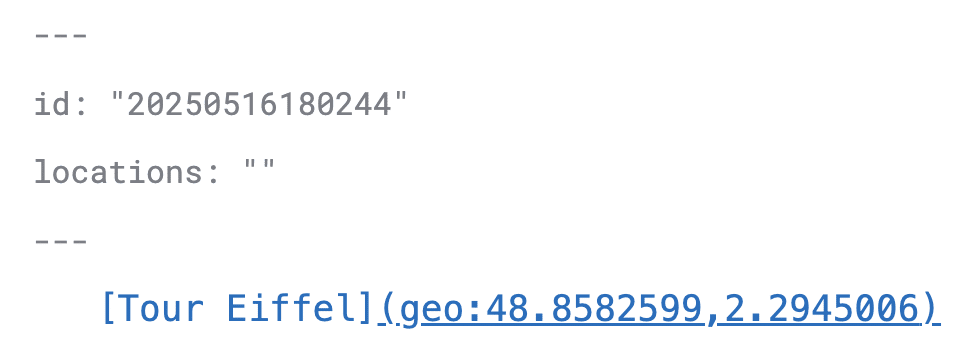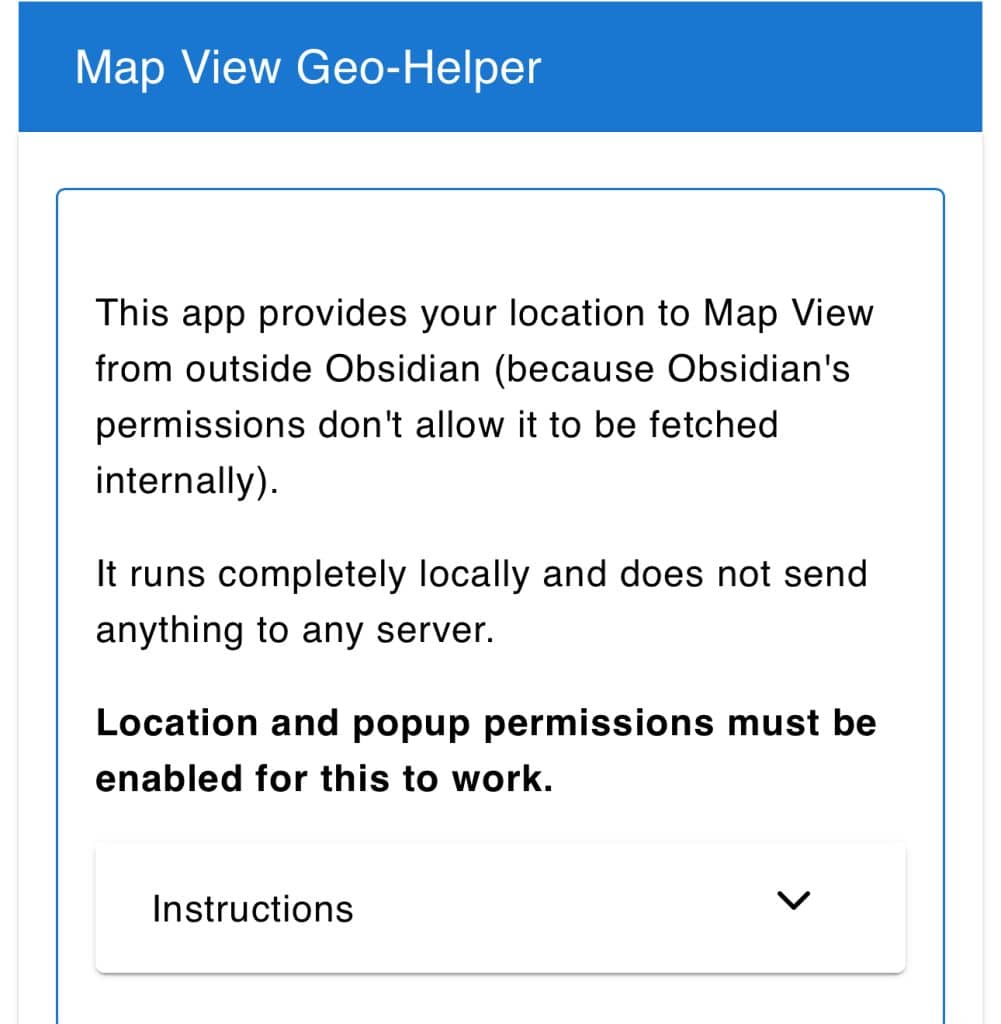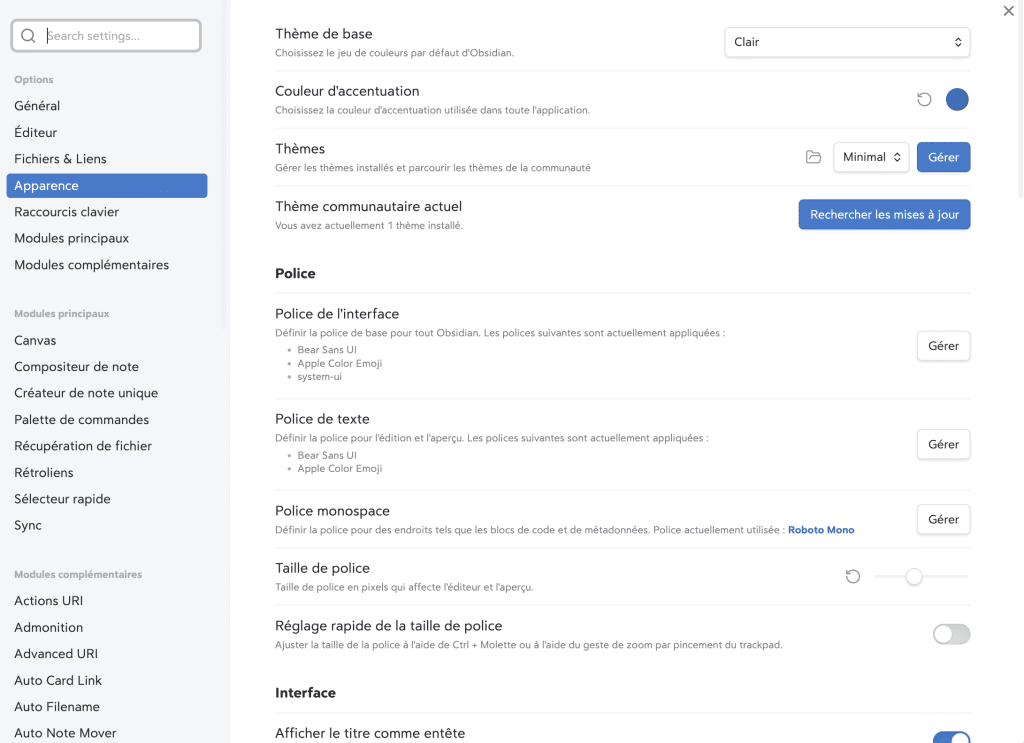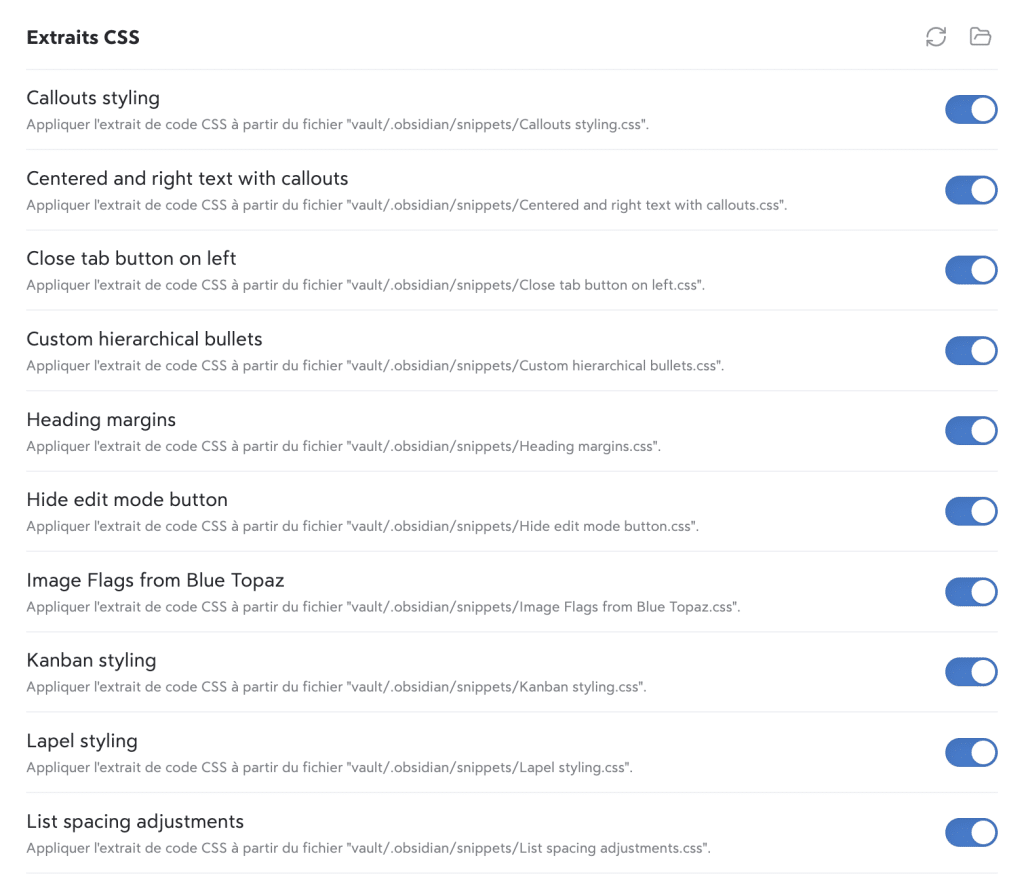Le Zettel de la quinzaine : Un démarrage de scène statique convient dans le cas d’une contemplation authentique (202401211622)
Pour mémoire, ces notes sont des extraits bruts de décoffrage de mon système de notes privé, afin d’expérimenter avec une forme différente de partage dans l’esprit des digital gardens.
En général, on préférera [[202204061911 Démarrer une scène autant que possible par de la dramatisation plutôt que de la psychologie]], ce qui se relie à [[202202142227 In late, out early]].
Cependant un démarrage de scène intériorisé, statique, convient quand on a un réel moment contemplatif, un genre de pivot, quand le personnage a réellement quelque chose à confronter en soi. C’est seulement dans ce cas, genre contemplation cinématographique, qu’on le fait. Ne pas prendre ça pour une excuse trop facile pour en abuser. Une bonne règle pour vérifier si ça fonctionne est [[202312291112 Dans l’écriture, penser cinéma]].
Dans tous les autres cas, ne pas le faire, et essayer une mise en route orientée action avec arrivée le plus vite possible dans la dramatisation.