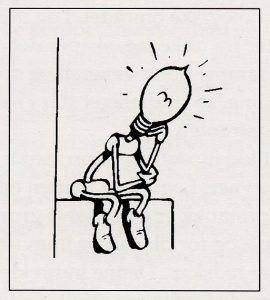
(c) Disney
Encore une petite période de silence, mais je reprends progressivement le fil d’une activité normale (lire : raisonnable) et donc l’ouverture de ce bar et l’approvisionnement en bibine fraîche. Il y a une question qui était arrivée depuis un moment, très fondamentale :
Quand on a une idée en tête c’est dejà pas mal. Non ?
On essaie de l’exploiter un peu, on y ajuste d’autres idées, ca forme un tout cohérent et on se dit, après 3 mois de gestation : mouais, ca pas si mal, allons y.
Mouais… sauf que quand je m’arrête dans une librairie, quand je jette un regard envieux et jaloux sur les couvertures, quand je bave sur les 4ieme de couverture, personnellement je repars de là en me disant que mes idées sont nullissimes et aussi développées qu’un embryon d’huitre de 2 jours.Alors oui, ou allez vous chercher toutes ces idées ? Qu’avez vous dans vos cerveaux pour en sortir des trucs comme ca ? C’est limite effrayant !! 😉
Bon, déjà, les quatrièmes de couverture sont conçues comme ça : pour donner envie, pour présenter les points forts d’une histoire et donc mettre en avant ce qu’elle a de meilleur. Une bonne quatrième peut sublimer le contenu d’un livre, mais, comme on l’a tous vu un jour, le récit n’est pas forcément à la hauteur des promesses (« La richesse de Tolkien, la drôlerie des Monty Python et le style de Jean Lorrain ! »). Il ne faut certainement pas complexer face à elles ! Sans compter que, sur un livre publié, il y a eu le retravail de l’auteur, les suggestions de l’éditeur et parfois des commerciaux, une foule de regards extérieurs qui visent tous à ce que cette histoire donne son plein potentiel.
D’accord. Mais ce n’est qu’esquiver la question. Où va-t-on trouver des idées ? Je dirais que trouver des idées n’est pas un problème : le monde en fourmille. Ouvrir la presse, se balader sur le Net, rester ouvert à son environnement amène des quantités d’idées, parfois dans les moments les plus improbables. Il faut rester disponible, à l’écoute du monde, et elles viennent d’elles-mêmes. Je suis convaincu qu’il n’y a pas de mauvaises idées : il y a, en revanche, les idées qu’on traitera de manière intéressante parce qu’elles nous concernent d’une manière ou d’une autre, et celles avec lesquelles on n’a pas de véritable lien.
Ce qui compte, c’est donc de trouver les idées qui conviennent pour soi ; non pas creuser le même sillon et traiter toujours les mêmes thèmes, mais apprendre à se connaître pour remarquer, parmi la foule de récits potentiels qui peuvent naître, ceux que l’on a vraiment envie d’écrire, ceux qui résonnent avec nos convictions, nos désirs, nos révoltes, ceux que l’on veut vraiment explorer et suivre pour découvrir où ils nous conduiront. Si l’on ne jure que par la hard science, une idée purement romantique à la façon du Journal de Bridget Jones, aussi riche et intéressante soit-elle, ne résonnera guère, et son exécution va s’en ressentir.
Car je pense aussi que l’exécution prime sur l’inventivité. La meilleure idée du monde ne franchira peut-être même pas le comité de lecture de l’éditeur si l’exécution est bancale, insuffisante, si le potentiel d’une grande idée n’est pas exploité convenablement – alors qu’on peut faire une grande histoire avec un archétype classique, de Romeo et Juliette à Avatar. Il faut ensuite tirer le maximum de ce germe d’envie, qu’on reconnaît parfois à un frisson caractéristique bien physique (comme le disent deux Elisabeth, George et Vonarburg, dans leurs livres d’écriture respectifs, « le corps sait »). Et c’est peut-être la partie la plus difficile : leur faire exprimer (au double sens de la parole et de presser comme un citron) leur potentiel, trouver la raison pour laquelle cette idée a séduit, et l’histoire qui se trouve ensuite derrière. Les mûrir, les méditer, en suivre les implications et ramifications, les ressasser jusqu’à pouvoir leur faire porter un récit qui compte, à tout le moins, à ses propres yeux. C’est là, peut-être, qu’on touchera à une authenticité qui pourra atteindre et émouvoir, par la suite, le lecteur.
Où va-t-on donc chercher tout ça ? À l’extérieur, autant qu’en soi. La psyché humaine compte un nombre limité de grands thèmes, aussi vaste soit-il : l’amour, la mort, la perte, le dépassement de soi, la liberté… Le plus important, à mon sens, c’est de chercher en soi-même, à force d’introspection et de ruminations, ce que l’on a de personnel à dire sur la question, et le dire ensuite du mieux possible. Je pense humblement que c’est là que se terrent les idées qui comptent vraiment. C’est cet aspect qui les rendra bonnes, et leur rumination qui les rendra originales. Mais l’originalité n’est, en quelque sorte, qu’un effet secondaire qui vient dès qu’on a suffisamment creusé, avec sincérité, ce qui fait l’honnêteté de notre regard et de ce que l’on cherche à traiter. Elle n’est pas un but en soi. Chercher sans relâche sa propre parole, ne pas limiter ses ambitions, aller vers le lecteur, voilà à mon sens les buts véritables.



Et voilà qui annonce une autre question : qu’entends-tu par « aller vers le lecteur » ? Ainsi que tu l’as fort justement écrit plus haut, « mûrir [les idées ?], les méditer, en suivre les implications et ramifications, les ressasser jusqu’à pouvoir leur faire porter un récit qui compte, à tout le moins, à ses propres yeux. C’est là, peut-être, qu’on touchera à une authenticité qui pourra atteindre et émouvoir, par la suite, le lecteur. »
A ses propres yeux, en effet. Alors, peut-être, peut-il toucher un lecteur, certains lecteurs, jamais tous à la fois, et certainement pas une entité totalitaire (« le lecteur » ou « les lecteurs »), qu’on nous balance souvent dans la tronche en guise d’argument critique, comme si tel lecteur ne valait pas tel autre, comme si le nombre faisait foi, comme si ce on se prenait pour l’ensemble indéfini des lecteurs et prétendait parler en son nom. Alors, « aller vers le lecteur » ?… Qu’est-ce que ça veut dire ?
Très, très bonne question ! Elle mérite plus qu’un petit com’ lâché entre la poire et le dessert. Je la mets de côté et je propose un article dessus sous peu, promis. 🙂
« Aller vers le lecteur », pour moi, c’est d’abord sortir de soi… Sortir l’idée de ses propres entrailles, de ses propres circonvolutions cérébrales pour la montrer aux autres. Le lecteur, c’est l’autre qui n’est pas soi, c’est celui à qui on doit dire explicitement ce que l’on peut se contenter d’esquisser pour soi-même.
Pour moi, l’idée se concrétise quand j’ai trouvé comment la faire vivre hors de ma couveuse. Quand elle peut affronter le regard « du lecteur » et avoir quelque chose à lui dire (qui qu’il soit) parce que l’idée est devenue histoire, l’histoire narration et la narration acte de partage.
Mais ça mérite effectivement d’être approfondi. Une chose est sûre, « le lecteur » n’est pas une typologie, c’est celui qui lira alors que moi je dis. Je ne suis pas, et ne serai jamais, mon lecteur, même si je peux dans une certaine mesure essayer de me mettre à sa place pour me lire. J’ai, comme tout écrivain, fabriqué un « moi-lecteur » censé m’aider à communiquer avec les vrais lecteurs. C’est lui qui me relit et me corrige. Mais ce n’est malheureusement pas un « vrai » lecteur détaché de moi. Le vrai lecteur, je ne le connais pas. Nous nous parlons par textes interposés, et c’est comme un hygiaphone à sens unique.
Je vous poutoune,
Tout à fait d’accord avec toi, notamment sur l’aspect « explicite » qui était effectivement mon intention dans l’article : aller vers le lecteur, c’est pour moi lui rendre intelligible le récit et la pensée, lui faciliter l’entrée dans le monde fictif et maintenir les termes du contrat narratif du début à la fin. J’aime beaucoup en particulier ton idée de « moi-lecteur » que je trouve très juste ; c’est la projection de cette persona qui juge et corrige le récit. Nancy Kress le mentionne aussi, chaque auteur doit viser à incarner la trinité du personnage, de l’auteur et du lecteur à des moments différents.
Stephen King parle d’écrire avec la porte fermée, pour soi d’abord, et de relire avec la porte ouverte, sous entendu, avec le regard du « lecteur » par dessus l’épaule. En substance, c’est ce que tu dis, écrire pour soi avant d’en faire quelque chose pour les autres.
Il m’est arrivé d’écrire des textes, de les relire et de les retravailler jusqu’à en être sinon pleinement satisfait, au moins suffisament pour pouvoir les montrer sans rougir d’incompétence. Et il m’est arrivé de relire certains de ces textes (pourtant mille fois relus) en même temps qu’un véritable lecteur, et là, presque par magie, parfois défauts ressurgissent et se mettent à clignoter en rouge dans le texte, au point que l’on à peine à comprendre comment on ne les a pas vu avant, on ne voit plus que cela.
Se rapprocher du lecteur, c’est peut-être aussi ça, être capable de s’éloigner de son texte au point d’être lecteur de ses propres écrits. Changer le point de vue de celui qui regarde, parce vu de dedans ou de dehors, ce ne sont pas forcement les mêmes défauts (et à fortiori, les mêmes qualités) qui parlent.
ps : ça marche aussi quand on vient de poster et qu’on se rend compte de fautes d’orthographe et même de mots oubliés… -_-;
Merci Lionel et Jean-Claude. « Aller vers le lecteur », cet « autre qui n’est pas soi », consisterait donc à « sortir de soi », à métamorphoser l’idée en image, en narration – toutes choses susceptibles d’être partagées. Donner une expression formelle à des concepts, des idées, des images mentales : c’est ça, l’acte littéraire. C’est à ce moi-lecteur (le mien est particulièrement retors), à cette persona, qui incarne « le lecteur » que s’adresserait en fait le livre, d’une certaine manière. Mais alors, l’on en revient presque au point de départ : que signifie « aller vers son moi-lecteur » ? Qui est-il ? Comment se construit-il ? Comment est-il censé aider à « communiquer avec les vrais lecteurs » puisque ceux-ci nous demeurent toujours inaccessibles, puisque nous hygiaphonons à sens unique ?
S’agirait-il de modeler ce moi-lecteur ? Mais selon quels critères ? Ne s’agit-il pas, au fond, que d’une adaptation à une réalité économique ?
Personnellement, je suis très prosaïque dans cette quête. Je suis un lecteur en plus d’être un auteur et je sais ce que le moi-lecteur aime et, surtout, déteste. Je m’efforce donc de me rapprocher le plus possible de ce que j’aimerais lire et de bannir ce que je déteste trouver, comme si je me rencontrais pour la première fois et que je devais me convaincre moi-même, en étranger ignorant tout des belles images dans ma tête.
Il me semble que c’est principalement une quête d’accessibilité et donc, en un sens, d’humilité. Suis-je compréhensible pour le lecteur idéalisé auquel je m’adresse (et qui change d’un récit à l’autre) ? Lui facilité-je autant que nécessaire l’entrée dans mon monde, dans mon récit ? S’il subsiste des difficultés, des parties absconses, des efforts d’interprétation à fournir, résultent-elles bien d’une démarche volontaire qui procède de la démarche fictionnelle dans son ensemble, et non d’une paresse de ma part – voire, pire, d’une incompétence ? J’écris ce que je désire, mais je vise tout autant à toucher autrui et à être compris par lui au maximum de ma compétence, sinon ma fiction reste lettre morte.
Suis d’accord, je ne crois pas qu’il existe d’idées ou de thèmes entièrement originaux, pas de création ex nihilo, l’essentiel après est dans le traitement ou la combinatoire et l’expression. Parce que c’est la façon de lier ou exprimer des choses qui elle peut être originale. Ensuite on a beau avoir la pierre philosophale de l’idée si on la rends pas accessible, si on ne la travaille pas ça restera qu’un gros caillou pour les autres.
Après de temps en temps ouaip il y a les moments de grâces où l’inspiration vient, mais si on attends après ça on n’écrira pas souvent. Et puis même quand ça se produit il faut dérouler, décompresser l’idée arrivée en bloc… Les idées sont plurielles, des fois elles viennent d’un coup, facilement, au départ et parfois on galère, on se demande si ça vaut la peine mais on s’accroche et finalement après bien des efforts, oui ça en valait la peine.
Jean-Claude a une belle histoire amérindienne sur les idées, il l’a racontée pendant l’atelier des imaginales mais tu n’étais pas présent à ce moment là, il me semble : il y a des gens qui ont des têtes à idées, les idées viennent se poser sur eux; si on les traite bien elles reviennent, en ramenant d’autres avec elles; si on les maltraite elle ne reviendront plus.
Ca me convient tout à fait, quand j’ai fini mon texte, je regarde si j’ai bien traité l’idée, avec mes moyens propres d’écriture. Après de la même manière que les histoires changent selon qui les racontes, les histoires changent selon qui les lit, je fais en sorte d’être le plus compréhenible possible mais après, à partir de quelques lecteurs, j’écoute comment eux les ont lues, c’est peut être le côté scriptural mais c’est un de mes gros plaisir d’écriture que de me rendre compte que de façon inconsciente j’avais placé d’autres voies.
Brandon Sanderson disait aux Utos que plus l’on écrit, plus l’on fouille ses idées, plus d’autres viennent, demandant qu’on les traite à leur tour, et qu’il ne fallait pas craindre de tomber à court : je suis bien d’accord 🙂
Frank Horvat après avoir fait un journal photographique pendant un an, disait que selon lui on regarde vraiment les choses 5% du temps. Après cette expérience, il disait qu’il regardait mieux, il arrivait à bien regarder 10% du temps 🙂
Quand tu acceptes les idées; que tu notes des bouts de trucs au lieu de les laisser filer, tu gagnes quelques % !!!
Un peu sceptique quand même dans le sens où ça ne marche pas pour tout le monde. Personnellement, je fais partie des gens qui épuisent leur énergie créatrice après avoir passé un moment à jouer avec des idées, et qui ont besoin ensuite d’attendre que les batteries se rechargent. Quand je fouille les idées, ça n’appelle pas d’autres idées, ça les épuise. 😉 Sans compter que la capacité ou non de développer ces idées me paraît étroitement liée à l’évolution personnelle de l’auteur, mais ceci est une autre histoire.
J’ai aussi ce problème d’énergie, mais il a plus trait à cette capacité de traiter ces idées : je ne suis jamais à court d’histoires, en revanche, la volonté de les développer et de chercher comment les servir au mieux doit être ménagée pour éviter le « burn-out ».
Ça se joue plutôt à quel niveau du coup ? J’ai l’impression aussi que tout le monde ne place pas la même chose derrière le terme d' »idées », pour certains ça va être le déclic initial, pour d’autres une intrigue à peu près définie.
Je sais qu’on a déjà eu cette discussion plein de fois, mais ça m’intéresse toujours. 😉
Y a pas de mal, moi aussi ça m’intéresse toujours 🙂
C’est plutôt un « déclic élaboré » pour ma part – le côté « oh, je pourrais faire ça, et de telle manière ». Pas une idée pure, donc, mais une situation « riche de potentialités », porteuse d’une charge et d’un élan qui demandent à être creusés.
J’aime bien l’idée de déclic élaboré. Pour « la double vie des méduses » (le truc rigolo des nouvelles aléatoires sur actusf), pour moi le « déclic » avait été la voix du narrateur, avec une phrase en prime. Parfois, ca peut être juste une expression. A partir de là, quand la chance est là, les idées s’enchainent toutes seules. Sinon, faut leur courir après avec une hache ^_^.
Après, j’ai déjà écrit des textes très mauvais (tout est relatif, mauvais par rapport à ma propre (et limitée) production, de même que mes « bons » textes, me semblent fade après avoir lu Jaworksi) basés sur des idées excellentes, en ayant pourtant quasiment tout le déroulé avant même de commencer à écrire, mais du coup, plus de spontanéité et le résultat devient fade.
Ca vous arrive aussi ? (dans une certaine mesure, j’imagine que la technique doit pallier, non ?)
Je ne peux pas répondre pour Lionel, mais ça m’est arrivé effectivement. Cela dit, il m’arrive souvent de rester bloquée sur une idée de texte qui a un début, une fin, un déroulement, tout est quasiment là, mais je sens qu’il manque le « truc en plus » qui donnera son sens à l’ensemble. Des fois, ça se joue à pas grand-chose (un thème qui ne sera là qu’en filigrane par exemple).
Pour rebondir sur l’échange précédent, je crois que je commence à parler d' »idée » à partir du moment où le déclic est assez élaboré pour commencer à produire un début de texte : personnages, situations, thématiques, etc. Même s’il m’arrive souvent de rester coincée en plein milieu (ça m’est encore arrivé l’an dernier avec un texte qui paraissait très bien parti, mais qui n’a jamais voulu se laisser développer jusqu’au bout).
Oui, tout à fait. L’équilibre entre préparation et spontanéité (pour un structurel comme moi) est parfois délicat à atteindre : il est possible de « tuer » une idée en la creusant trop et donc en la « raidissant », en ne la laissant pas exprimer ses vraies surprises, comme il est possible de passer à côté de ce qu’on voulait / devrait vraiment traiter. Comme le dit aussi Mélanie, il manque parfois un élan, une vie qui a besoin de prendre dans le texte.
Après, l’expérience prouve que ce n’est pas corrélé aux difficultés de préparation, d’écriture, à la richesse de l’idée, etc : c’est juste que, parfois la sauce prend, et parfois non. L’expérience prouve aussi – et heureusement – qu’effectivement, la technique aide énormément et elle peut dissimuler dans leur intégralité d’éventuels tâtonnements – mais c’est aussi tout le rôle et l’importance du retravail avec un bon éditeur.
En fait, on ne peut que faire de son mieux, en toute honnêteté, face à soi, et – surtout – lâcher prise ensuite.