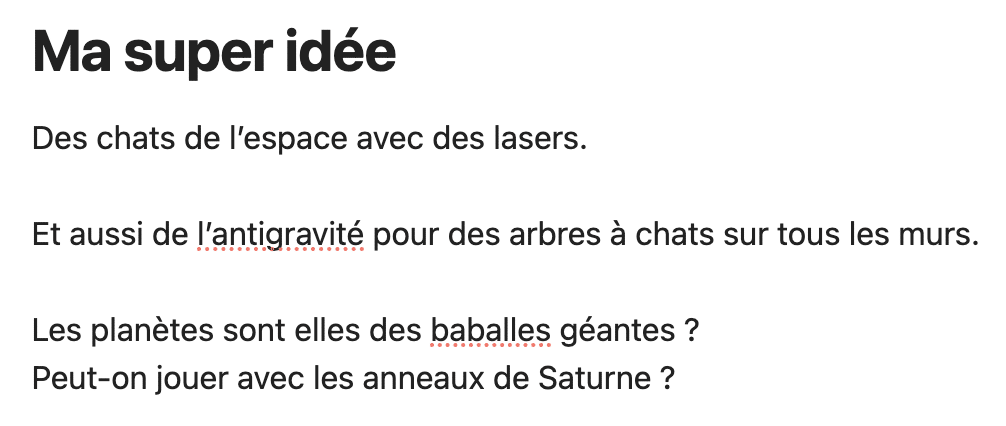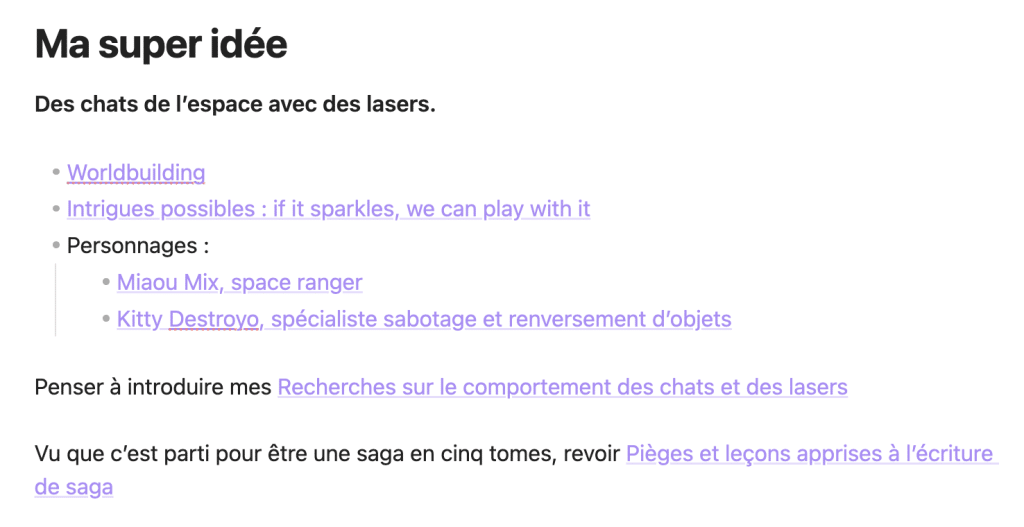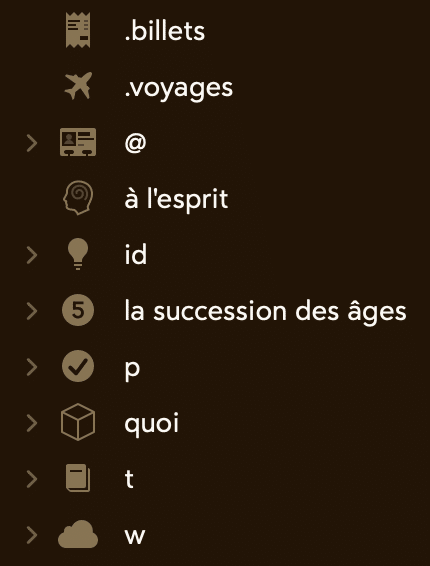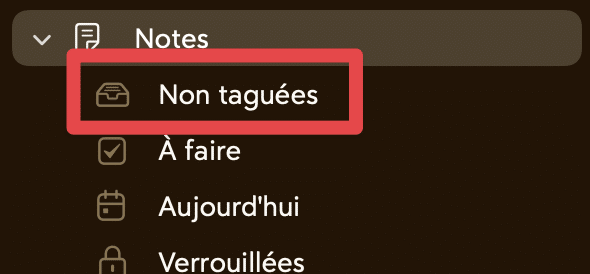Procrastination podcast s10e11 – Manies et traits mémorables des personnages

Deux semaines ont passé, et le nouvel épisode de Procrastination, notre podcast sur l’écriture en quinze minutes, est disponible ! Au programme : « s10e11 – Manies et traits mémorables des personnages« .
Les traits, les manies, les particularités des personnages peuvent leur donner de la couleur et aider à les caractériser d’une façon unique et parfois même éloquente : conversation à bâtons rompus autour de la conception et de l’usage de ce levier narratif cette quinzaine. Pour Mélanie, pour qui les personnages viennent entièrement formés pour vivre, ce genre de détail est fourni par l’inconscient. Estelle réfléchit beaucoup au process de description, s’efforce de sortir de la fiche signalétique, et donc les détails ont un rôle intéressant et potentiellement éloquent.
Lionel loue le rôle de l’inconscient, propose de se fier aux éléments qui n’ont pas de sens conscient mais s’élucident au fil de la création dès lors qu’ils semblent justes.Références citées
- Star Wars, saga de George Lucas
- Mad Max: Fury Road, film de George Miller
- The X-Files, série de Chris Carter
- Peter Pan, pièce et roman de J. M. Barrie
- Morgan of Glencoe
- Madame Bovary, roman de Gustave Flaubert
- Desperate Housewives, série de Marc Cherry
- Twin Peaks, série de Mark Frost et David Lynch
- Down by Law, film de Jim Jarmusch
- Mad Max 2, film de George Miller
- La Pointe de l’épée, roman d’Ellen Kushner
Procrastination est hébergé par Elbakin.net et disponible à travers tous les grands fournisseurs et agrégateurs de podcasts :
Bonne écoute !