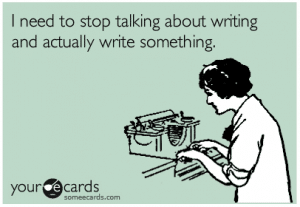
On entend régulièrement dire que l’écriture est un muscle qui se travaille. On entend toujours dire qu’il est difficile de trouver du temps pour s’y consacrer avec les impératifs du quotidien. Il semble que la plus grande difficulté pour une majorité d’auteurs, quel que soit leur niveau d’expérience, leur habitude, leur facilité, reste toujours de rassembler la volonté d’affronter ce qui, par nature, est anxiogène : une page où il n’y a rien, un parcours inconnu et incréé, où il faut tracer un chemin unique, imparfait, qui sera appelé en plus à quantité de corrections ultérieures. (On a parlé récemment de l’angoisse de la page blanche dans Procrastination, d’ailleurs.)
Je veux dire, y a de quoi déprimer. Et pourtant, quelle joie dans les moments de fulgurance, et même hors de cela, quel sentiment de nécessité et de justesse une fois une scène, un chapitre, un livre achevés au mieux de ses efforts.
Il est temps pour un aveu (que je ne suis pas le premier à faire) : c’est une situation contre laquelle j’ai toujours lutté, et qui n’a d’ailleurs fait qu’empirer au fil du temps, à mesure que les enjeux s’accentuaient (ce dont je suis immensément reconnaissant, bien sûr !). Bien qu’étant à plein temps sur les métiers de création, l’écriture en tête, j’ai longtemps ressenti cette appréhension désagréable le matin au moment de me replonger dans un manuscrit, plus encore après une coupure de quelques jours (pour un festival ou même, bêtement, pour un week-end). Que vais-je y trouver que j’aie pu oublier ? À quel point vais-je tout devoir refaire parce que les idées d’hier qui semblaient géniales apparaîtront en fait pourries trois jours après ? (J’étais en général plutôt positivement surpris, mais la seule appréhension de poser les yeux sur le travail de la veille pouvait me faire tomber dans des stratégies élaborées de procrastination.) Je finissais toujours par avancer, par remplir mon quota de signes, et je lisais partout que je n’étais pas seul dans cette galère – quantité d’auteurs, les pros en particulier, décrivent ce mécanisme. Dans les mots de William Gibson : « I very much enjoy the state of having written« .
C’était donc, me disais-je, une composante du métier, un mal nécessaire avec lequel s’arranger, pour lequel – très important – il ne me fallait ressentir aucune culpabilité, aucun syndrome de l’imposteur. Difficile quand on est seul face à son manuscrit pendant des mois, plus difficile encore quand on voit, de loin en loin, des auteurs quasiment qualifiés de graphomanes, qui professent n’éprouver aucune difficulté à attaquer leur manuscrit, qui volent le moindre instant pour écrire ne serait-ce que deux lignes. J’ai vu Brandon Sanderson dans un court voyage en train dégainer son ultraportable et se mettre à écrire avec abandon. J’ai vu des auteurs américains aux Utopiales profiter d’un trou dans leur emploi du temps pour retourner écrire à l’hôtel. J’ai entendu dire qu’Isaac Asimov s’était fait fabriquer une paire de bretelles spéciales pour transporter sa machine à écrire dans les voyages en voiture et ne pas perdre ce temps d’écriture-là. Quels héros ! Quelle chance ! Différence de constitution, me disais-je. Je professe toujours qu’apprendre à écrire, c’est apprendre à se connaître : moi, j’éprouve cette angoisse existentielle à chaque manuscrit, c’est comme ça, l’écriture me sera toujours partiellement douloureuse, embrasse la douleur, mec, apprends à l’aimer mode G.I, crie « oh oui, livre, fais-moi du mal » et avance avec un sourire un peu halluciné, la sueur au front. Tant pis ; c’est comme ça.
Ma petite voix obsédée par la productivité et l’optimisation ne pouvait s’empêcher de se dire : il doit exister un meilleur moyen. Tu as publié plus de trente nouvelles, tu vas approcher de la barre des dix bouquins, donc tu dois commencer à savoir un minimum où tu vas, alors : trouves-tu normal d’avoir l’impression de labourer un champ de cailloux avec ton cerveau tous les matins ? Peux-tu conserver l’exigence et la méthode tout en abaissant le seuil de l’anxiété ? Est-il possible de pouvoir se mettre à écrire dans la moindre fenêtre de temps libre sans avoir besoin de deux heures pour entrer en état de flow ? Au-delà de ça : est-il bien professionnel de vivre cette tension au quotidien quand tes facultés, ta créativité, sont tes outils de production principaux (au sens très basique de la manufacture industrielle) ?
Non, évidemment.
Il doit exister un meilleur moyen.
Il y en a un, évidemment, sinon je ne raconterais pas tout ça, et attention, je n’ai inventé ni l’eau tiédasse ni le fil à couper le beurre fondu : c’est un conseil ancestral qui est régulièrement donné de loin en loin, mais qui me paraît mal exprimé, et surtout mal démontré ; il a seulement l’air d’une formation à l’état d’esprit, un tremplin pour les auteurs faisant leurs premières armes. Mais il est excellent, si on prend le soin de se l’approprier et d’y ajouter rien qu’une composante pourtant évidente.
Voici le raisonnement. Attendu que l’écriture est un muscle, ce qui concerne :
- La pratique de l’écriture pure (la narration, le style, formuler simplement des phrases les unes après les autres) – la simple technique de l’artisan ;
- L’immersion dans un projet : l’élan de l’histoire, la connaissance intime des personnages, le maintien délicat des équilibres, la préfiguration de ce qui vient.
Il faut travailler le muscle tous les jours. Duh.
Il faut écrire tous les jours, mais attention : pas n’importe quoi, et pas dans n’importe quelle condition. L’idée m’a été inspirée par Kourosh Dini dans Creating Flow with OmniFocus (on a parlé d’OmniFocus ici) qui évoque son prof de piano, lequel lui donnait une seule et unique recommandation à ne jamais briser : touche le clavier tous les jours. C’est-à-dire, fais la démarche d’aller devant le piano, de ne jouer peut-être que trente secondes, mais fais-le. Cela envoie un signal fort à ta psyché :
- Ceci est une priorité absolue de ton existence à laquelle tu ne déroges jamais ;
- Le seul effort sur lequel tu te concentres, c’est créer le contexte de ta pratique ;
- Tu n’as aucune obligation de résultat, seulement une obligation de moyens : te mettre devant le clavier.
En conséquence, ce principe transposé à l’écriture devient :
Touche ton histoire tous les jours.
Parce qu’il ne s’agit pas d’écrire n’importe quoi – et c’est là que l’idée d’écrire tous les jours est incomplète. On peut procrastiner sur l’écriture d’un récit en écrivant simplement autre chose. Non : il s’agit de toucher son manuscrit, et là, peu importe la tâche : construire une scène, en corriger une précédente, et évidemment progresser dans l’histoire. Pour ma part, je me fixe en déplacement, tout particulièrement en festival (où, en général, je n’ai pas une seule seconde pour souffler) une règle très simple : écrire une phrase par jour.
Une phrase par jour, c’est une poignée de secondes. Je peux bien trouver une poignée de secondes, non ? Eh, toi, là, derrière ton écran, ne me dis pas que tu ne peux pas trouver une poignée de secondes. Je ne déroge jamais à cette règle, et aussi simpliste que ça paraisse, cela a des effets prodigieux sur mon état d’esprit, ma disponibilité, ma capacité à progresser. Toute l’idée n’est pas dans cette phrase rédigée, mais dans la démarche mentale de conserver, toujours, un lien avec mon projet, quelle que soit ma surcharge de travail, y compris et notamment dans les déplacements. Et quelle que soit l’heure. (En Islande, bien que tombant de sommeil un soir, j’ai allumé le MacBook à 23h30 dans mon lit, allumé Scrivener, écrit ma phrase, et l’ai éteint. J’étais content. Rentré à deux heures du matin de Saint-Malo samedi soir, j’ai néanmoins lancé Scrivener et travaillé dix minutes.)
La preuve ? Quand nous avons donné la masterclass des Imaginales avec Jean-Claude Dunyach cette année, nous avons proposé aux stagiaires quelques petits exercices d’écriture d’une dizaine de minutes. Dans ces dix minutes, j’ai dégainé mon iPad et écrit (suscitant la fascination des stagiaires). Il y a quelques semaines, pendant une séance de dédicaces un peu molle, lors d’une accalmie du public, j’ai dégainé mon iPad et écrit (suscitant la stupéfaction de mes collègues). Je peux rentrer ainsi 5 000 signes sans les voir passer. La barrière d’entrée s’est prodigieusement abaissée parce que je ne perds plus jamais le contact avec mon projet, ce qui était le cas quand je ne pouvais pas écrire pendant quelques jours (lors des salons, dédicaces, ou simplement parce que les tâches administratives s’imposaient pendant un jour ou deux) et rendait la remise au boulot difficile. Un train, un avion – même une course en ascenseur – je peux sortir mon iPad, mon iPhone, écrire une phrase.
C’est très étrange : je suis devenu l’un de ces auteurs graphomanes que j’admirais et enviais secrètement, et je comprends à présent le mécanisme fondamental de cette graphomanie – on ne le fait pas parce qu’on est graphomane, on le fait parce qu’on a peur de ne plus pouvoir l’être si on s’arrête. Voilà le secret, auguste lectorat.
Si tu dois changer une seule chose dans tes habitudes, si tu dois suivre un seul, un unique de mes conseils sur ce site, crois-moi, je t’en prie, fais cette expérience transformative – je me sens tellement stupide de ne pas avoir essayé plus tôt, j’ai presque honte de l’écrire, mais je me dois de le partager tant c’est fondamental : touche ton histoire tous les jours.
Aucune, AUCUNE dérogation.
Cela changera ton approche de l’écriture et la joie de ta pratique. Je te le promets.



Ça marche en remplaçant « histoire » par « sexe » ?
(ça m’arrangerait pas mal)
Je te laisse t’arranger :p
Plus sérieusement, quand tu parles de toucher à l’histoire – ça peut aussi se faire sur son carnet de notes, à la volée, sans forcément allumer un ordinateur ou une tablette ?
Oui, bien sûr ! Parfois on n’a pas le choix parce qu’on est débordé toute la journée. J’ai Scrivener sur mon iPhone précisément dans ce but. Tout ce qui compte, c’est toucher l’histoire, faire l’effort intellectuel de s’y immerger réellement et sincèrement ne serait-ce que cinq minutes, même dans une journée infernale.
Super « feel good » article (c’est quoi une course en ascenseur ???)
C’est comme la course en sac, mais moins fatigant :p
Quand j’ai lu le titre de ton article, j’ai cru que le secret, ça allait être de picoler… Alors du coup je suis poil déçue 😀
Précieux conseils, en tout cas, et je suis d’accord avec toi. Cependant, il y a une chose que je ne me souvienne pas que tu aies déjà abordée : quand on parle d’écriture, on présuppose presque toujours que nos vies sont bien remplies, voire débordées, et je ne vois jamais personne parler d’écriture et de motivation à écrire, d’anxiété à écrire, dans le cadre d’une vie un peu vide. Pour ma part, j’y ai été confrontée en période de chômage, et si j’ai appris une chose, c’est bien qu’avoir du temps, ce n’est pas forcément un luxe. Je trouve très difficile d’écrire quand le reste de la vie semble en stand-by. Mais j’écrirai peut-être un truc là-dessus sur mon propre blog 🙂
J’en parle en filigrane à travers les méthodes de productivité, en fait. Quand tu es à ton compte, il est extrêmement facile de procrastiner sur tout, en particulier quand les dates de remise sont lointaines, et ces difficultés sont omniprésentes. Je combats ça beaucoup avec GTD et, au quotidien, via la méthode Pomodoro : http://lioneldavoust.com/2017/vaincre-langoisse-de-la-page-blanche-avec-la-methode-pomodoro/
Je serais très curieux de lire tes propres méthodes 🙂
Un grand merci, Lionel pour ce conseil. Et dire que je me disais que j’allais attendre la dernière semaine de juillet pour m’exiler dans un coin perdu et calme du Jura et commencer à écrire une nouvelle histoire pendant ma semaine de temps libre. En fait, il faudrait que je commence dès maintenant!
Avec plaisir ! Effectivement, il faut commencer toujours au plus tôt, même si c’est un tout petit peu. Une des plus grandes illusions du métier consiste à croire qu’on a besoin de grandes plages de travail pour avancer, alors que c’est la régularité qui compte. 🙂
Ah bon? Je vais de ce pas brûler tous mes livres. 🙂 La régularité, ce n’est pas seulement « écrire ». Concevoir, penser, remâcher, reconstruire comptent aussi. Ensuite, certains d’entre nous ont besoin de grandes plages d’écriture, pour s’immerger dans leur histoire, justement parce que leur vie fait qu’ils ne doivent pas se laisser distraire (en dix ans, j’ai eu un concours, mis au monde deux enfants que j’élève, gardé un taff à mi-temps et j’en suis à onze livres en neuf ans… grâce à mon rythme qui ne rentre pas dans ce conseil…). Je ne crois pas que seule la régularité compte. Ca peut, bien au contraire, ne jamais faire décoller quelqu’un qui a tendance à être besogneux, ou favoriser un manque de recul. Pour certains. Ceux qui ne font qu’une trame, conçoivent les personnages de façon minutieuse puis se lancent en se laissant une petite part de découvertes et ont besoin de pauses et de grandes plages pauses. Pour autant que je sache, ça donne aussi des livres publiables. Je crois sincèrement qu’une des plus grandes illusions de ce métier est de croire qu’il existe UNE seule méthode. ^^
Ann, c’est une réponse à Aelinel. Une des raisons principales de la procrastination chez les jeunes auteurs, c’est d’attendre d’avoir du temps devant soi, or – et c’est Robin Hobb qui le dit – il vaut mieux partir du principe qu’on n’aura jamais plus de temps que maintenant. DANS CE CONTEXTE, la régularité compte, parce que l’autre côté de l’alternative – qui est fréquent – consiste à se dire « je ne peux pas écrire parce que j’attends d’avoir du temps » et comme on ne l’a jamais, on ne commence jamais. Je t’assure que le mécanisme est diablement courant. L’article dit par ailleurs expressément « apprendre à écrire, c’est apprendre à se connaître ». Si tu as mieux à dire, une expérience à partager, fais-le donc, détaille-le, au lieu de t’en prendre aux efforts que font les autres pour contribuer le peu qu’ils ont pu découvrir – qu’on est évidemment toujours libre d’adopter ou pas.
Je te présente, mes excuses, Ann, pour la fin de mon commentaire précédent (supprimé) qui débordait du cadre strict de la discussion.
J’apprécie ta démarche d’excuses mais au fond, je m’en tape, je ne me suis pas sentie insultée.
Salut Lionnel,
Je me souviens encore quand tu nous en a touché deux mots le jour de la masterclass ! 🙂
Mais j’ai une question pour toi maintenant (qui ne m’avait pas percutée aux Imaginales) :
Est-ce que ça marche quand tu as plusieurs projets lancés en parallèle ?
Dans un registre plus large, que penses-tu du fait d’avoir plusieurs histoires sur le feu ? (Et par sur le feu j’entends « en cours de rédaction »)
En tout cas, un article super chouette 😉
Merci Jérôme !
Ta question nécessite un article à part entière, je me la garde de côté (sans promesse de délai ^^) Mais pour aller vite : chacun fonctionne comme il l’entend, bien sûr, et je connais des camarades qui bossent ainsi. Pour ma part, j’aurais tendance à déconseiller. Je pense qu’on concentre mieux son énergie en la focalisant sur un nombre réduit de choses, mais ça n’est que moi. 🙂
Bien d’accord 🙂 surtout pour les lecteurs
Intéressant mais bien trop de « il faut » à mon goût. 🙂 Et tu peux me promettre la lune, Lionel, je ne changerai rien à mes habitudes… pour la bonne raison que parfois, ne PAS écrire de la journée (voire de la semaine) m’est nécessaire.
Je suis d’accord avec Ann. Si j’ai appris quelque chose sur les méthodes d’écriture, c’est que chacun a les siennes et qu’aucune ne convient à tous. Ceci dit, j’apprécie énormément de connaître tes méthodes, Lionel, car elles me font réfléchir et modifient forcément ma manière de travailler.
Ann, des « Il faut », il y en a trois dans l’article. Le premier dit que pour écrire, « il faut » défricher ce qui n’existe pas – soit mettre des mots sur des pages. Je ne crois pas que cela puisse être mis en défaut.
Les deux autres sont la même idée, et sous la forme « si x, alors il vient que y » (si x est vrai, alors il faut que y). Si x est faux dans le cas considéré, alors y n’est plus du tout vrai.
De toute façon, ces articles ne s’adressent pas prioritairement aux pros qui ont déjà leur manière de faire, et tant mieux. Moi, je propose simplement – et seulement d’essayer. Chacun fait bien ce qu’il veut.
Lionel Davoust il ne risque pas d’acquérir leur méthode avec ces prêt-à-penser. Et trois il faut, c’est bien trop. Ce n’est pas un loisir créatif, c’est un métier dont la transmission est plus riche que des techniques prétendument infaillibles.
Pour ma part, écrire est un loisir et non comme vous un métier, Ann. Étant donné que je suis novice dans l’activité, je préfère suivre les conseils de Lionel pour débuter et par la suite lorsque j’aurai un peu plus d’expérience, je modifierai ou pas ces méthodes d’apprentissage. Bref, à chacun sa manière de travailler tant que l’on y prend du plaisir. Dans tous les cas, un grand merci à toi, Lionel, de partager tes méthodes.
Rien de j’écris sur le blog ne prétend être infaillible.
Quand on débute, qu’on se cherche, il est utile de tester des choses pour former sa propre approche. Quand on ne sait pas par où partir, ça peut servir d’avoir des trucs à tester : « tiens, essaie ça, vois ce que tu en penses ».
Si c’est la promesse de fin d’article qui te hérisse, je la clarifie : je garantis que l’expérience sera transformative parce qu’instructive, c’est tout.
si je peux me joindre à vos échanges –je trouve très utiles les conseils de Lionel. Moi justement je suis du genre à renoncer parce que je ne trouve pas le temps, à moins que ce ne soit : je ne trouve pas le temps parce que j’ai peur de commencer. je vais essayer, quelques petites minutes par jour. Merci Lionel
Merci à vous Chris, et bienvenue par ici ! 🙂
Merci pour ce très bon article. Je m’y reconnais bien là.
Père de famille nombreuse, même en travaillant à domicile je peine à m’imposer le temps d’écrire. J’en culpabiliserai presque ! D’un côté je ne parviens à lâcher prise que s’il n’y a rien à faire (mais dans une grande et vieille maison, il y a toujours à faire ! ), et d’autre part je déprime littéralement si je n’ai pas pu écrire une ligne de la journée. Une journée sans écrire est une journée foutue. Alors quand il m’arrive de ne pas écrire plusieurs jours de suite parce que voilà, le quotidien prend le dessus, je suis de très mauvaise humeur !
Bref. Malgré tout, en se sortant les doigts du Q, je suis parvenu à produire deux livres de fantasy steampunk et un roman jeunesse. Je n’en suis pas peu fier. Le hic ? Je suis accro maintenant ! Et pour ne rien arranger à mes affaires, j’ai lancé sur orbite un blog d’auteur #ModeMasoActive.
Merci pour ton blog, source d’inspiration pour auteurs plus ou moins chevronnés.
[…] que je désirais. (C’est en partie de cette réflexion qu’est née mon habitude de toucher mon histoire tous les jours, même au milieu d’autres projets.) Ce n’était pas une question de scénario, mais […]
Exactement ce dont j’avais besoin. J’étais partie sur une lancée similaire ces derniers temps en me donnant pour objectif de réfléchir chaque jour quel « temps » je voulais accorder à mon histoire dans la journée (peu importe si ce n’était qu’un nombre de mots, un temps à dégager pour écrire), mais je me suis vite perdue en ayant parfois l’impression de trop me mettre la pression, parce que même l’objectif de mille mots que j’arrive à sortir aisément une fois concentrée me semblait bien trop haut à atteindre, je ne faisais donc… rien.
Donc merci, ça me déculpabilise. Peu importe ce qu’on fait, c’est le moyen qui compte : « Tu n’as aucune obligation de résultat, seulement une obligation de moyens : te mettre devant le clavier. » Voilà ce que j’avais besoin d’entendre, c’est parfait ! Merci !
OUI ! Et ça marche avec n’importe quel métier de création en autonomie. Depuis que j’ai lu ton article l’année dernière je le fais régulièrement et je plussoie : c’est encore plus dur de recommencer quand on a arrêté même une journée. S’assoir dans son atelier tout les jours, même deux minutes, même en se demandant « mais qu’est ce que je vais faire ? », ça marche.
Aaah, je suis vraiment content que tu en tires des bénéfices ! Merci pour ton retour enthousiaste, c’est que j’espère arriver à partager. En plus je crois que c’est comme ça qu’on génère une addiction… positive! 🙂
Il me semble bien oui. J’ai écouté un podcast sur France Inter qui parlait de la motivation (que je conseille !) et de la notion de flow, qui est addictif donc. Ça doit être ça :).
Certainement !
Amen!
Il me reste un mois et demi pour soumettre une nouvelle que je n’ai pas encore entamée — il est plus… https://t.co/cCREHxTeIv
Un combat permanent pour moi :/
Courage. Une phrase! 🙂
Mon prof de français au lycée disait toujours « pas un jour sans une ligne ». C’était pas la cocaïne alors ? :p
L’un n’est pas censé entraîner l’autre (quel que soit le sens qu’on préfère)…
La créativité est un muscle, oui, mais que le message est souvent difficile à faire passer ! Merci pour cet article très clair 🙂