Auguste lectorat, petit résumé rapide des épisodes précédents. Depuis une petite année, il y a un mouvement dans le milieu de littératures de l’imaginaire qui part d’un simple constat :
- L’imaginaire est la culture populaire dominante de très, très loin (au cinéma et dans le jeu vidéo, notamment – Star Wars, Harry Potter, Game of Thrones, Warcraft…)
- Mais nos littératures, tout spécialement d’expression française, luttent pour exister, par exemple dans les grands médias.
Donc, on fait quoi ? Comme l’a très justement exprimé Jérôme Vincent des éditions ActuSF, on commence par rassembler des chiffres afin d’obtenir une vision objective de la situation, pour déterminer, notamment, si ce « plafond de verre » est une réalité ou bien un ressenti.
Ce travail a été conduit pendant une grande part de l’année 2017 et des résultats préliminaires ont été proposés aux Utopiales lors d’une session appelée les États Généraux de l’Imaginaire.
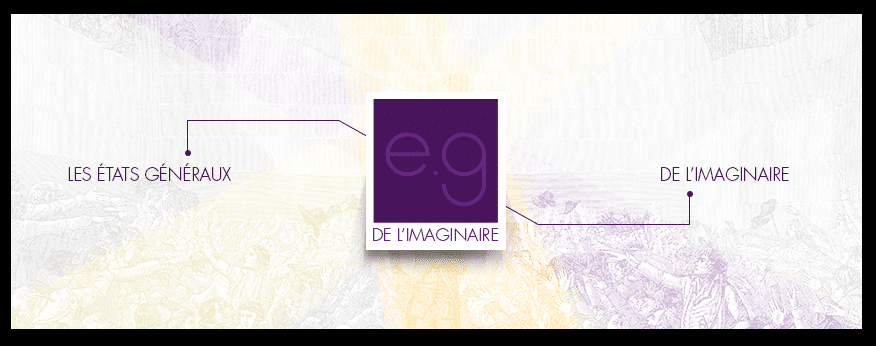
Visuel par Zariel
Loin de moi l’idée de résumer ce qui s’est dit – les comptes-rendus seront accessibles bientôt ; on peut déjà tout réécouter ici – mais, en gros : oui, le plafond de verre n’est pas qu’un ressenti, il y a un déficit manifeste, par exemple, de la représentation de nos genres dans les médias généralistes. Dès lors, la question se pose : que faire ?
Et je voudrais revenir sur une idée que j’ai vu flotter dans les préparatifs, qui a été reprise pendant la matinée, et que je vois flotter encore dans la presse – et c’est l’idée de faire une rentrée littéraire de l’imaginaire sur le modèle de ce qui se fait en littérature générale, afin de faire un coup de communication et de donner une visibilité aux genres.
Et pour ma part, ça n’engage évidemment que moi, mais pour poursuivre le débat, j’aimerais dire, en substance, que : oh mon dieu, non, surtout pas1.
Pourquoi c’est une mauvaise idée
Mon expérience est nécessairement limitée, mais j’ai fait un détour hors collections d’imaginaire identifiées il y a quelques années avec la trilogie Léviathan (même si c’est de la fantasy urbaine déguisée en thriller, hein) et j’ai eu l’occasion de discuter avec quelques éditeurs de l’autre côté du plafond de verre. Et notamment de cette fameuse rentrée littéraire identifiée. Bien sûr, ce que j’en rapporte est nécessairement biaisé par mes interlocuteurs, mais quand on observe le fonctionnement de cette période, ce qu’on m’en a dit me paraît assez juste.
Et cette analyse est la suivante : la rentrée littéraire, c’est la roulette russe, c’est l’abattoir.
Des centaines de productions débarquent d’un coup sur les étals des libraires. C’est la lutte pour se faire une place au soleil – à commencer… par l’espace en rayonnages. Une des difficultés de la librairie, il faut le savoir, c’est que la place en linéaire n’est pas extensible – elle est souvent très limitée, au contraire, et un livre a très peu de temps pour être vu en rayon avant de disparaître dans les étagères, puis de sortir du stock. La rentrée littéraire ne fait qu’aggraver le problème. Sans parler, évidemment, de l’espace disponible dans les médias pour en parler, et, bien sûr, du temps des gens – qui n’ont pas la possibilité de lire 200 bouquins en un mois…
En conséquence, une proportion alarmante de ces livres fait de gros échecs commerciaux (quelques centaines de ventes), par rapport aux moyens employés. Ceux-là sont écartés, oubliés ; en revanche, dès que quelque chose frémit, les départements de communication misent dessus, s’efforcent d’avoir les meilleurs relais de presse (télés et radios nationales, par exemple). C’est donc un jeu puissamment risqué, où l’on accepte de perdre gros pour gagner gros sur les succès de la rentrée. (Bien sûr, je ne suggère pas que c’est entièrement incontrôlé de la part des éditeurs – il y a des stratégies réfléchies – mais si les stratégies marchaient à tous les coups dans cette industrie, on ne ferait que des best-sellers ; l’aspect risque de la pratique est indéniable.)
Cette analyse a été confirmée le matin même aux États Généraux par, si ma mémoire est bonne, une libraire – pour eux, c’est un cauchemar de manutention, de gestion de stocks, de promotion…
Maintenant, considérons l’imaginaire, dont le paysage est composé d’une part non négligeable de petites structures indépendantes totalisant au maximum une dizaine d’employés. Gallimard, Grasset, Le Seuil ont les reins assez solides pour s’affronter lors de la rentrée littéraire, mais nous ? Sachant que les premières années d’une telle pratique, en plus, peineront à porter de quelconques fruits puisque nous affrontons ce plafond de verre et que rien n’assure déjà une place en relais médiatiques à un livre de littérature générale – alors, d’imaginaire ?
Mon humble avis est le suivant : c’est du suicide.
Bâtissons sur nos forces
On fait quoi, du coup ?
On est malins : voilà ce qu’on fait. On réfléchit à ce que nous sommes, ce que nous apportons à notre public, pourquoi il nous suit, ce qui nous différencie dans ce que nous avons de meilleur, et nous bâtissons sur nos forces. « Nos » comme dans « nous tous », peuple de la SF2 ou de l’imaginaire, auteurs, traducteurs, éditeurs, diffuseurs, libraires, lecteurs, blogueurs, etc.
Et ce que nous avons qui me semble assez unique, et c’est une littérature vivante. J’entends par là qu’il y a un tissu d’événements, de rencontres, d’animations qui, à mon sens, est sans commune mesure avec ce qui se fait ailleurs en littérature (ce qui a d’ailleurs posé problème avec la rémunération imposée par le CNL en festivals). En général, les auteurs d’imaginaire sont proches de leur public, de la communauté. Les librairies spécialisées s’en sortent plutôt bien dans le paysage du métier, car elles font vivre leur activité en organisant des rencontres, en fédérant du public, en organisant autant des lieux de rencontre, presque de communauté, qu’elles font tourner des commerces.
Or nous, en tant que genres, qu’aimerions-nous faire ? Être mieux connus du public. Être traités d’une manière qui reflète notre poids économique réel (qui n’est pas négligeable si l’on considère l’édition française, qui devient ridiculement écrasant quand on parle « d’imaginaire » toutes catégories confondues) et réussir à vaincre les a priori résultant de l’ignorance dont nos genres souffrent. Casser le plafond de verre, quoi. Bien sûr, les médias, les relais d’opinion sont des alliés de premier plan dans cette quête, mais nous voulons, in fine, parler aux gens.
Pourquoi, donc, ne pas parler… aux gens ?
J’ai régulièrement eu des expériences similaires quand j’ai commencé à faire des interventions : les gens m’ont parlé de notre étonnante accessibilité, à nous, les auteurs d’imaginaire. Pourquoi ne le serions-nous pas ? Eh bien, parce qu’un auteur, c’est dans sa tour d’ivoire, c’est une personnalité intellectuelle distante, ou encore, c’est mort depuis des siècles (on m’a vraiment dit ça) (remarquez, c’est une excellente raison d’être inaccessible).
Pour moi, une initiative bien plus prometteuse, qui se fonde sur nos forces, qui fait vivre la littérature et la porte chez les gens avec d’excellents messagers – ceux qui la font, auteurs, éditeurs, etc. – c’est le mois de l’imaginaire.

Il ne s’agit pas prioritairement de vendre des bouquins (même si on n’est jamais contre, allez). Il s’agit de susciter un élan, un engouement, un enthousiasme, ouais, à travers des rencontres, des événements, des animations, des formations. D’aller vers les gens, d’ouvrir le plus grand possible les portes de la maison. C’était la première édition cette année, et donc il reste des choses à affiner, on n’a pas encore de grand recul sur l’opération, mais en Bretagne, à Rennes, de ce que j’en ai vu, ça a plutôt bien marché. Nous avons rencontré des acteurs nouveaux, qui avaient envie de partenariats, mais avec qui il manquait les contacts, par exemple. Le public a montré son enthousiasme. Ça a été un boulot de dingue pour toutes les forces motrices de l’événement3 mais cela me semble un modèle bien plus pertinent que d’envoyer des centaines de productions sur les étals dans l’espoir que certaines s’enracinent et d’avoir de la promotion. La dynamique économique ne fonctionne pas comme ça pour nous (et nous n’avons pas les finances pour nous risquer à ce jeu-là). Nos best-sellers fonctionnent sur des plans différents, assez souvent liés à des adaptations à succès, par exemple.
Notre littérature montre sa vigueur et sa vie à travers ses événements, sa proximité, l’humanisme qu’elle prêche, l’évasion qu’elle procure et les réflexions qu’elle ouvre. Nous sommes une communauté investie et passionnée. Capitalisons là-dessus en donnant envie de lire et de voyager, et en prenant notre bâton de pèlerin et en allant le montrer, et en travaillant tous ensemble, professionnels et publics, à accueillir de nouveaux invités dans la maison, par nos recommandations judicieuses de livres, notre implication, notre pédagogie, nos événements, et, très important, notre accessibilité, sociale bien sûr, mais intellectuelle aussi (on se moque de savoir si Harry Potter est de la fantasy ou du fantastique : c’est une discussion d’initiés, et il faut accepter de lâcher prise sur nos cultures d’initiés dès qu’on sort un tant soit peu du domaine).
Pour moi, l’imaginaire, c’est comme le jazz. Il y a de fantastiques caves où des musiciens incroyables jouent pour trente personnes. Il faut les connaître, et ce plaisir de connaisseur fait partie, pour beaucoup, de l’itinéraire. On adore se demander si ce saxophoniste sino-norvégien fait du metal acid Detroit jazz ou du blue trippy batcave jazz. Pas de problème ! En même temps, paradoxalement, tout le monde connaît Miles Davis (= Game of Thrones), peut-être sans l’avoir jamais écouté. Si l’on veut faire connaître le jazz, on explique aux gens par où continuer après Miles Davis, en fonction de ce qu’ils veulent trouver, on défriche le terrain, on organise des événements agréables et accessibles autour du genre pour montrer, faire plaisir, donner envie, et on reste prudent avec les finesses de spécialiste (qui peuvent s’exprimer dans d’autres espaces). On va vers les gens, on les guide – on les invite. Même si cela nous conduit à répéter cent fois par an les définitions de base. Être blasé est interdit, car chaque interlocuteur qui découvre les entend pour la première fois, et nous voulons partager la passion, non ?
Une chose est sûre, en revanche : ce qu’on ne fait pas pour promouvoir le jazz, c’est sortir cinquante disques d’un coup en période de Star Academy.
Donc, ne faisons pas une rentrée littéraire, s’il vous plaît.



Si la rentrée littéraire disaparaissait nous serions plus visibles. Et la rentrée littéraire c’est une aberration française des éditeurs de blanche qui veulent empêcher le développement des littératures de genre.
Faut arrêter avec les théories du complot là hein…
C’est pas une théorie du complot. À l’origine dans les années 70, c’était la lutte contre ce qui était vécu par certains comme une américanisation de la culture française. Il fallait sauver un certain modèle culturel. Et le but était de crier plus fort que les littératures de genre en créant un événement mettant en avant ce soit disant modèle français.
Grâce à la rentrée littéraire, toute la presse parle de littérature pendant un mois de l’année. S’il n’y avait pas ça, on ne parlerait que des bouquins qui ont des prix, et on oublierait la littérature (de genre ou pas) en la cantonnant aux rubriques spécialisées.
C’est ridicule d’opposer les genres, ce n’est pas comme ça qu’on va avancer, il faudrait le comprendre une bonne fois pour toute. J’ai rarement entendu aussi ridicule qu’uncomplot de la rentrée littéraire contre l’imaginaire !
S’il y a opposition c’est dans la représentation de la littérature de genre dans les média face à la blanche. C’est un fait qui sera argumenté et appuyé de données lorsque le retour des états généraux de l’imaginaire qui c’est tenu ce mois-ci aux utopiale sera rendu public.
Absolument d’accord avec ce billet !
Bon, l’année prochaine il faudra que je relance le Challenge Francofou sur mon blog… qui commençait justement en octobre…
Tans que les média de masse ne s’emparent pas de ce mois de l’imaginaire, il y a peu de chance que les éditeurs « mainstream » soit tenté d’en faire une rentrée littéraire. Mais si finalement (et c’est tout le mal que je souhaite) les médias s’intéressaient au auteurs de livres de genre. Est-ce que tu penses vraiment qu’on pourrait enrayer une flambée de sortie ? Il me semble que la mécanique commerciale liée au média foutra la merde de la même façon. Je vois la dégénérescence du marché de la BD de ce point de vue et c’est pas bien beau.
Je me sens assez trippy batcave jazz ???? Merci pour cet article très juste et l’idée de littérature vivante.
Tout à fait d’accord sur le côté « vivant » de notre courant littéraire, et sur le côté accessible des auteurs. Outre que nous sommes naturellement des gens sympas ;), ça me parait aussi le fruit d’un contexte : nous sommes un petit milieu où les gens se connaissent, échangent des idées, aiment se lire les uns les autres et rebondir sur des idées pour explorer ensemble de nouvelles voies ; et par ailleurs nous sommes habitués à une dynamique de conventions où les gens se parlent facilement, dans un climat convivial, entre passionnés. En fait, mis à part le fait que nous sommes auteurs, nous sommes aussi des lecteurs parmi d’autres lecteurs. Nos complicités sont perceptibles dans nos tables rondes, et pourvu que nous ne planions pas trop haut, je pense que le public le sent et l’apprécie. J’ajouterais qu’en bons rôlistes, nombre d’entre nous sont capables de livrer un autre type de prestation « live », fort appréciée : les lectures publiques. Qui sont une belle occasion de rendre la littérature vivante.
Je reviens d’une convention Geek à Bayeux, fort axée jeu vidéo et Cosplay, et encore une fois, je suis positivement surpris des bonnes ventes, de la curiosité du public, de son intérêt pour les romans de fantasy. Même impression lors de plusieurs fêtes médiévales couplées à des petits salons littéraires. Conquérir le public de la littérature blanche est un enjeu ; mais il me semble qu’il y a un enjeu encore plus direct à conquérir davantage un public qui est largement acquis aux univers imaginaires, joue, pratique le cosplay et vibre avec Game of Thrones, mais lit très peu (et ne connait souvent que les plus grosses pointures). Les événements qui croisent les supports (jeux, BD, romans, jeux de rôle, musique, Cosplay, GN…) sont un terrain très favorable pour ça, et ça marche ! Je pense à Trolls et légendes, en Belgique, aux Utos (pour la SF), mais aussi à des événements dont nous sommes absents, comme Cidre et Dragon, en Normandie (30 000 visiteurs, un nombre de cosplays hallucinant, un vaste marché « médiéval » où les gens claquent de la thune à tout va).
Complètement d’accord avec toi! Nous pouvons porter une image agréable et plaisante de la lecture, qui a hélas un peu déserté le grand public.
Soyons inconvenants, parlons chiffres : ce WE, à Geekorama Bayeux, en comparant le nombre d’entrées de la convention et le nombre de bouquins que j’ai vendu, je suis arrivé à la conclusion qu’un visiteur sur 30 (à la grosse louche) m’avait acheté au moins un livre. C’est une proportion que je trouve positivement surprenante, surtout compte tenu de la nature de la convention (axée jeux vidéos et cosplay) et de la présence de nombreuses familles (je ne suis pas précisément un auteur jeunesse) : même si j’étais le seul auteur roman présent pour « capter » ce public, il y avait tout de même des auteurs BD et moult autres façon de dépenser ses sous. Bref, oui, ce type d’événements a un potentiel important, il me semble.
« Bref, oui, ce type d’événements a un potentiel important, il me semble. »
Tout à fait d’accord, d’autant plus que c’est plus intéressant à la fois pour les auteurs et pour le public.
Y’a qu’à comparer aux mornes plateaux télé des auteurs « classiques » qui sont par ailleurs inaccessibles, comme le disait Lionel dans son billet.
(à ce propos, être mort n’est pas une excuse : qui te dis que Voltaire n’est pas une liche qui continue à écrire et publier sous pseudo ? Bon, après, je sais, les morts-vivants c’est généralement peu sociable et pas très présentable au grand public 😛 )
Souvent ils s’intéressent plus à la fantasy qu’à la SF. J’ai fait un événement comme ça. Il semble que les gens venaient pour de la fantasy et que la SF les touchaient moins. Et j’ai moins vendu qu’aux Aventuriales.
Totalement d’accord avec toi à propos d’une rentrée littéraire de l’Imaginaire.
Tu encourages le mois de l’Imaginaire, qui est une excellente initiative, j’en conviens. Toutefois, ce que j’ai vu durant ce mois d’octobre a surtout été des promotions et des concours organisés par les éditeurs et principalement pour parler d’auteurs anglophones. Ce mois d’octobre n’a, finalement, pas fait tomber les barrières habituelles que l’on a entre éditeurs/auteurs et lecteurs puisqu’il y a eu peu de contacts directs entre les personnes. Personnellement, en tant que lectrice et blogueuse, j’ai surtout vécu cet événement via facebook avec mon mur qui a été inondé de publicités de maisons d’édition. J’en ai même à peine entendu parler sur booktube ! C’est vrai que je n’ai pu faire aucun salon durant cette période et que je ne sais pas quelle ampleur le mois de l’Imaginaire y a pris, mais mon ressenti a surtout été qu’on a essayé de me vendre encore plus de best-sellers…
Et je trouve ça vraiment malheureux que ce mois de l’Imaginaire ait plus ressemblé à une grosse opération commerciale qu’à un réel échange entre lecteurs, auteurs, blogueurs, youtubeurs, libraires et éditeurs.
Je m’attendais à avoir plus de communication de la part des maisons d’édition et des auteurs, qu’il y une sorte de « forcing » dans les médias et sur les réseaux sociaux et… rien ! Juste des pubs, des promo et des concours…
Quant à promouvoir cette littérature francophone de l’Imaginaire méconnue, j’ai lancé en 2016 le Printemps de l’Imaginaire francophone qui est un challenge de lecture et d’échange autour de la SFFF francophone.
Pour ce challenge, j’encourage les participant-e-s à sortir de leur zone de confort anglophone pour ne découvrir que du francophone et, surtout, à en parler autour d’eux via leur blog, leur chaîne youtube, leur profil facebook, en laissant des avis sur les bibliothèques en ligne,… Parce que je suis profondément convaincue que le sort de l’Imaginaire francophone est entre les mains des lecteurs/-trices avant d’être dans celles des éditeurs.
Article très intéressant, qui donne un regain d’espoir pour que le monde de l’imaginaire SFFF francophone, notamment littéraire, perce un peu ce voile épais qui nous cache aux yeux de certains. Le mois de l’imaginaire est selon moi un concept intéressant à creuser. Peut-être cette année n’a-t-il pas eu la portée espérée, peut-être a-t-il eu une connotation encore trop promotionnelle, mais je pense qu’il est possible de réfléchir à quoi en faire pour que notre voix porte enfin. Les choses bougent, nous le voyons pour l’image du jeu video (nous avons d’ailleurs un député ancien joueur de WoW :P), par exemple. Nous pouvons peut-être faire évoluer aussi notre image aux yeux du grand public pour mieux le rencontrer.
Hello !
Je partage les analyses et ressentis de Lionel Davoust et de Stefan Platteau. Et pour ma part, je verrais plutôt dans cette première édition du « mois de l’imaginaire » le verre à moitié plein. Les éditeurs spécialisés ont donné le ton, d’autres maison sont suivi : en 2018 (et après), ce sera aux festivals, blogs, revues et lecteurs de réfléchir également à ce que nous pourrions faire ensemble, mais aussi sur nos lieux de vie et de travail.
Les Imaginales ont modestement conclu un premier partenariat avec un festival généraliste (eh oui !) lorrain, « Le Livre à Metz » :
http://www.lelivreametz.com
Créé en 1987, ce festival « permet de croiser les expériences et d’explorer le réel en offrant un large panorama des questions d’actualité. » Quel rapport avec l’imaginaire ? Eh bien, ensemble, on a trouvé ! On a d’abord organisé, en octobre 2017, à Metz, une table ronde avec Estelle Faye, Jean-Philippe Jaworski et Stefan Plateau (j’ai eu le plaisir de l’animer). En mars 2018, on organisera, cette fois-ci à Épinal, une rencontre du même genre, avec nos partenaires messins, autour de leur thème 2018.
Si on se met à travailler avec des festivals “réalistes”, que ne pourrions-nous pas faire entre festivals d’imaginaire ? C’est le sens de l’appel que j’ai lancé à Nantes, début novembre.
Alors, on s’y met tous ?
Alors, la question con, c’est quoi, dans les faits – événements, sorties de livres, animations, actions, etc – entre LA rentrée littéraire et une rentrée à notre sauce ? (Sinon, merci d’avoir cité Roland 🙂 )
[…] Comme vous le savez peut-être, le monde de la littérature est marqué par deux rentrées : la Rentrée Littéraire (à laquelle je mets volontairement des majuscules), qui a lieu, peu ou prou, de fin août à début octobre, puis la rentrée littéraire d’hiver, son pâle reflet, en début d’année civile – et qui n’a été mise en place que pour relancer des ventes plus que moroses après la période des fêtes. Pour mémoire, la rentrée littéraire 2017, c’était pas loin de 600 romans publiés et mis en vente en même temps. Ce qui nous amène au titre d’un récent article de Lionel Davoust, que j’approuve à 200% : Ne faisons (surtout) pas une rentrée littéraire de l’imaginaire. […]