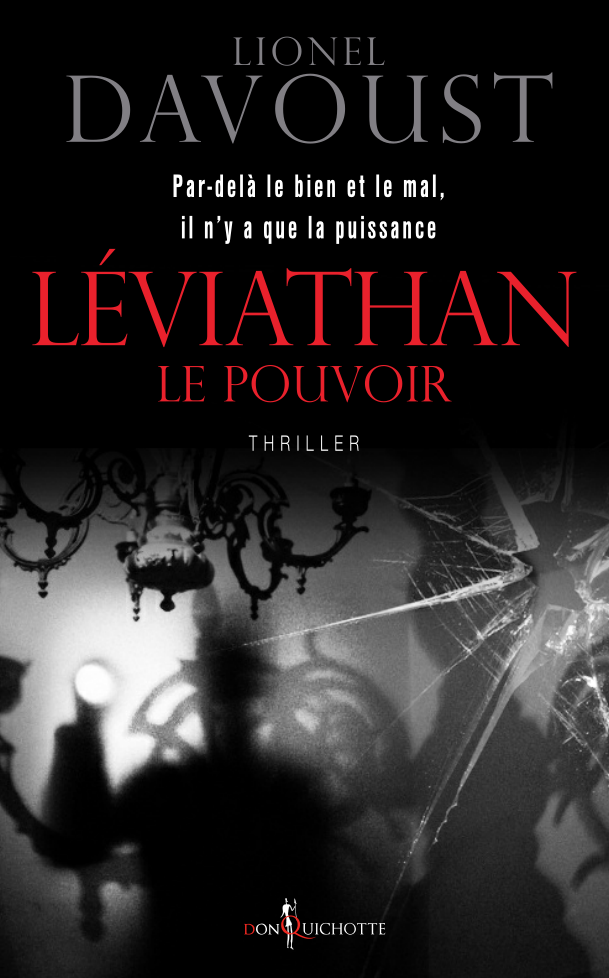Comment j’ai écrit ma meilleure scène de torture
Tiens, comme on fait dans la saison 3 de Procrastination un épisode sur le sous-texte, une petite anecdote d’écriture qui me revient de loin en loin, sur l’importance de la place laissée au lecteur : c’est un conseil central fréquemment donné, de suggérer plutôt que de montrer explicitement, de laisser le lecteur habiter le récit, en gros de lui donner la place de projeter ses propres images, ce qui est beaucoup plus efficace que de tout dire : le rôle de la littérature n’est pas tant de cadrer et de raconter que d’évoquer et d’emmener le lecteur en promenade.
L’anecdote, donc. À l’issue de Léviathan : le Pouvoir, on m’a fréquemment reparlé (et cela arrive encore aujourd’hui) d’une certaine scène de torture d’un personnage aimé des lecteurs (attention, quelques léger spoilers à suivre). De son horreur viscérale, de la terreur qu’elle représente. Cela fait évidemment très plaisir quand un lecteur vous dit qu’il a fait des cauchemars par votre faute (ouais, on fait un métier bizarre) : ça veut dire que vous avez réussi votre coup.
J’ai failli intituler cet article « comment j’ai écrit la scène de torture parfaite », sauf que ça aurait vraiment trop fait putàclic, alors je me suis abstenu, mais cela aurait été pourtant la vérité : car cette scène, en réalité, n’existe pas. Si vous avez lu la série, vous pouvez la chercher. Ce qui se passe, c’est que je la suggère entièrement. J’utilise un antagoniste dont j’ai amplement montré la puissance de nocivité, je tabasse un peu mon personnage chéri, d’accord… mais presque tout le reste (hormis la torture psychologique, mais c’est une autre histoire) se déroule hors caméra, appuyé par des hurlements provenant de la cave.
Quand on le retrouve, il est totalement brisé (… en ayant subi des tourments supplémentaires dont on ne sait que les marques). La scène est horrible et parfaite non pas parce que je l’ai écrite, mais parce que j’ai triché éhontément – j’ai pris soin de laisser le lecteur plaquer dessus ses propres terreurs et épouvantes. Elle est donc forcément parfaite, puisqu’en réalité, elle n’existe pas – elle invite chacun à investir les événements de ses cauchemars personnels.
Ce n’est pas un truc qu’on peut faire quinze fois par livre, mais se reposer sur le hors-champ, en cinéma comme en littérature, est une des techniques les plus éprouvées. L’exemple fréquemment cité dans le cinéma, Alien, fonctionne parce qu’on ne voit jamais la créature ; sa révélation, c’est comme sortir le lapin du chapeau à la fin du tour de magie – c’est le dénouement, mais en même temps, c’est la fin du jeu. C’est ouvrir la boîte de Schrödinger et résoudre l’indétermination. La boîte est intéressante parce qu’elle est fermée, qu’on s’interroge ; et si l’on ne s’interroge pas sur la fin d’un livre, pourquoi lire ?
Sans aller jusqu’à un cas extrême comme suggérer un pan d’action, cet espace est indispensable à ménager à tous les niveaux de l’écriture, il me semble. Le travail de l’écrivain me semble reposer presque entièrement sur le sous-texte, comme on en avait déjà parlé dans le cas de la traduction.