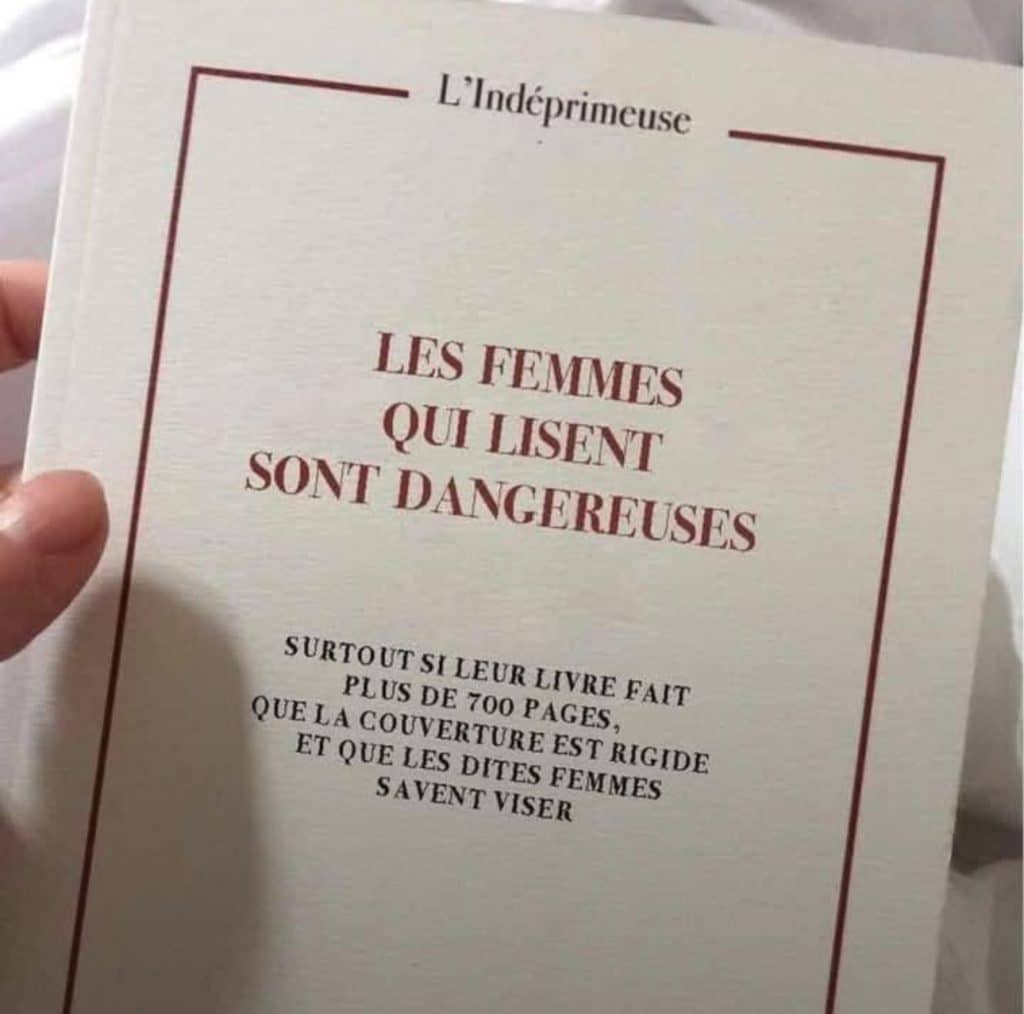Un petit message de service que je pose là : tout usage non autorisé par un contrat d’édition est formellement… eh bien… non autorisé. Je n’ai nulle envie d’aller focaliser une ire quelconque contre une structure en particulier donc je tairai les détails de l’affaire dont il est question (et pour laquelle j’ai soigneusement laissé couler les ponts), cependant elle a été suffisamment à la fois lunaire et agaçante pour en faire un rappel formel et général à l’usage des plus jeunes.
Un contrat d’édition encadre et définit les droits sur son œuvre que l’auteur·ice cède à la maison d’édition, comportant notamment périmètre, durée et rémunération, en échange de l’exploration de ladite œuvre par ladite maison d’édition. En général, ledit périmètre concerne un ouvrage donné : on cède un roman ou une collection de textes, ou bien une nouvelle dans un ouvrage collectif. En France, il est très fréquent que l’éditeur représente l’œuvre dans des éditions dérivées (notamment le poche), et c’est explicitement mentionné au contrat.
Cela ne signifie pas que la maison d’édition a tout droit sur les textes qui lui sont confiés, qu’elle peut en disposer pour des ouvrages distincts qu’elle publie sans accord ni rémunération (sans même parler de la base : informer l’auteur !).
Tout usage non prévu au contrat est purement et simplement illégal. De la même façon que la loi définit clairement ce qu’on peut, ou ne pas faire : on ne peut pas traverser à moitié en-dehors des clous. On ne peut pas faire n’importe quoi, et ça doit donc se régler obligatoirement en trois volets incompressibles : a) pardon, b) voilà une proposition de compensation (même symbolique), c) on ne le refera plus. Une erreur arrive. On peut s’entendre.
En revanche, toute autre réaction signe une rupture grave de confiance (puisque plus rien n’encadre quoi que ce soit, que ce soit le business ou la courtoisie), et doit probablement donc se solder par la rupture de la collaboration.