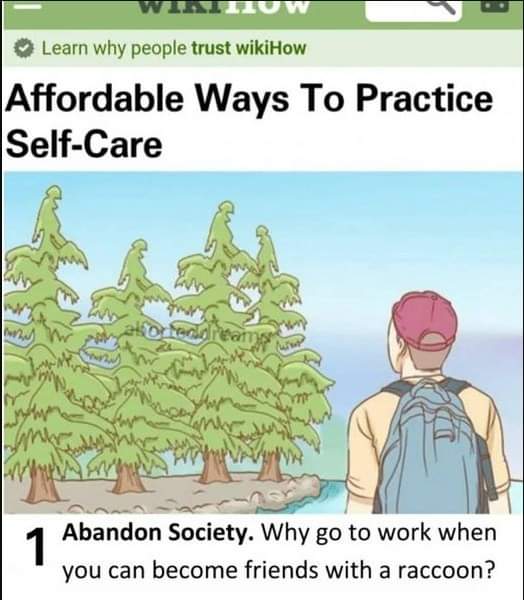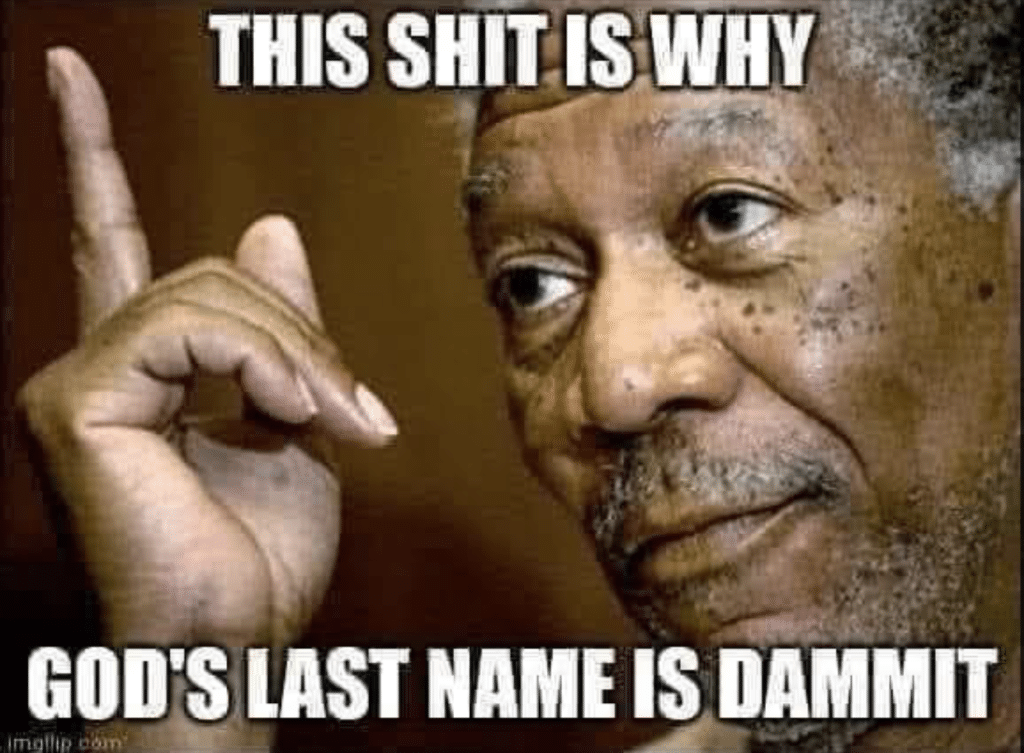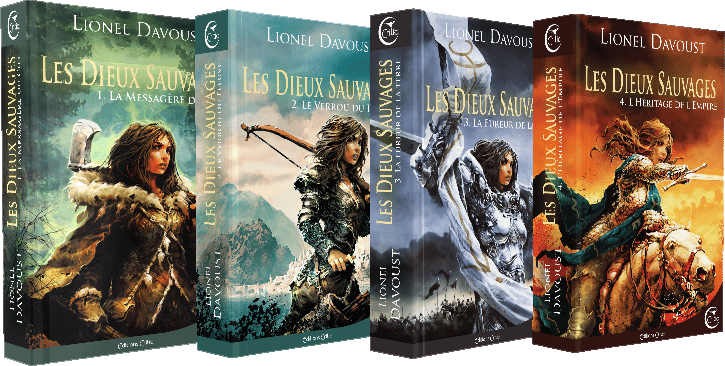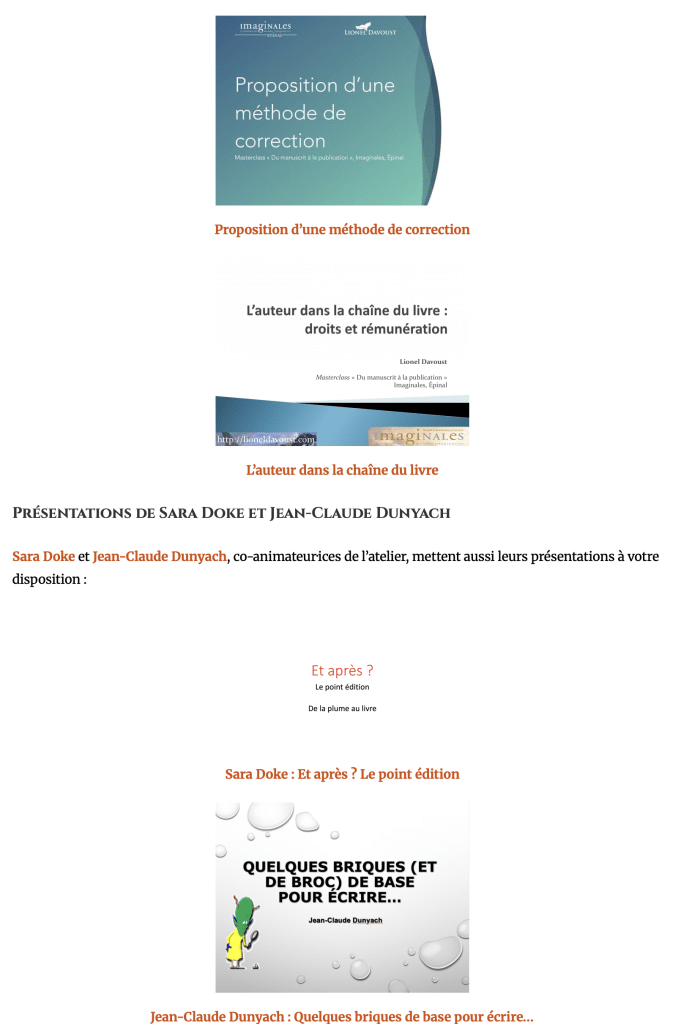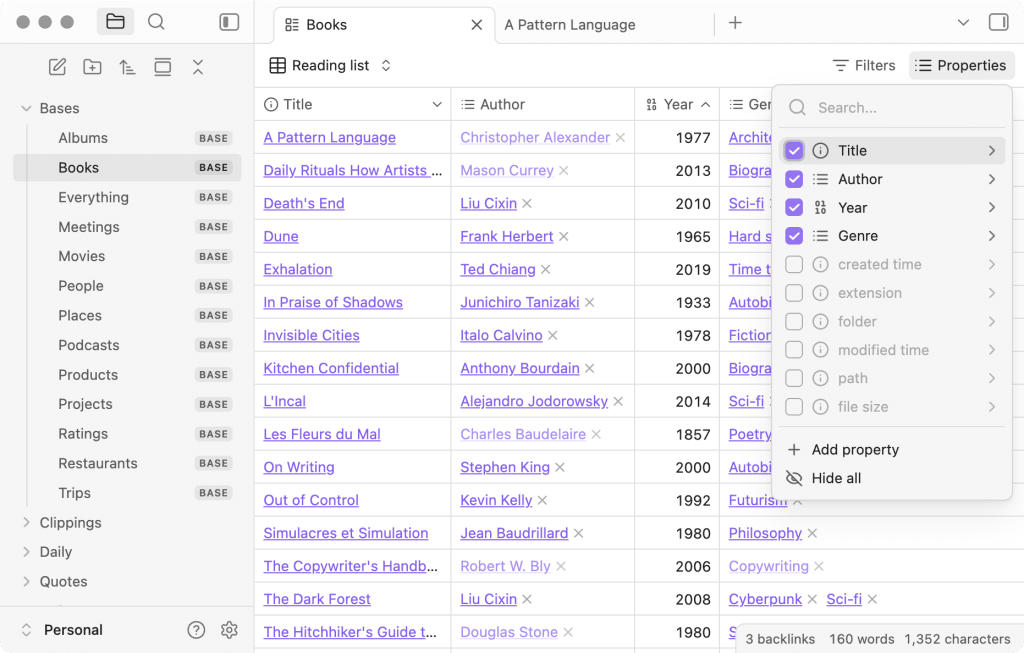Le Zettel de la quinzaine : Un plan peut être dit ou bien fait, mais pas les deux (202411141608)
Je tente un truc. J’ai évidemment quantité de notes sur l’écriture dans mon Zettelkasten, dont beaucoup sont mal fichues, et gagneraient à être toilettées. Pas mal de concepts qui s’y trouvent pourraient être utiles au plus grand nombre. Je vais donc tenter de partager une « fiche » régulièrement – je dis « de la quinzaine », mais ne prenez pas encore ça comme une promesse. D’autre part, la rédaction reste à la base pour mon seul bénéfice, et pourra être reformulée ou amputée de parties que je juge confidentielles à mon gré. C’est une expérience.
Une action dramatisée est racontée par son déroulement même, donc en annoncer le projet en amont, sans surprise ni variation, est superflu.
Inversement, une action annoncée en amont ne gagne rien à être dramatisée telle quelle, c’est une redite.
Par conséquent, une action peut être annoncée ou bien faite, mais pas les deux. Parce que ça fait double emploi, donc c’est inutile et chiant.
Il vient qu’[[Une action annoncée qui se déroule comme prévu sera avantageusement occultée dans la dramatisation]].
Si on mentionne cependant l’action deux fois, il faut donc un degré de variation. Par exemple :
- Ce qui est annoncé n’est pas conforme à ce qui se déroule ensuite ; considérer que [[Un plan annoncé ne peut pas se dérouler comme prévu]].
- On ne dit pas tout en amont pour créer du mystère ; par exemple, on peut à la place montrer les problèmes sans les résoudre (on le verra dans la dramatisation). C’est aussi un bon endroit pour introduire subtilement un maximum d’éléments de mise en scène et de décor, qu’on n’aura du coup plus besoin de réétablir. Très utile avec des mises en scènes complexes.