En un beau matin, de juillet, Robert G. Forge pose une fort bonne question, née de la lecture d’un article d’Atlantico avec un titre qui fâche :
Pourquoi en 2013 parmi les 16 auteurs les plus riches aucun n'est français ? En abordant uniquement la formation et la diffusion des auteurs, je serai curieux de savoir qu'en pensent @Samanthabailly @lioneldavoust @Werbernard @ChattamMaxime https://t.co/mWR6S0osLp pic.twitter.com/M0m0Be3CMQ
— R.G. Forge – Auteur (@RobertGForge) July 31, 2018
Après quelques échanges sur Twitter, je me dis que la question vaut peut-être un fromage, sans doute, ou de développer un peu plus ce dont il est question. L’article d’Atlantico, ici, fait intervenir Mohammed Aïssaoui, journaliste au Figaro littéraire, et Antoine Bueno, écrivain et enseignant à Sciences Po. Et si globalement on y trouve des idées qui me semblent assez justes, mon humble point de vue avoué de « raconteur d’histoire » a envie de discuter un peu le bout de gras.
Pourquoi aucun des seize romanciers les plus riches du monde n’est-il français ? Parce que les Américains tiennent le haut du pavé. Pourquoi les Américains tiennent-ils le haut du pavé ? Parce que les Américains : domination culturelle mondiale, avantage de parler (et écrire) la langue que le monde entier lit, et donc peut acheter et faire traduire (voir les problématiques de traduction vers l’anglais). 250 millions d’Américains contre 65 Français (millions, hein, pas 65 tout court, hein), tu peux pas test. L’impact de la francophonie, dans le domaine du livre, reste une illusion, en tout cas dans l’imaginaire : à part en Belgique et en Suisse, nous nous exportons peu. Nos amis québécois nous lisent, mais avec plusieurs mois de retard sur les sorties, la faute au coût du transport (la mer, c’est moins cher). Quant aux marchés africains, ils sont presque inexistants.
Pour moi, on pourrait s’arrêter là, mais l’article continue sur une argumentation qui me paraît s’enliser sur les différences d’approches entre la narration à l’Américaine, qui serait efficace, technique, et l’école française d’atmosphère, existentielle, sociale. Rendons hommage à Antoine Bueno qui cite la SF et la fantasy parmi les littératures de genre ; mais opposer les deux me paraît passablement risqué, et passe surtout sous silence ce que l’imaginaire fait à peu près depuis toujours, surtout la science-fiction – à savoir : unir les deux. Si 1984 ou Le Meilleur des mondes ne parlent pas de société, tout en racontant une histoire, je veux bien qu’on me coupe l’Apple Pencil. Et, diantre, leur statut de classique ne serait-il pas dû au fait que, tiens, ces romans sont capables de porter un discours à travers une narration ?
Pour les intervenants, « ce qui, chez nous, est une niche [les genres], représente l’essentiel de la production littéraire américaine. Nos deux modèles sont tout simplement inversés. » Id est : le genre n’intéresserait pas le public français. Dans ce cas, je me demande quand même bien pourquoi les best-sellers, en France tout comme ailleurs, sont Game of Thrones, Fifty Shades, pourquoi les jeunes lecteurs se sont rués sur Harry Potter et aujourd’hui enquillent Hunger Games, Divergente, Labyrinthe. Merci aux auteurs de signaler que « nous avons d’excellents story-tellers » ! Mais on le constate, en imaginaire : les Américains dominent, encore et toujours, quand les francophones peinent à surnager (moins qu’il y a vingt ans, heureusement), et ce n’est pas faute du désintérêt de notre public pour les genres. Au contraire, leur renommée ici est écrasante, comme ailleurs. Tout le monde a entendu parler de GoT ou même de Star Wars ; je gage qu’il n’en est pas de même pour Katherine Pancol. Donc, ça intéresse drôlement du monde (et quid du jeu vidéo, vecteur de l’imaginaire par excellence ?). Cependant, merci de confirmer indirectement mon opinion volontairement provocatrice : or doncques, visiblement, le mainstream à la française ne raconte pas d’histoire. Hé, c’est pas moi qui l’ai dit.
Mais c’est surtout là que ça se gâte : les intervenants mettent en opposition la technique littéraire, laquelle s’apprend aux États-Unis, sous le terme peu flatteur de « faiseur », soit l’auteur qui connaît les ficelles, contre le fait qu’un auteur français n’apprend pas le métier (sauf qu’il l’apprend forcément un peu, même si c’est en-dehors de circuits officiels, nonobstant l’apparition de cursus d’enseignement depuis quelques années). Selon M. Aïssaoui, « il faut nécessairement une intrigue, un suspense et des rebondissements, de manière à en faire un “film écrit” ». Cette affirmation a autant de sens que dire qu’il faut des couleurs et des formes à un tableau : c’est amusant car c’est là que l’on voit peut-être transparaître, en filigrane et involontairement, une des clés de l’attitude du mainstream, justement, envers les genres et les raconteurs d’histoires. Et en quoi la littérature, dans notre beau pays, est justement considérée différemment de toutes les formes d’art, sans raison particulière. D’abord, qu’est-ce qu’un « film écrit » ? Doit-on comprendre que le film est inférieur au livre ; ou que tous les cinéastes sont des techniciens ; qu’il n’existe pas de film d’ambiance ? (Et le cinéma… français, alors ?) Mais ne soyons pas de mauvaise foi – il s’agit là de dire « comme un film hollywoodien avec des explosions », ce qui en dit long sur l’a priori des auteurs sur qui, exactement, domine le cinéma. Est-il nécessaire de prouver davantage l’hégémonie américaine ?
Et surtout, il faudrait nécessairement une intrigue ? Diantre, le vilain mot : est-ce à dire que la fiction devrait, eh bien, raconter une fiction ? Choc. Se pencherait-on sur le cas d’un compositeur ayant appris l’harmonie et s’interrogerait-on sur son œuvre, au titre qu’il lui faut nécessairement qu’elle sonne juste ? Se pencherait-on sur le cas d’un peintre ayant appris la perspective et s’interrogerait-on sur son œuvre au titre qu’il lui faut nécessairement réfléchir au choix des couleurs ? Alors bien sûr, on peut bafouer les règles – mais il vaut mieux connaître ce qu’on bafoue. Aucune technique artistique n’est une recette qui garantit l’efficacité et le succès : la technique consiste simplement à comprendre la grammaire de son art pour en faire ce que l’on souhaite et peut-être la repousser vers des terres encore vierges. Y avait un mec, en dessin c’était un gros tueur ; la moindre de ses esquisses était une masterclass à elle toute seule alors qu’il n’avait pas vingt ans ; et le mec, à force d’étudier son art, avec passion et investissement (il savait à peu près tout faire), eh bien il a genre inventé le cubisme, dis. On pourrait dire le même genre de chose de Bach, et tant d’autres à travers l’histoire.
Et je ne parle même pas des magnifiques romans d’ambiance de la SF et de la fantasy…
Alors ce n’est pas pour dire qu’il n’existe pas de romans formatés ; bien sûr – mais équivaloir en filigrane story-telling et livres écrits à la chaîne ; et faire reposer en partie l’inégalité des rayonnements de nos deux littératures là-dessus, non. D’une, ça n’a pas grand-chose à voir, de deux, apprendre à raconter une histoire n’est pas un péché, mais un devoir pour prendre soin de son lecteur. Sang-diable1, les contes reposent sur des motifs ancestraux qui sont là pour une raison : ils résonnent avec l’expérience humaine (voir l’épisode de Procrastination sur le monomythe, par exemple). Le savoir ne fait pas d’un auteur un tricheur desséché, mais quelqu’un qui cherche à comprendre l’outil avec lequel il travaille pour en faire quelque chose de plus.
Cet article tourne à la diatribe, et je ne voudrais pas qu’on pense que je m’en prends personnellement à MM. Aïssaoui et Bueno qui disent aussi des tas de choses fort agréables à lire sur la qualité des genres en France. Je prends ces petites phrases, que l’article a peut-être même raccourcies, pour m’envoler vers des hauteurs postillonnantes – mais il faudrait quand même qu’en France, on se débarrasse de cette opposition de façade entre le « Roman » avec une bon dieu de majuscule, et les genres : un bouquin de fiction, ça raconte une histoire, sinon c’est pas de la fiction, dammit. Et une histoire est plus ou moins bien ficelée, plus ou moins bien inventive et racontée.
Terminons donc sur deux points que j’approuve vigoureusement : oui, comme nous le répétons dès que nous en avons l’occasion avec Estelle Faye, capitalisons sur nos forces, nos spécificités, pour faire une belle et forte littérature qui a des trucs à raconter avec vigueur et créativité ! Et oui, putain2, le nouveau roman a carrément asséché la joie de vivre dans la littérature française.
- Ouais, je me cite si je veux. ↩
- T’as vu, auguste lectorat, je suis prêt à tout pour remonter mes stats de lecture. ↩

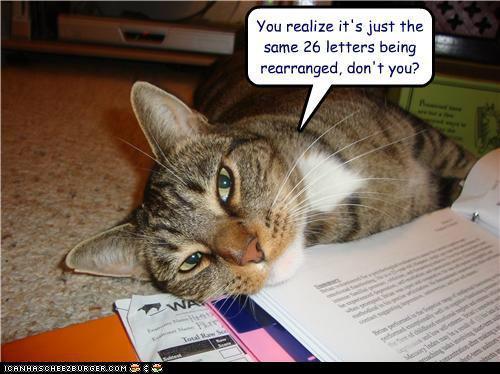


Outre que je suis complètement d’accord avec ce billet, je m’étonne quand même qu’on pose la question initiale en ces termes : genre, on semble s’insurger que les auteurs français ne soient pas dans le top des revenus. Rien que l’argument basique de la taille du lectorat suffit à répondre à cette question ! Les auteurs finlandais sont-ils de gros nuls en littérature, parce qu’ils ne sont pas riches ? Ma foi, sans doute qu’avec seulement 5,5 millions de lecteurs potentiels, ils auront bien du mal à gagner plus que nous. N’en déplaise à beaucoup de français, nous sommes un bien petit pays au niveau mondial. « L’impact de la francophonie, dans le domaine du livre, reste une illusion », comme dit Lionel Davoust.
Yep ! Et les Finlandais ont d’excellents auteurs de SF, d’ailleurs, qu’on commence à connaître sur la scène mondiale. Comment ? Ils écrivent en anglais, ou se font traduire eux-mêmes…
Le roman social aujourd’hui c’est le polar. La littérature blanche est celle de l’intime. Celle de égo malade, celle qui s’autoproclame du style mais qui est écrite avec un style proche du CM2. Bref si l’on veut faire bouger les lignes dans l’imaginaire arrêtons de faire des complexes d’infériorité par rapport à la blanche. Il y a des romans populaires dans nos genres qui sont mieux écrits que des romans de blanche.
Audrey Burki « La littérature blanche est celle de l’intime. Celle de égo malade, celle qui s’autoproclame du style mais qui est écrite avec un style proche du CM2 » : c’est complètement con et réducteur ce genre d’assertions pompeuses. Ce n’est pas en opposant les genres qu’on fera avancer les choses et réduire la blanche à l’intime démontre clairement que tu n’en lis jamais. C’est juste un courant et c’est loin d’être majoritaire. Les auteurs de blanche savent parfaitement raconter des histoires eux aussi et leur style n’a rien à envier aux auteurs d’imaginaire (au contraire parfois !).
Il y a sans doute aussi le fait que l’écrivain US va plus facilement vendre des droits d’adaptation qui rapportent du blé. Genre GoT en série HBO.
Exactement. Il semble que la production française pourrait s’y intéresser davantage quand le public français s’y intéresse à fond…
C’est clair que quand on voit ce que peut faire la BBC en matière de séries… Merde, y aura bien moyen en France, quand même !
Il faudrait clairement que la fracophonie se mette en avant en imaginaire. Parce qu’il y a du potentiel créatif.
Dans les pays anglo-saxons on publie de plus en plus d’anglophone non anglosaxon et d’auteurs issus de minorités ethniques. On essaie d’élargir le public de l’imaginaire en s’orientant vers un public plus diversifié. En France, déjà les auteurs des Dom Tom ont du mal à publier. Pourquoi : parce que l’on a besoin d’auteurs qui soient présents sur le plus de salons possibles. Une partie des libraires n’est pas vraiment réceptive à l’imaginaire, notamment chez des libraires indépendants.
Les libraires mettent en avant la littérature défendue par l’oligarchie ( je sais dit comme ça, ça fait politique). Le problème c’est que même certains progressistes (ou qui se définissent comme tel) défendent ce projet. La démocratisation de l’élitisme étant considérée comme un progrès sans s’interroger sur les valeurs culturelles qui sont derrière. C’est la fameuse exception culturelle.