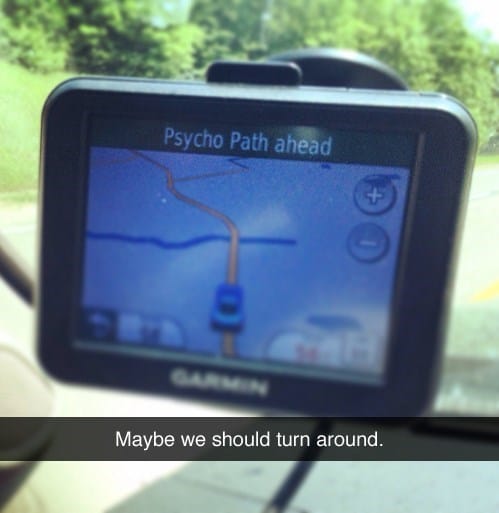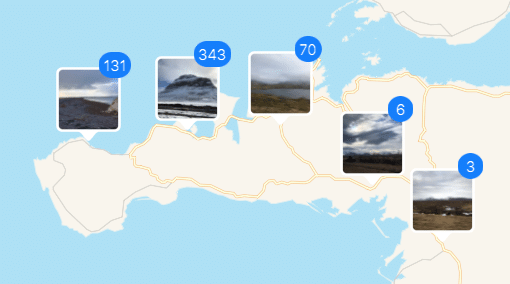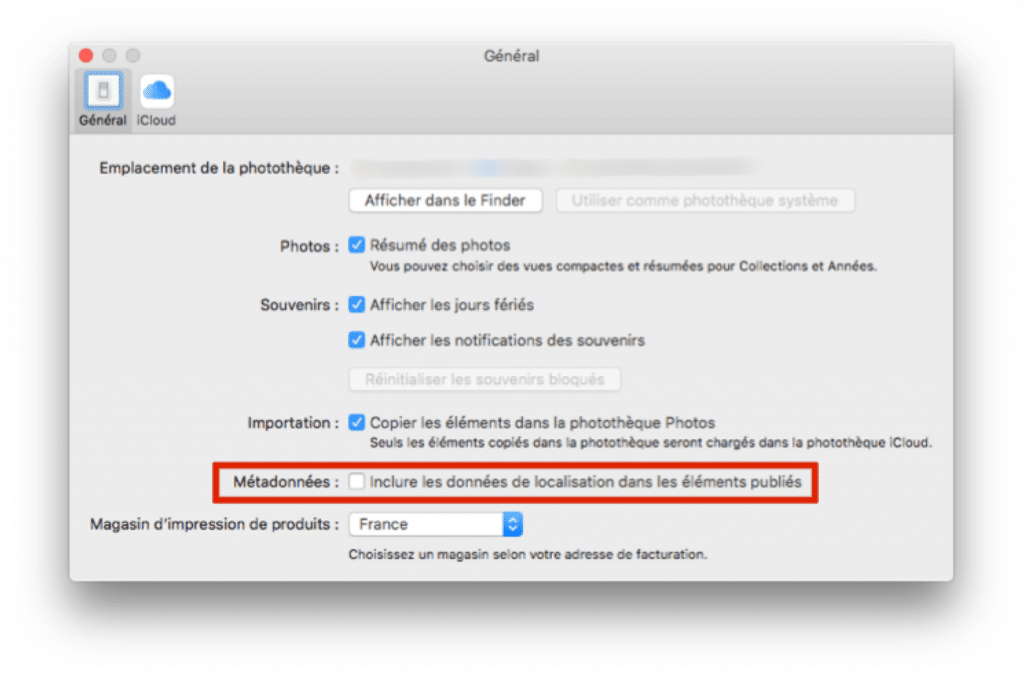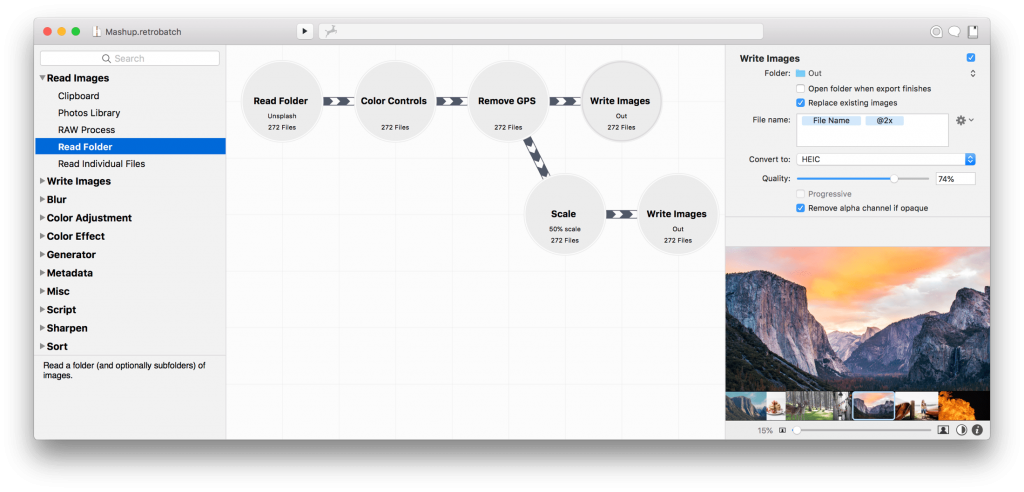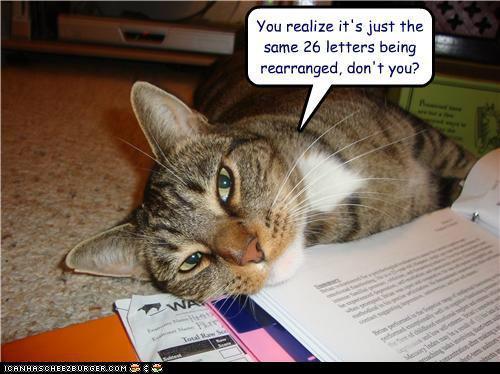Internet et l’âge d’or de l’agitprop
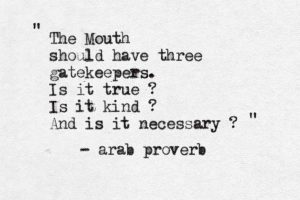 L’article sur Internet et l’économie du scandale a généré un certain nombre de réactions positives (et en même temps assez désabusées), ainsi que des débats productifs sur : à quoi nous servent tous ces réseaux, en vrai ? En ce moment, tandis que j’écris allègrement La Fureur de la Terre en ne consultant mails et réseaux qu’une fois par jour, je n’éprouve absolument plus la compulsion de vérifier ce que je peux bien avoir raté dans le vaste monde ; au contraire, je savoure un silence tel qu’on n’en connaissait qu’en une ère pré-Facebook.
L’article sur Internet et l’économie du scandale a généré un certain nombre de réactions positives (et en même temps assez désabusées), ainsi que des débats productifs sur : à quoi nous servent tous ces réseaux, en vrai ? En ce moment, tandis que j’écris allègrement La Fureur de la Terre en ne consultant mails et réseaux qu’une fois par jour, je n’éprouve absolument plus la compulsion de vérifier ce que je peux bien avoir raté dans le vaste monde ; au contraire, je savoure un silence tel qu’on n’en connaissait qu’en une ère pré-Facebook.
Cependant, encore une fois, il y a aussi de belles choses, bien sûr, à naître de ces lieux. Merci, sincèrement, auguste lectorat, d’en faire partie.
Mais les possibilités que ces médias œuvrent pour des fins néfastes semblent tellement prééminentes, surtout par les temps qui courent, qu’on peut s’interroger, au final, sur leur bien-fondé (même Mark Zuckerberg se pose la question, alors bon). Or, le fonctionnement réel de cette rhétorique du buzz, du « parlez de moi en mal, parlez de moi en bien, mais surtout parlez de moi » immortalisée par Léon Zitrone m’apparaît de manière de plus en plus limpide et, auguste lectorat, histoire de nous serrer les coudes le plus possible en cette époque de fake news et d’ingérences russes, permets-moi de te l’exposer telle que je l’ai comprise, histoire de partager un peu d’autodéfense mentale.
Comme exposé dans l’article précédent, l’exposition sur les réseaux sociaux – un canal aujourd’hui fondamental pour toucher du monde – est fonction, non pas de la qualité du contenu, mais de la quantité de réactions qu’il génère. Donc : plus il choque, plus il heurte, plus il s’adresse à un part reptilienne, viscérale, du public, plus il est susceptible de faire parler, d’être débattu, retransmis. C’est une bonne chose quand c’est une atrocité que le public doit connaître, un discours qui améliore le monde, une invention positive. C’est complètement stupide – et le système s’écroule littéralement – quand il s’agit de désinformation. Comme c’est d’actualité, prenons Alex Jones d’Infowars (non, pas de lien, mais si vous comprenez l’anglais, filer regarder cet épisode de Last Week Tonight pour en savoir plus), qui vient de se faire bannir plusieurs podcasts par Apple et Google pour ses discours incitant à la haine ; le lendemain, l’application idoine se retrouvait troisième des téléchargements de l’App Store d’iOS. La Terre plate, les antivax, toutes ces « doctrines » se répandent à la fois par auto-entraînement et par la quantité de réactions qu’elles génèrent. En résumé : plus c’est gros, plus ça fait parler, et au bout du compte, plus ça passe. C’est là-dessus que reposent les théories du complot – s’il n’y a pas de preuves, ça montre bien combien ils sont forts.
Or, c’est exactement la rhétorique de l’extrême droite américaine (que je n’appellerai pas alt-right, parce qu’un chat n’est pas une machine à laver), des masculinistes, de Donald Trump ainsi que de tous les rameaux putréfiés émanant du socle gangrené du gamergate. John Scalzi l’explique parfaitement : le but n’est pas d’avoir raison, mais de semer le trouble, de faire perdre du temps et de l’énergie en sortant des grandes phrases toutes faites, des idées reçues que l’autre s’évertue à démonter pour la énième fois. C’est un jeu. Il s’agit de maintenir le plus longtemps possible l’engagement et la discussion, de focaliser l’attention. Et le « troll » n’a rien à perdre ; ceux dont l’existence dépend de ce dont on parle, si.
Ce qui m’épuise et m’inquiète, c’est de voir cette rhétorique se généraliser à des sujets bien plus bénins et à peu près dans tous les domaines – dès lors que l’on cherche à attirer l’attention. Encore davantage si l’on œuvre dans des domaines où la propension des gens à parler de vous peut se transcrire en reconnaissance, voire en revenu : d’où le succès d’un certain type de pose provocatrice dans les métiers médiatiques… Qui se rappelle Mickaël Vendetta ?
Mais attention, la mécanique ne s’arrête pas là. Car – et c’est là tout l’art de la chose – il faut ensuite entretenir le feu que l’on a allumé. Pour cela, il faut agiter les esprits, susciter la controverse, fédérer les « pour » et surtout chercher à accrocher les « contre », pour leur brandir des interprétations juste assez fallacieuses de leurs déclarations en utilisant tout l’attirail rhétorique, comme le raisonnement circulaire, le biais de corrélation, l’appel au ridicule, prendre la partie pour le tout etc. (je vous remets le lien de Wikipédia sur les raisonnements fallacieux, qui est passionnant) C’est certain d’attirer l’attention de la cible, surtout avec une façade de cordialité, une véritable semblance d’appel au dialogue. Le débat s’installe, d’autres s’y invitent, et l’on obtient bientôt (dans le meilleur des cas) l’équivalent d’une réunion de la Cogip où personne n’a la moindre putain d’idée de ce qu’il fout là, mais que quelqu’un doit savoir ce qu’on pense parce que non, j’ai pas dit ça comme ça, et toi non plus, et la virgule, là, enfoiré, elle est passive-agressive, ou bien ?
En résumé :
Tout cela porte un nom (même s’il est polysémique, historiquement) : l’agitprop. Agitation et propagande. Ce qui est funeste aujourd’hui, c’est que l’agitation récompense et alimente la propagande en cercle fermé, grâce à cette immense caisse de résonance qu’est Internet.
Oui mais bon, d’accord. J’écris moi-même, là, un article sur ces sujets sur un blog dont la vocation consiste à être un peu lu. J’ai poussé des coups de gueule par le passé. Forcément, je vais vous dire que je suis fait d’un autre bois, hein ? Ben oui1. Mais surtout, en résumé : comment reconnaître un manipulateur d’un énervé ?
Pour moi, la clé se trouve dans une parole (si ma mémoire est bonne) d’Orson Scott Card, qui dit en substance que tout le monde a une religion : il suffit de discuter avec la personne jusqu’à trouver le sujet qui déclenche sa fureur. Voilà sa religion. (Il s’y connaît en religion, le bougre, du moins une certaine forme d’icelle, en mode « tuez-les tous et dieu reconnaîtra les siens »2.) Un véritable énervé est énervé parce que je crois, au fond, qu’il est malheureux, et s’il est malheureux, c’est parce qu’il tient à ce qu’il raconte, qu’il voudrait un monde différent, honnêtement, venant de son cœur (que celui-ci soit bien ou mal placé) : et c’est peut-être à cela que se juge la sincérité. Ce n’est pas pour dire que la sincérité équivaut à avoir raison, bien sûr ; il y a beaucoup de racistes très énervés – mais c’est aussi, je crois, qu’ils sont très malheureux au fond d’eux-mêmes. (Et dans ce cadre, compassion, mais prison.)
Le véritable maître de l’agitprop, lui, s’en bat les gonades. Dans un débat ouvertement fallacieux, il conserve une mine affable ; il attend que son interlocuteur s’emporte et se discrédite ; il endosse tout et son contraire avec l’aisance de mues, tant que cela maintient le feu du débat, que le projecteur ne s’éloigne jamais trop loin de lui – voilà son vrai but, et Donald Trump nous a donné à tous une vraie masterclass sur la question. Je crois que c’est à cela qu’on le repère ; et c’est là que, plus que jamais dans notre économie de l’attention, il faut éviter de nourrir le troll, car il se nourrit réellement, au-delà de son ego, économiquement, des retombées qu’on lui octroie. Nous créons les Donald Trump du monde, nous attisons leurs flammes par nos outrages. Je pense très fort à Ayerdhal qui nous répétait souvent que « la fonction de l’écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne s’en puisse dire innocent » (Jean-Paul Sartre) ; il ne s’agit certainement pas de se boucher les yeux et les oreilles au monde, surtout alors qu’aujourd’hui, on dispose de davantage de manières de s’informer que jamais ; mais de combattre la bêtise par l’intelligence, l’ignorance par le savoir, et la colère – mais non pas celle de l’autre ; la nôtre, ce jaillissement de fureur viscérale, religieuse, cher à Card – par la création, la vraie, celle qui s’efforce sincèrement d’apporter de la valeur autour de soi par de l’authenticité, de la pensée, de la recherche, de la bienveillance, de la compréhension. (Ce que j’espère, humblement, avoir un peu réussi à faire ici.)
- Personnellement, je ne peux pas faire ce genre de chose : je perds mon calme beaucoup trop vite, parce que je me soucie de ce dont je parle. Les quelques articles vraiment polémiques du site (écrits avec honnêteté sur le moment, même si pas forcément avec intelligence, je ne le nie absolument pas) m’ont explosé à la gueule avec grande sévérité, me faisant clairement comprendre que je n’étais pas taillé pour être éditorialiste ; j’ai tout de suite envie de régler l’affaire avec un duel de tractopelles. C’est aussi pour cela que le site, je m’en aperçois après coup, s’est replié sur des sujets plus calmes, comme la technique littéraire. Je n’ai pas signé pour m’écharper. ↩
- Oui, je sais que cette citation est apocryphe. ↩