Le voyage, cette fausse motivation narrative
Ouaiiiis j’entends déjà d’ici le bruit du goudron qu’on fait bouillir, les couinements des poules qu’on plume, le frottement des pierres à aiguiser sur les fourches. M’en fous je me suis immergé ce matin dans une solution de nano particules oléophobes alors BRING IT ON
Remarquez, contre les fourches, ça aidera pas des masses
À la réflexion POP POP POP du calme, laissez-moi m’expliquer
Donc. Depuis la rando-catastrophe de Frodon Sacquet à la Montagne du Destin (« 0/5, temps dégueulasse, autochtones détestables, je déconseille »), le voyage est un motif extrêmement fréquent en fantasy, et on le retrouve dans beaucoup de premiers manuscrits. Et en fait, pourrait-on arguer (et de fait, a argué ton humble serviteur une manette de NES à la main, auguste lectorat), le voyage est une composante fondamentale de la quête, du voyage du héros et tutti quanti : il s’agit d’aller chercher quelque chose, d’accomplir quelque chose. Alors il est où, le problème avec se servir du voyage pour architecturer son histoire ? Pour faire le truc, il faut bien sortir de chez soi et y aller, non ?

Eh bien oui, et non. Le voyage, ça marche probablement pour donner une direction à son histoire. Mais avec sa cousine honteuse qu’on planque lors des dîners de famille, l’errance, c’est beaucoup plus compliqué. Et la différence est subtile, mais puissamment dangereuse pour la tension narrative.
Une histoire se fonde sur la tentative d’accomplir quelque chose. On réussit ou pas, c’est une autre histoire (ou plutôt c’est celle-ci qu’on est en train de raconter, suivez un peu, quoi), mais… il y a donc une direction. Un but. Un élan. Qui peut changer, bien sûr. On peut décider que tout cela n’en vaut pas la peine et vous savez quoi, Gandalf, vous êtes bien sympa mais vous n’étiez pas à Bree et ça ne se fait pas de manquer un rendez-vous alors moi je vais rentrer à la Comté fumer des trucs chelou, merci bien. (Non, je déconne. N’écrivez pas ça. C’est une rupture de promesse narrative. Ou bien si, écrivez-le carrément, mais faites-le vache de bien ou alors c’est vers vous que se tourneront les fourches de vos lecteurs.)
Mais donc, une errance, un voyage sans but, devient extrêmement difficile à manier car, par essence, c’est une intention floue. Ou même, c’est un manque d’intention. Je vais là ? Ou là ? Peu importe. Et donc : si ça n’importe pas pour moi, pourquoi mon lecteur devrait-il s’en soucier ?
Aha.
En général, les récits de voyage (ou d’errance) fonctionnent au mieux quand ils se rattachent à un impératif plus puissant (atteindre le pôle nord, perdre un doigt au-dessus d’un lac de lave, arriver à survivre au travers du spectacle itinérant…). Or doncques : le voyage n’est alors plus, au sens narratif, la motivation… mais le moyen d’un but. Et ça n’est pas du tout la même confiture pour les personnages.
« Mais qu’est-ce qu’il raconte ? grommela mon adversaire immémorial, ma némésis invaincue, Jean-René Artifice-Rhétorique, tout en affûtant sa fourche. Ça existe, les récits d’errance, même que c’est vachement bien ! »
Ah mais tout à fait, Jean-René, et je suis bien content que tu me donnes la réplique de manière artificiellement rhétorique, merci.
De rien. (Minute, quoi ?)
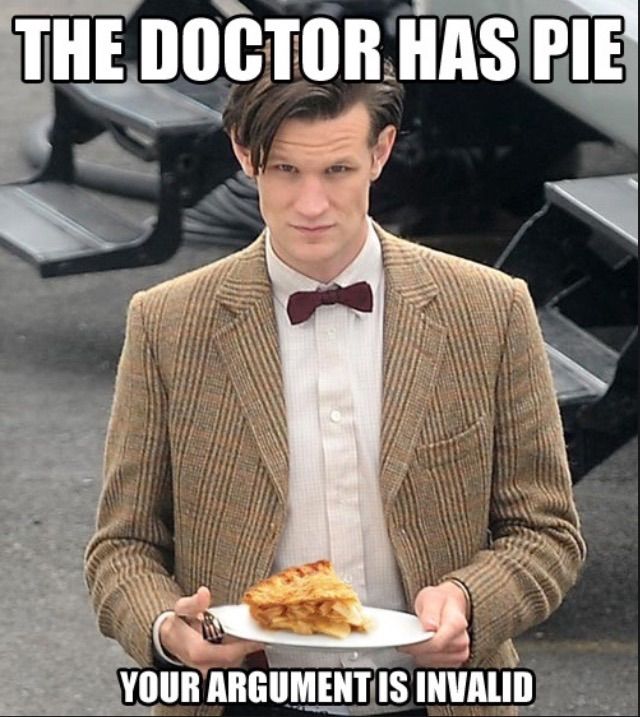
Alors oui, ça existe, parce que déjà, il y a toujours des contre-exemples, et qu’on fait ce qu’on veut en art, tant qu’on fait ça bien, donc vraiment, sérieux, pose ta fourche, mais si on y regarde de plus près, ces récits s’organisent souvent autour de deux axes :
- L’errance soutient un propos ancré sur ce thème, il est en quelque sorte le support de sa propre démonstration, constitutif de sa propre narration ;
- Elle est un prétexte pour des histoires d’échelle plus réduite, condensées dans le parcours, et leur somme trace un tableau qui représente plus que la somme de ses parties. (Genre la série télé Le Rebelle. Ah mais ouais, c’est que j’ai des lettres, moi1)
Id est : l’errance est un symbole mais, encore une fois, elle fait difficilement office de motivation, donc de moteur unique à une histoire. Une errance est un motif, mais je présente au jury que dans une grande majorité de cas, elle ne suffit pas à porter à elle seule une tension narrative. (Et le but de la tension narrative, à la base, c’est de faire en sorte qu’un lecteur s’intéresse à la suite des événements. Elle prend évidemment bien des formes, et tout le monde n’en attend pas la même chose.) Pour cela, il lui faut une raison, et cela en fait, dans la majeure partie des cas, un voyage.
(Je pourrais m’arrêter là mais je m’en voudrais de passer sous silence qu’ensuite, un des « pièges » qui guette l’auteur de voyages consiste à conserver une forme de cohérence narrative à son histoire. Trop de premiers récits de fantasy reposent sur des quêtes qui sont simplement des prétextes à des visites de mondes imaginaires – or, le problème d’une histoire, c’est que si elle peut se permettre des détours atmosphériques, il lui faut quand même une forme de cohérence et de trajet pour que le lecteur ait l’impression que tout cela va quelque part et ne forme pas qu’une suite de péripéties sans rapport entre elles visant simplement à ralentir l’arrivée au dénouement. Mark Twain le déplorait lui-même : « It’s no wonder that truth is stranger than fiction. Fiction has to make sense. » Toute la difficulté du voyage consiste à concevoir des péripéties qui se relient d’une manière subtile, qui forment de réels obstacles dans l’accomplissement de la quête : « En plus, notre guide, le vieux, nous a fait passer par des caves insalubres parce que le temps était mauvais au col du Caradhras, sérieusement, ces gens ne pourraient-ils pas se renseigner à l’avance ? ». Et pour cela, nous pouvons nous aider de la formule toute simple de Parker et Stone. Oui, voici la fin de la parenthèse → )
- Et je le prouve : parmi ses rôles mémorables, Lorenzo Lamas a aussi joué dans Mega Shark Vs. Giant Octopus. ↩


