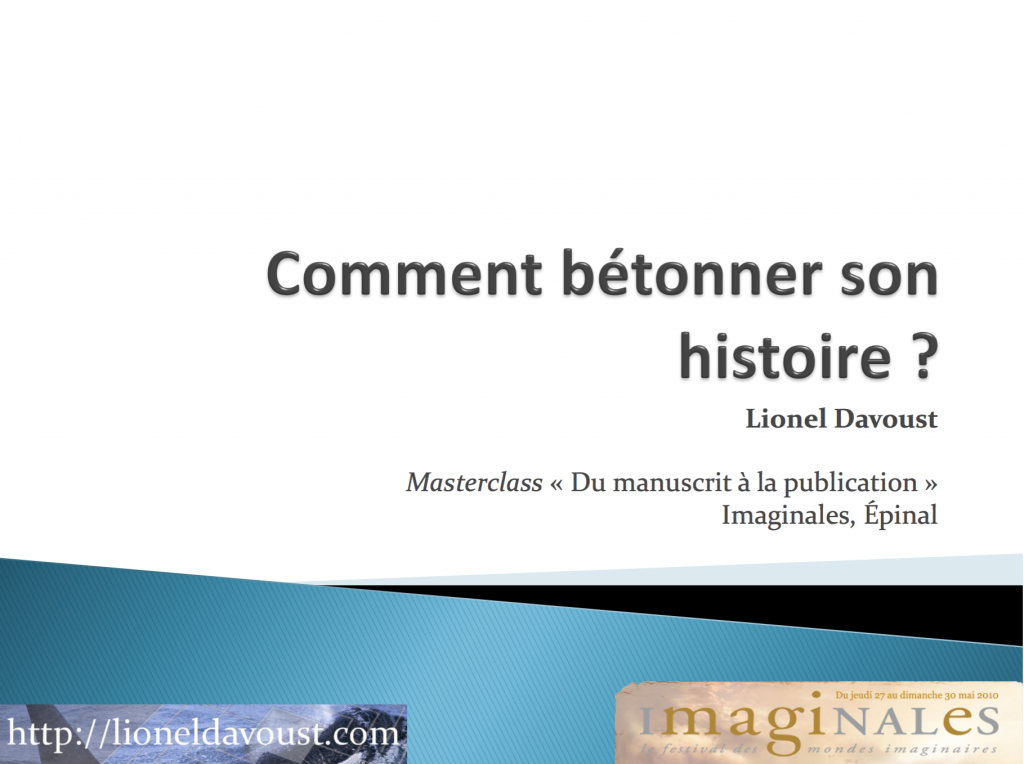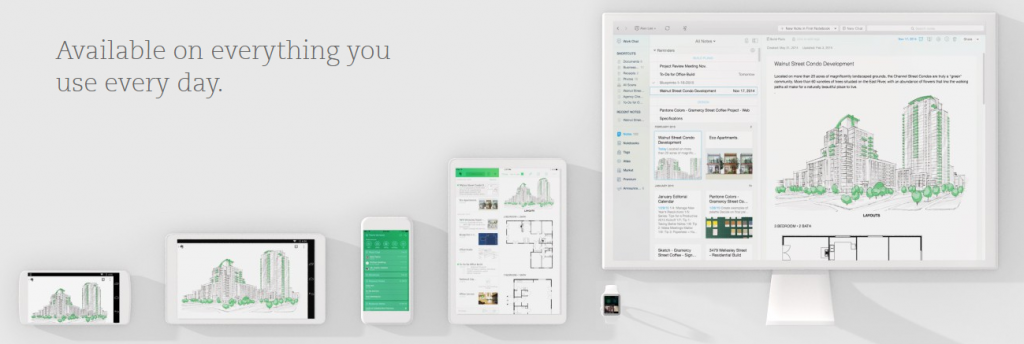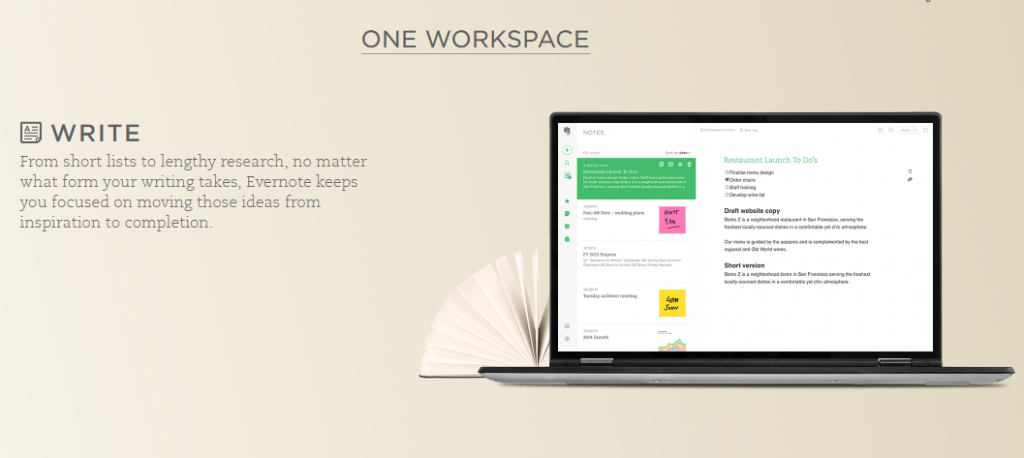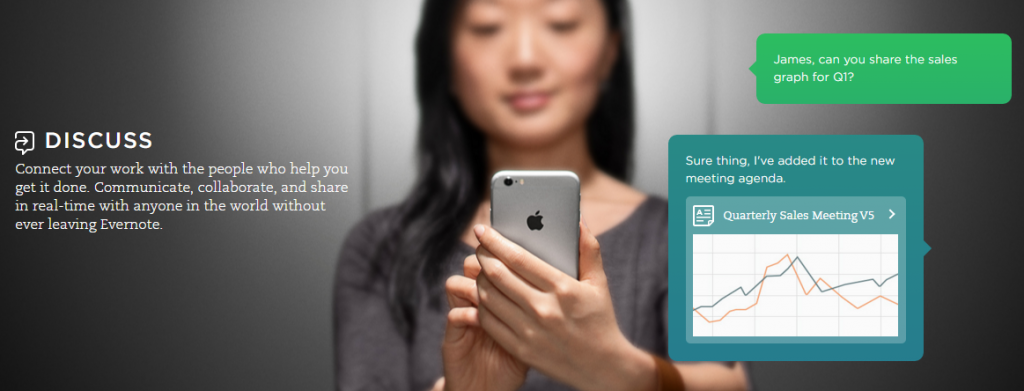Procrastination podcast S03E21 : « Relations et séparations entre littératures de l’imaginaire et générale »

Deux semaines ont passé, et le nouvel épisode de Procrastination, notre podcast sur l’écriture en quinze minutes, est disponible ! Au programme : « Relations et séparations entre littératures de l’imaginaire et générale« .
La littérature blanche serait censée considérer avec mépris l’imaginaire. L’imaginaire serait censé se considérer fondamentalement différent de la littérature blanche. Avec les succès planétaires du cinéma et de la série TV de genre, que peut-on dire sur un éventuel clivage – ou une réunion – entre les deux côtés de l’équation en 2019 ? Pour Mélanie, l’existence d’un « ghetto » est moins prononcée dans les faits qu’on ne peut le supposer, et surtout, s’il s’exerce, c’est dans les deux sens… Mais en tout cas, il est davantage prégnant dans le domaine littéraire. Lionel argue quant à lui qu’il existe d’importantes poches de résistance à l’imaginaire dans les grandes instances culturelles (médias généralistes et études littéraires) mais qu’heureusement, les murs tombent grâce à des alliés. Laurent, pour sa part, replace cette discussion dans le contexte d’une évolution culturelle et la genèse de l’identité des genres littéraires au fil des décennies en France.
Références citées :
– Star Wars
– Harry Potter
– Game of Thrones –
L’observatoire de l’imaginaire (chiffres de 2018 : https://www.actusf.com/detail-d-un-article/lobservatoire-de-limaginaire-les-chiffres-de-2018 )
– Hubert Prolongeau, Télérama (article sur Rivière Blanche : https://www.telerama.fr/livre/riviere-blanche,-une-maison-dedition-a-contre-courant,n6156825.php )
– Le Point
– Le Nouvel Obs’
– Anne Besson
– John Michael Straczynski, Babylon 5
– George Orwell, 1984
– Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes
– Philip Pullman, « À la croisée des mondes » (édition en Folio « blanche » : http://www.folio-lesite.fr/Contributeurs/Philip-Pullman )
– Philip K. Dick
– Marc Lévy
– Guillaume Musso
– Orson Scott Card, « Le sens selon Tolkien » in Méditations sur la Terre du Milieu, dir. Karen Haber
– James Joyce, Ulysse
– « Perry Rhodan », série
– Robert Merle
– Pierre Boulle
– Cyril Hanouna
– Maurice Dantec
– Michel Houellebecq
– Game One (chaîne de TV)
– Nolife (chaîne de TV)
Procrastination est hébergé par Elbakin.net et disponible à travers tous les grands fournisseurs et agrégateurs de podcasts :
Bonne écoute !