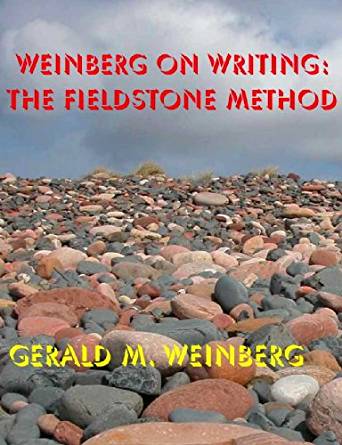Vous devez lire La Guerre de l’Art
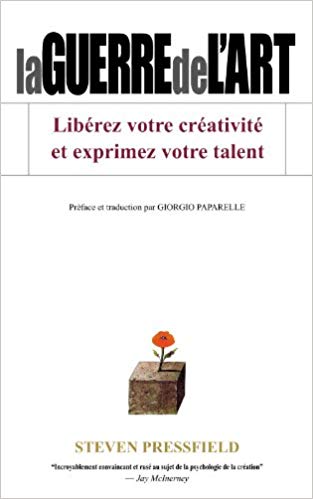
Je suis sérieux, et en plus, c’est pas un gros bouquin (190 pages en anglais, version que j’ai lue, soit The War of Art ; je ne sais pas exactement où trouver la VF, qui semble étonnamment rare en ligne, mais bon, vous savez qu’il existe en français).
C’est un bouquin plutôt connu dans le monde anglophone, de Steven Pressfield, largement cité dans cette vidéo que j’ai déjà largement fait circuler, et peut-être l’ai-je lu au bon moment, dans le marathon qui m’amenait à la ligne d’arrivée de La Fureur de la Terre ; toujours est-il que j’aurais voulu le lire bien plus tôt.
Genre, vingt ans plus tôt.
Le texte est court, incisif, simple. Pas de fioritures ni d’effets de manche1. Chaque phrase sert. La thèse est simple : toute tâche d’importance, en particulier un projet créatif, se heurte à un ennemi que Pressfield personnifie résolument, la Résistance. La Résistance est l’ennemie de la réalisation (tout particulièrement artistique) : elle vous emmène vous engueuler sur Facebook au lieu d’écrire, suscite syndrome de l’imposteur et vous paralyse au moment de travailler, nourrit la jalousie envers vos pairs tout en vous glissant à l’oreille que vous êtes un naze. La Résistance, avance Pressfield, est un adversaire retors qu’il faut vaincre résolument, tous les jours, toute sa vie, si l’on souhaite se mettre en contact avec ces forces intangibles qui président à la création authentique.
Pressfield avance carrément que la Résistance est l’une des causes premières du malheur dans le monde, alors que tant de personnes souffrent de succomber à cet ennemi qui les sépare de leurs aspirations véritables, de la vie qu’ils rêvent (quel que soit le rêve, bien sûr ; tout le monde ne veut pas être auteur, ni même artiste – mais la Résistance, elle, se dresse toujours). Et franchement, considérant de plus en plus qu’une personne en colère est souvent une personne qui souffre inconsciemment, j’adhère au discours.
EDIT du 10 mai 2019 : Emporté par l’enthousiasme, j’ai occulté que dans ses premiers chapitres, Pressfield tient un discours que l’on peut juger validiste en considérant les maux comme l’ADHD, etc. comme des fables. Je pense résolument qu’il n’en nie pas la réalité mais pointe du doigt les hypochondriaques qui s’en servent comme excuse (et qui, soit dit en passant, font du mal aux personnes qui souffrent véritablement). (Son discours sur la Seconde Guerre mondiale peut aussi susciter l’ire, et c’est probablement un truc dont Pressfield aurait pu s’abstenir dans son bouquin.) Comme toujours dans un ouvrage, ou dans ce qu’on lit sur Internet, il est salutaire de ne pas se considérer personnellement accusé.e par des mots qui ne s’adressent pas directement à vous (soit l’immense majorité des mots, d’ailleurs), mais d’en tirer ce que l’on peut. Et si, contrairement à ce que le titre de cet article proclame (vous savez que la vérité absolue n’existe pas, hein ?), vous constatez dans votre cas qu’il ne faut pas lire La Guerre de l’Art, tirez-en la bonne leçon – à savoir, ce que cela vous apprend sur votre propre manière de fonctionner et en quoi cela vous fait avancer. Le fond, globalement, est : comme le disait Nietzsche, rien de ce qui important ne vient sans surmonter quelque chose.
(Reprenons.) Pas de techniques ni de stratégies appliquées dans ce bouquin pour la vaincre, juste un discours de sergent instructeur bienveillant. Juste la répétition, encore et encore, que la Résistance est un adversaire terrible qu’il ne faut jamais sous-estimer. Et que, tous, nous l’affrontons. Et que, toutes et tous, nous devons la vaincre pour faire quoi que ce soit qui nous tienne à cœur.
Le syndrome de l’imposteur est un mal largement répandu de nos jours, et La Guerre de l’Art y répond avec brio, non pas d’une tape de commisération dans le dos et d’un bisou sur le front, mais d’un discours à la fois simple et efficace : 1) oui, je sais, c’est dur, je comprends ; 2) bouge ton cul, parce que c’est la seule solution véritable – aiguiser ta volonté. Tel le guerrier de Sun Tzu, fourbis tes armes, traque la Résistance, deviens plus fort qu’elle, et terrasse la Résistance, chaque jour.
Rien qu’en cela, ce serait un ouvrage déjà salutaire, mais il y a plus. Pressfield dit ouvertement en introduction qu’il croit en dieu ; la dernière partie du livre est clairement spiritualiste, mais fait appel à la psychologie de l’inconscient (on retrouve C. G. Jung) et le discours déborde très largement de toute doctrine judéo-chrétienne, et pourra trouver son écho dans les conceptions bouddhistes ou new age. (Vers lesquelles, honnêteté nécessaire, je tends davantage.)
Appelez ces forces mystérieuses qui président parfois à la création l’inspiration, la Muse (comme Pressfield), les anges (comme Pressfield), l’inconscient, ou un parcours chamanique (ce que j’ai tendance à faire). Le « higher self » cher à Jung et qu’on retrouve dans les spiritualités modernes sous le nom générique de « cœur ». Dans ce cas, la Résistance vient de l’ego – au sens là aussi spiritualiste du terme : cette force d’immobilisme en soi, de possession peut-être, qui s’attache au monde extérieur pour valider son existence. La Résistance n’aime pas la création, car la création défriche l’inconnu, par définition. La création bouleverse le statu quo, à commencer par celui de l’individu.
La création est donc dangereuse pour l’ego, et j’arguerais en outre qu’elle n’est jamais aussi bonne que quand l’ego s’en efface, pour laisser librement cours à ce qui veut s’exprimer à travers soi.
Je divague. Bref, il faut lire La Guerre de l’Art. C’est une bouée de sauvetage lancée à tous les créateurs qui doutent (termes parfois synonymes). Et puis il faut le relire, dès qu’on en a besoin. Nous affrontons tous la Résistance dans tous les aspects de nos vies. Et face à elle, nous avons deux choix : lui céder, ou bien tenir bon. Pressfield nous y exhorte, et montre la voie.
- Ce qui le rend, soit dit en passant, très accessible en anglais même si votre niveau est hésitant, et que la VF s’avère difficile à trouver. ↩