Procrastination podcast S02E06 : « La rémunération des auteurs »

Deux semaines ont passé, et le nouvel épisode de Procrastination, notre podcast sur l’écriture en quinze minutes, est disponible ! Au programme : « La rémunération des auteurs« .
Vivez-vous de votre plume ? Avez-vous un « vrai » métier à côté ? Peut-on gagner sa vie en écrivant ? Pour apporter de premiers éléments de réponse à ces questions, il convient d’abord de comprendre les fondements du mode de rémunération de l’auteur. Laurent passe en revue le système des droits d’auteur, que Mélanie développe sur la nouvelle, Lionel sur le numérique, et, en abordant rapidement les différents acteurs de la chaîne du livre, nous effleurons ce que signifie être un auteur s« professionnel » en 2017.
Procrastination est hébergé par Elbakin.net et disponible à travers tous les grands fournisseurs et agrégateurs de podcasts :






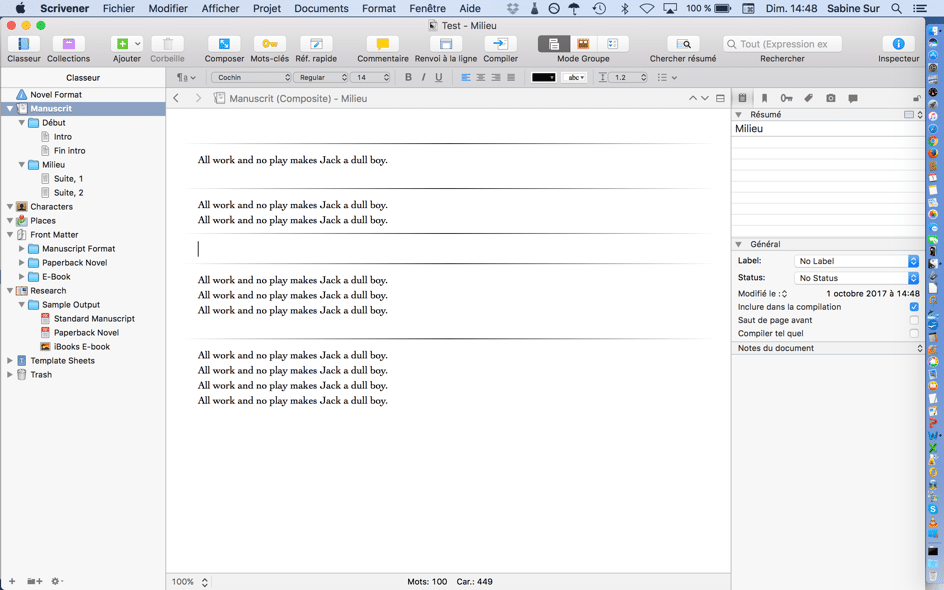
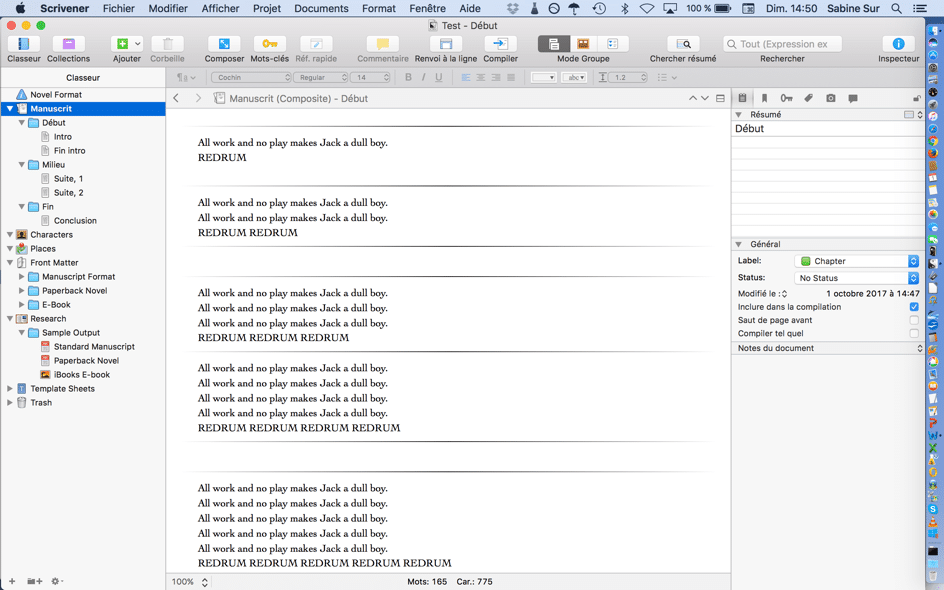
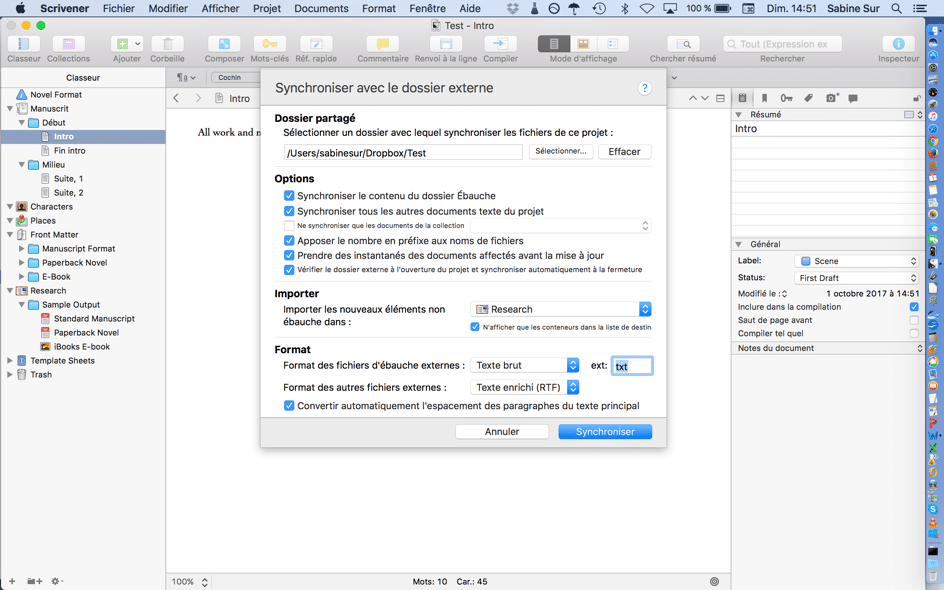
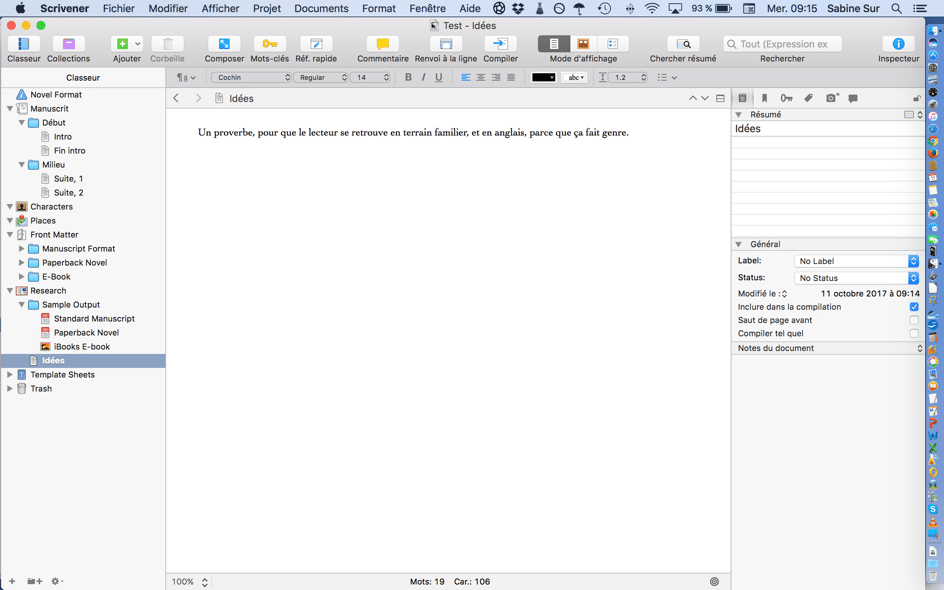
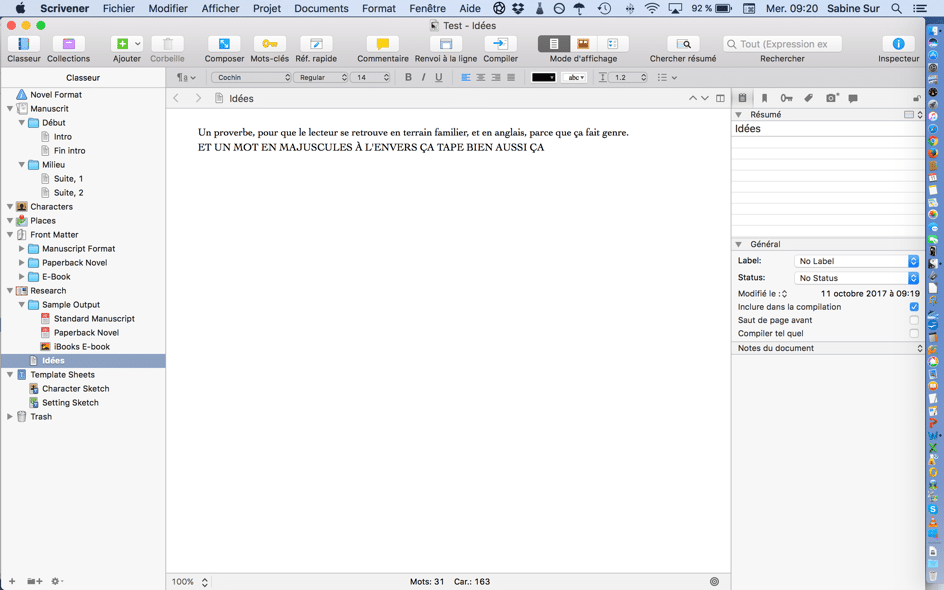
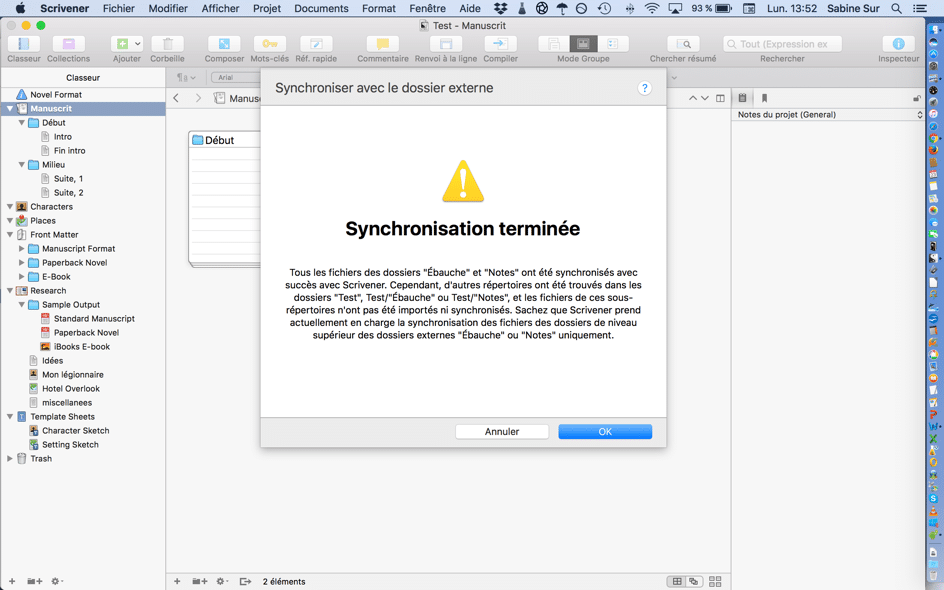
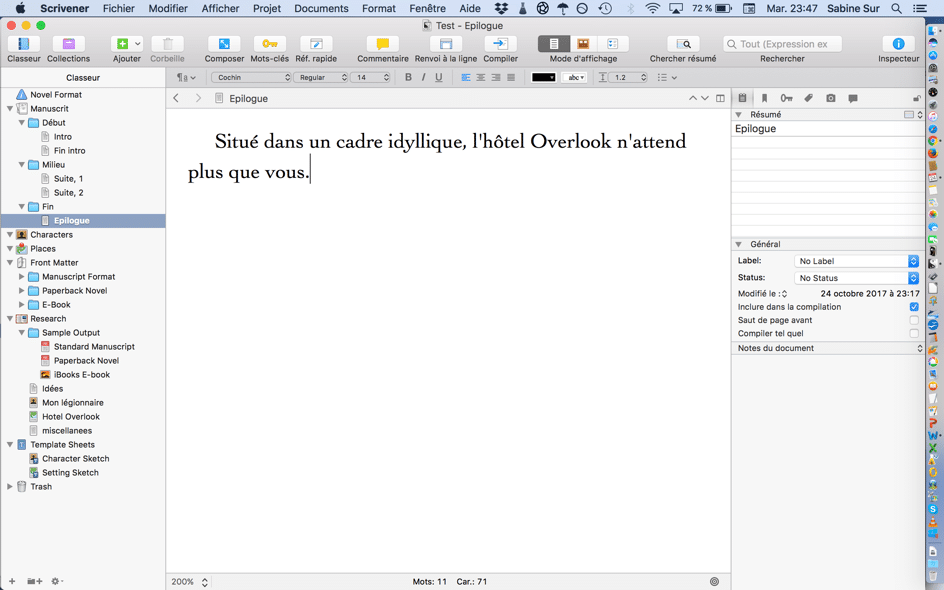
 Je m’y prends pas mal à l’avance, car les places sont parties rapidement l’année dernière : j’ai le grand plaisir de retourner en janvier à l’école d’écriture
Je m’y prends pas mal à l’avance, car les places sont parties rapidement l’année dernière : j’ai le grand plaisir de retourner en janvier à l’école d’écriture 


