Science fiction, science frissons : captation du débat au forum de bioéthique de Strasbourg
![]() Ce débat s’est déroulé dans le cadre du Forum européen de bioéthique 2017 à Strasbourg, avec : Catherine Dufour, Ariel Kyrou, Stéphanie Nicot, Faruk Gunaltay, LD. Grands témoins : Jean-Philippe Meilland, université populaire de Macon, Franck Queyraud, bibliothécaire en charge des médiations numériques aux Médiathèques de Strasbourg Eurométropole. Animation : Olivier Mirguet.
Ce débat s’est déroulé dans le cadre du Forum européen de bioéthique 2017 à Strasbourg, avec : Catherine Dufour, Ariel Kyrou, Stéphanie Nicot, Faruk Gunaltay, LD. Grands témoins : Jean-Philippe Meilland, université populaire de Macon, Franck Queyraud, bibliothécaire en charge des médiations numériques aux Médiathèques de Strasbourg Eurométropole. Animation : Olivier Mirguet.
Ce forum proposait cinq jours de conférences et interventions gratuites autour du thème de la bioéthique sous les angles scientifiques, juridiques, artistiques… Plus d’informations ici. Toutes les tables rondes ont été filmées et sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de l’événement, il y a des choses absolument passionnantes à découvrir.

 ActuSF : Sur quoi travailles-tu ? Quels sont tes projets ?
ActuSF : Sur quoi travailles-tu ? Quels sont tes projets ?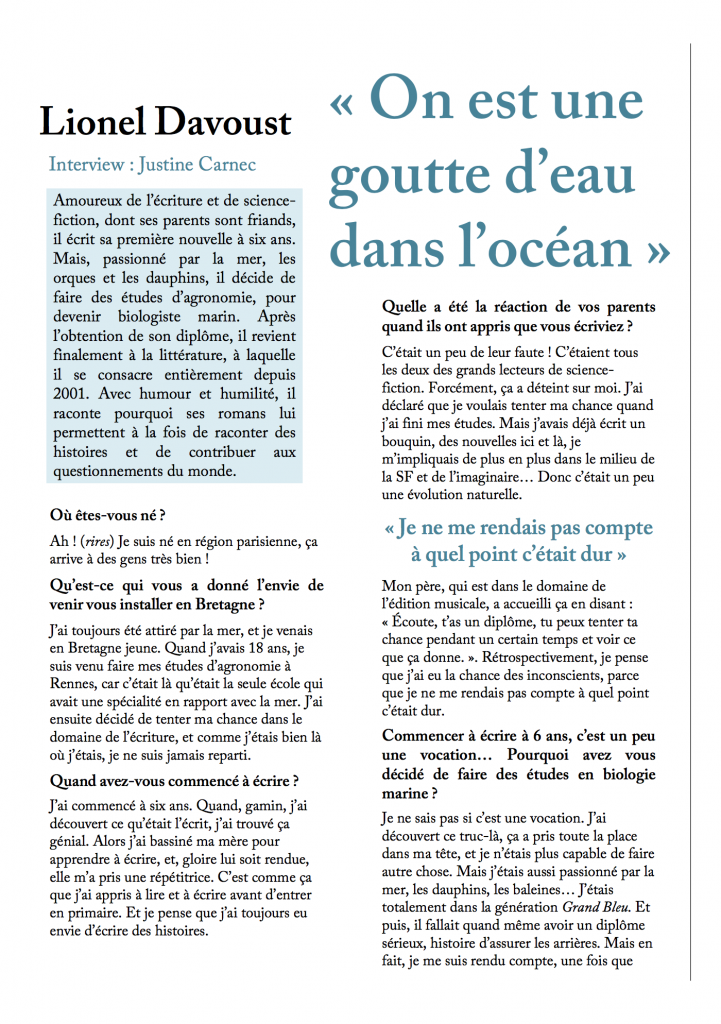


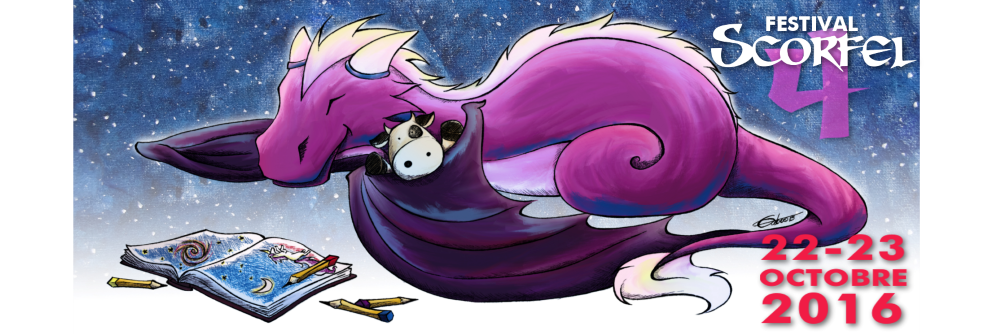
 Que voilà une chouette idée de TPE. Pas mon humble – enfin pas humble – ça dépend – vous voyez – personne,
Que voilà une chouette idée de TPE. Pas mon humble – enfin pas humble – ça dépend – vous voyez – personne, 



