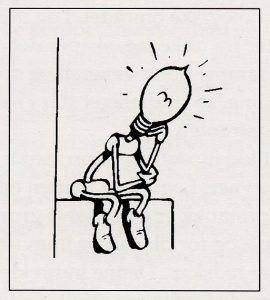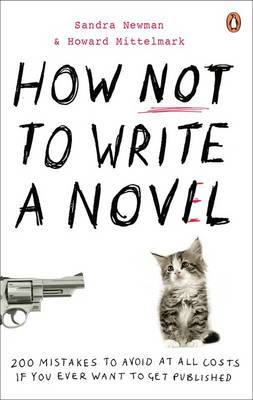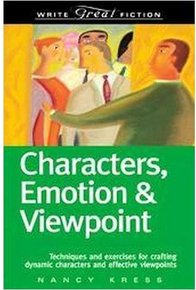L’invisible est invendable, dans le livre aussi
Article fort intéressant de Canard PC ce mois-ci sur la distribution dématérialisée des jeux vidéos indépendants ; comme souvent, le bihebdomadaire cache sous une grosse couche de déconne une vision pointue des marchés. Dans un article intitulé « L’invisible est invendable », portant sur la difficulté pour un petit développeur non affilié à un gros studio d’émerger de la masse écrasante des applications disponibles sur les boutiques en ligne, Ivan Le Fou déclare notamment :
Ainsi s’est mis en place un système qui, finalement, tendra à reproduire les inconvénients de la distribution physique : ceux qui ont le plus de moyens, ou les licences les plus connues, occuperont toutes les places visibles et seront quasiment en position de fermer la porte au nez des autres.
Le monde du livre et notamment les enthousiastes du numérique feraient bien, à mon sens, de lorgner un peu ce qui se passe dans les autres médias et en particulier dans le jeu vidéo, car il a ceci de commun qu’avec la littérature que, contrairement à la musique qui se découvre en une poignée de minutes, c’est un produit culturel qui nécessite un investissement temporel généralement supérieur pour être apprécié ou « saisi ». Or, le milieu du jeu vidéo est en train de découvrir qu’il ne suffit pas, pour construire un succès, de faire un bon jeu (même si c’est la base), ni de le vendre à prix cassé sur une plate-forme indépendante comme Steam, l’AppStore ou l’Android Market dans l’espoir que cette poignée d’euros dérisoire saura satisfaire l’acheteur potentiel.
Il faut, tout simplement, qu’il soit vu.
C’est-à-dire que le client en connaisse au moins l’existence, ce qui se fait classiquement par la communication et la distribution (dans le cas de l’inédit – je ne parle pas ici des rééditions, des introuvables ou même de livres ayant vécu leur vie en librairie). Mais ce n’est pas gratuit. Conséquence logique : c’est réservé à ceux qui auront les moyens… et dont, en un sens, c’est le métier.
On clame beaucoup, aujourd’hui, que le livre est trop cher. Qu’il devrait coûter au plus quelques euros. Mais quelle marge dégage-t-on exactement sur un livre électronique à trois euros ? Théoriquement, si l’auteur touche la moitié, voire la totalité de cette somme, il gagne à peu près aussi bien sa vie par exemplaire que sur un grand format en librairie. Tout devrait être bien. Sauf que, sur un grand format en librairie, il y a une quantité d’autres acteurs de la chaîne à être rémunérés, et dont le métier consiste à vendre le livre : éditeur, distributeur, libraire. Je ne dis pas que l’état actuel du métier est idéal, bien au contraire, les abus liés à la contraction du marché sont légion. Mais si l’on retire l’intégralité (ou peu s’en faut) de ces acteurs, qui va vendre le livre ?
C’est-à-dire, qui va le porter à la connaissance d’un public susceptible d’être intéressé ?
L’auteur, dont ce n’est pas le métier ? L’éditeur électronique ? Pourquoi pas.
Mais avec quels moyens ?
Il y a à peu près un an, je clamais bien fort que la libération de la distribution faisait le lit des publicitaires (ce qui m’a valu quelques pelletées d’insultes sur les réseaux). Le marché commence malheureusement à me donner raison. Ce qui m’inquiète en littérature, et ce qui inquiète les fabricants de jeu vidéo, c’est la politique tarifaire que nous sommes en train de mettre en place. Nintendo blâme les smartphones qui éduquent les joueurs à acheter leurs jeux quelques euros, lesquels rechignent donc à payer un jeu triple A1 40, 50, 60 euros.
Vendre un livre électronique au-dessus du prix du poche, bardé de DRM qui plus est, me semble une hérésie. Je pense que, psychologiquement, le livre électronique occupe la même niche économique que le poche : une lecture peu coûteuse, et l’on attribue peu de valeur affective à l’objet. C’est un modèle économique bien connu.
Mais trop baisser les prix (à deux, trois euros) et, surtout, l’institutionaliser, n’est pas la solution à mon avis. Le temps des gens n’est pas extensible. Le public est déjà soumis à des rafales de sollicitations permanentes et le livre rivalise avec une foule d’autres activités culturelles, jeu vidéo, télévision, etc. Même si nous rendons la lecture plus sexy pour un nouveau public, je ne crois pas que la littérature reprendra miraculeusement l’ascendant sur ces autres activités – si elle pouvait maintenir sa place, ce serait déjà bien.
Une offre pléthorique dématérialisée recrée finalement la même situation que sur l’étal des libraires : rien n’est visible, rien ne surnage, et donc les ventes sont atomisées. Dans ces conditions, la seule solution pour s’en sortir consiste à réussir un best-seller, pour l’éditeur comme pour l’auteur, car c’est seulement là qu’il pourra récupérer sa mise. Cela ne fera qu’intensifier une dérive des industries culturelles déjà bien ancrée depuis deux ou trois décennies : la réduction des prises de risques, de la découverte de nouveaux auteurs et leur promotion. Parce qu’à moins d’un coup de chance très rare – qui ne peut donc constituer un modèle économique – il faut investir pour qu’un livre puisse simplement atteindre le public qu’il est susceptible d’intéresser. Donc, il faut un retour encore plus colossal que la marge est faible. Soyons sérieux, il ne suffit pas de construire une page Facebook et d’inviter les gens à la Liker. Beaucoup ont fait la découverte amère qu’à part quelques dizaines, voire centaines de fans authentiques, tout le monde s’en fout. C’est beaucoup, beaucoup plus complexe et surtout demandeur en temps et en argent que cela.
Pour toutes ces raisons, je ne suis même pas loin de penser que vouloir à tout prix vendre le livre quelques euros, clamer que le modèle économique est viable, nuit au livre lui-même, à la santé de l’industrie culturelle. (Je vais tellement en prendre plein les gencives avec cette phrase, mais tant pis. Je reprécise que je ne parle que de l’inédit.) Entre le prix trop élevé du livre électronique pratiqué par nombre de grands éditeurs parisiens et la quasi-gratuité protestataire, il y a un juste milieu sur lequel il faudrait travailler (et que Bragelonne n’atteint pas trop mal, j’ai l’impression).
Sinon, personne ne surnagera. Et moins de moyens, cela signfie tout simplement, à terme, des livres de moins bonne qualité (ou alors, seuls les rentiers auront le loisir de travailler correctement leurs manuscrits. Est-ce vraiment cela qu’on veut ?)
Enfin, personne ne surnagera… Si. Dans ces conditions, les seuls à s’en sortir, encore une fois, sont Apple, l’Android Market, Amazon. Ces gens-là ne sont pas nos amis, contrairement à tous leurs discours humanistes de mise à disposition de la culture, si beaux qu’on leur remettrait le prix Nobel de la paix sans confession. Eux s’en foutent que vous vendiez 10 ou 100 000 exemplaires : ce qui les intéresse, c’est la masse totale des ventes. Car ils touchent toujours le même pourcentage dessus. Ils vous donnent les outils pour vous publier, d’accord, mais après… welcome to the jungle.
- Les grosses productions commerciales type Mario ou Call of Duty. ↩


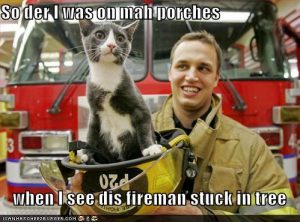

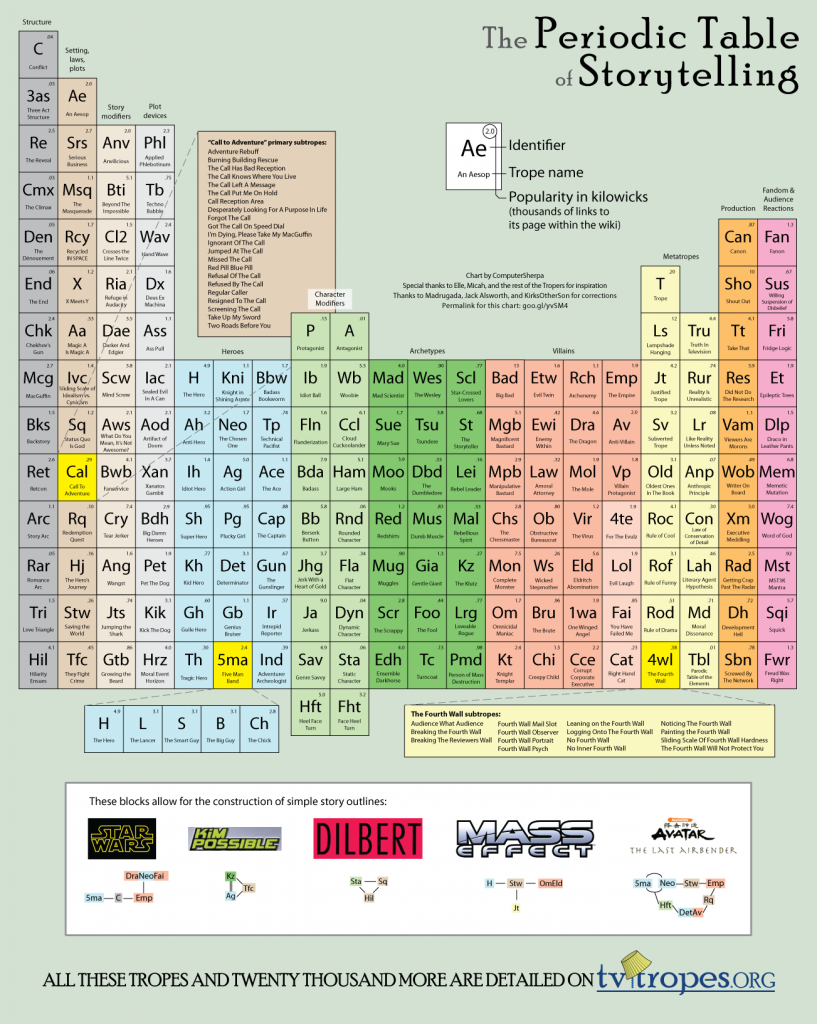
 Une petite causerie sur la traduction : j’ai été très honoré de recevoir quelques questions d’un étudiant en langues pour son mémoire universitaire, qui traitait principalement du lien que le traducteur nourrit avec sa ou ses langues de travail. Les propos n’engagent évidemment que moi et mon propre cas, je ne sais pas si les réponses sont bonnes mais certaines des questions l’étaient sacrément en tout cas !
Une petite causerie sur la traduction : j’ai été très honoré de recevoir quelques questions d’un étudiant en langues pour son mémoire universitaire, qui traitait principalement du lien que le traducteur nourrit avec sa ou ses langues de travail. Les propos n’engagent évidemment que moi et mon propre cas, je ne sais pas si les réponses sont bonnes mais certaines des questions l’étaient sacrément en tout cas ! Une question reçue soulevant un point assez peu connu du grand public concernant la rémunération des auteurs et des créateurs, et sur lequel il me paraît indispensable de faire un point :
Une question reçue soulevant un point assez peu connu du grand public concernant la rémunération des auteurs et des créateurs, et sur lequel il me paraît indispensable de faire un point :