Délais de réponse, de soumission, soumissions simultanées… Que faire ? (2. Quelque chose)
 La veille, donc, je me suis montré antipathique en donnant des réponses qu’en général personne ne veut.
La veille, donc, je me suis montré antipathique en donnant des réponses qu’en général personne ne veut.
Aujourd’hui, nous allons examiner ce qu’on peut réellement faire dans un marché toujours plus saturé de soumissions éditoriales, avec des supports qui se raréfient, et ce notamment dans le cas du roman (même si j’ai tendance à recommander d’attaquer par des nouvelles), où il est quand même difficile d’en écrire treize en attendant d’être publié (… même si c’est ce qu’a fait Brandon Sanderson, donc…).
La règle d’or reste toujours le respect de conditions de soumission de l’éditeur. Renseignez-vous ! Parfois, celles-ci autorisent les soumissions simultanées : cherchez ces éditeurs-là et allez-y gaiement. Parfois, celles-ci mentionnent clairement que toute absence de réponse au bout de quatre, six, huit mois valent refus ; prenez-les au mot et renvoyez votre travail ailleurs. Mais si celles-ci exigent une exclu sur la lecture pendant six mois, jouez le jeu en connaissance de cause. Et, bien sûr, si l’on vous demande trois chapitres plus synopsis, envoyez trois chapitres plus synopsis. Pas le livre entier. Jamais.
Reste le cas difficile du silence radio. Que faire pour obtenir des nouvelles de son oeuvre ?
De manière générale, si l’on laisse s’écouler un temps de traitement raisonnable, il n’est pas interdit de relancer poliment. (J’insiste. Poliment, bordel.) Nous sommes entre êtres humains de bonne compagnie et l’éditeur comprend que vous ne pouvez pas non plus lui garder votre livre jusqu’en 2050. L’idéal est de l’attraper en personne sur un festival, de se présenter courtoisement, d’expliquer qu’on a envoyé un livre à telle date, et qu’on n’a pas encore reçu de nouvelles, est-ce normal ? La réponse la plus probable sera « Oui, nous sommes en retard sur le traitement des soumissions. » (Les éditeurs sont généralement en retard sur les soumissions, ce n’est pas parce qu’ils s’en fichent, c’est parce qu’ils 1) en reçoivent un volume ahurissant et 2) doivent faire tourner la maison au jour le jour, ce qui est plus prioritaire que tout le reste, et c’est normal.) « Relancez-nous dans n mois. » C’est aussi simple.
Pas la peine de dire en soumettant votre travail qu’en l’absence de réponse sous n mois, vous vous réservez le droit de soumettre ailleurs ; cela vous fait paraître procédurier. On s’en doute bien. Relancez au bout du délai que vous vous êtes fixé ; ensuite, si vous ne recevez aucun signe de vie malgré deux ou trois relances courtoises et bien espacées dans le temps, alors sentez-vous libre d’aller ailleurs. Si l’éditeur se réveille, il ne pourra alors pas vous en vouloir comme évoqué hier : vous l’avez amplement prévenu. Et si, malgré tout, le texte est encore disponible quand il vous fait une offre, tout le monde sera content.
Maintenant, se pose la question suivante : qu’est-ce qu’un temps de traitement raisonnable ?
Aaaah…
Pour les nouvelles
S’il s’agit d’un appel à textes pour un projet donné (anthologie) : déjà, en règle générale, il vaut mieux toujours privilégier les projets annonçant une date de publication, un éditeur, n’importe quelle forme de calendrier. Les appels du genre « on cherche à amasser des manuscrits pour l’instant, mais on les publiera peut-être un jour » débouchent rarement sur du concret. Rien n’empêche de participer, mais ne vous laissez pas bloquer à long terme, surtout si, au bout du compte, rien ne sort jamais nulle part. Quand il y a un calendrier, notamment une date limite de rendu des textes, cela donne une idée du moment où les responsables vont commencer à trier les soumissions et donc d’à partir de quand il est légitime de s’impatienter.
Pour un support à soumission continues (revue, webzine), c’est forcément plus flou si rien n’est annoncé.
Il y a quinze ans, quand j’ai commencé (fichtre) la moyenne de temps de traitement dans la profession était de trois mois pour les nouvelles. Nous nous imposions ce délai pour Asphodale, comme le faisait Galaxies. Aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est plutôt le minimum. La limite basse me semble donc trois mois, et c’est même probablement un peu tôt pour s’interroger. Quatre mois me semble un bon délai pour commencer à demander ce qu’il en est. (Toujours poliment, hein.)
En revanche, si le projet qui vous intéresse a publié un calendrier (clôture des soumissions au moins n, parution au mois n + 6, par exemple), visez quelque part entre les deux. La fabrication (mise en page et impression) d’un livre prend un (si l’on est très rapide) à deux mois. Il faut aussi compter les corrections avec les auteurs en amont, ce qui prend du temps. Calculez donc un délai raisonnable pour avoir des retours sur votre travail. Dans l’exemple donné, avec un calendrier pareil, au bout de n + 2 mois, on peut vraiment se demander si l’on a été retenu ou non.
Pour les romans
Il s’en envoie tellement et c’est tellement difficile d’estimer une vitesse de travail dans ce domaine… Pour cette raison, avant six mois, cela me paraît peu réaliste d’avoir un retour. Se repose donc la question des soumissions simultanées si l’on espère publier rapidement. Est-ce pertinent ?
Je persiste à penser résolument que non (mais je suis certain qu’on me contredira avec véhémence en commentaires : auguste lectorat, lis-les pour avoir un avis différent du mien, ce qui est tout l’intérêt d’un blog). Mais si l’on veut tenter, je lis parfois qu’on recommande d’envoyer le manuscrit tous les trois mois (ou plus) à un éditeur différent, ce qui offre un moyen terme entre la salve d’envois tous azimuts, ce qui risque de susciter des conflits, et l’attente parfois très longue d’une réponse (et, quand même, il est parfaitement compréhensible qu’on ne souhaite pas mourir de vieillesse en attendant). Pourquoi pas.
Enfin, certains envoient bel et bien tous azimuts. Cela se fait : il faut juste avoir conscience des risques.
Mais en cas de problème, tu ne diras pas, auguste lectorat, que je ne t’ai pas lourdement prévenu et n’ai pas déconseillé la pratique. N’hésite pas à donner tout particulièrement ton avis en commentaires sur ce point.
Suivez vos soumissions !
En bonus, n’oubliez pas de suivre ce que vous avez envoyé à qui et quand, pour savoir quand relancer si vous le souhaitez, quelles sont vos relations avec x ou y, et surtout pour éviter la gaffe classique… Renvoyer plusieurs fois le même manuscrit au même interlocuteur ! La SFWA propose ces cinq ressources pour suivre ses soumissions ; le plus simple et le plus pérenne dans le temps me semble le logiciel Sonar, conçu spécialement à cette fin.
Bon courage et bonnes soumissions, et n’oublie pas, auguste lectorat : si tu veux établir une carrière solide et durable, le meilleur calcul consiste toujours à privilégier la patience.

 Okayyyy, je respire un grand coup pendant que ma dernière bibliothèque de sons symphoniques se télécharge et je me lance, tremblant et la peur au ventre, dans un de ces sujets qui déchaîne les passions :
Okayyyy, je respire un grand coup pendant que ma dernière bibliothèque de sons symphoniques se télécharge et je me lance, tremblant et la peur au ventre, dans un de ces sujets qui déchaîne les passions :






 C’est une question qui revient souvent, et qui paraît simple en apparence, mais à laquelle on trouve soit des réponses très vagues (« mets-toi à écrire, travaille, fais des efforts, mange macrobiotique ») soit très commerciales (« facile ! achète mes cours par correspondance qui feront de toi un auteur de best-seller, seulement 99,99 € ! »). Il faudrait donc tenter de taper entre les deux :
C’est une question qui revient souvent, et qui paraît simple en apparence, mais à laquelle on trouve soit des réponses très vagues (« mets-toi à écrire, travaille, fais des efforts, mange macrobiotique ») soit très commerciales (« facile ! achète mes cours par correspondance qui feront de toi un auteur de best-seller, seulement 99,99 € ! »). Il faudrait donc tenter de taper entre les deux : Apprendre seul
Apprendre seul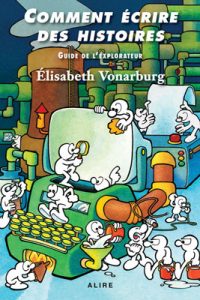

 C’est bientôt Noyel, alors on fait des cadeaux, et… non, en fait, je veux surtout donner une grande claque dans le dos qui fait tousser ses Pringles à tous les participants du
C’est bientôt Noyel, alors on fait des cadeaux, et… non, en fait, je veux surtout donner une grande claque dans le dos qui fait tousser ses Pringles à tous les participants du