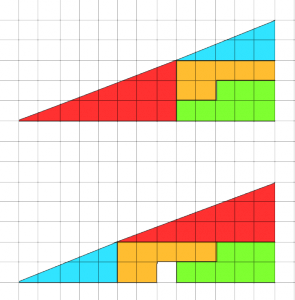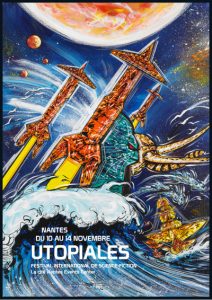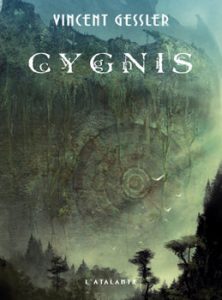Livre enrichi en vent (2) : marché de niche
Alors bon, vraiment, je suis ultra déçu, il semble que je n’aie pas réussi à me rendre entièrement impopulaire hier avec des affirmations à l’emporte-pièce sans explication, ce qui prouve que je ne suis définitivement pas prêt pour la monétisation de mon contenu rédactionnel à forte valeur ajoutée, comme me l’expliquait cet important spécialiste russe du web qui m’a écrit hier sur Twitter pour me proposer un séminaire de deux jours à 1000 $ en me promettant que l’investissement serait dérisoire par rapport aux bénéfices que j’en retirerais. J’hésite, franchement, j’hésite.
Donc, je ne crois donc pas à la généralisation du tant vanté « livre enrichi », et c’est un geek, un poilu, un vrai, du genre à crier de joie en découvrant dans un carton de déménagement un vieux câble série pour faire des transferts avec ses vieilles machines qui vous cause. (Je précise – ce que j’aurais dû faire hier – que je me place avant tout dans le cadre de la littérature et de la fiction ; les cartes sont moins nettes pour le contenu académique.)
Alors, pourquoi, hein ?
L’insoutenable linéarité de l’être
À moins de prendre des hallucinogènes puissants ou d’atteindre un degré d’évolution cosmique transcendantal, l’expérience humaine est linéaire. Notre expérience du temps, et donc notre intégration des connaissances, se fait de manière sérielle et généralement causale. Si je raconte la chute de la blague puis ses prémisses, c’est nul. Si je raconte que Jésus a ressuscité avant de mourir, ça casse le « ooh » (et l’ambiance, mais c’est une autre histoire). Complexifier le flux cognitif conduit vite à une sensation désagréable de décousu : on se demande vite « D’accord, mais qu’est-ce que ça raconte vraiment, au juste ? »
Bien sûr, on peut jouer avec la forme, comme Richard Nolan le fait très bien dans Memento, on peut expérimenter avec la temporalité du récit, d’un simple retour en arrière à la mosaïque totale, mais ce sont des écarts à la norme, des artifices visant à renforcer un effet de surprise chez le public qui, parce qu’il reçoit malgré tout la narration de façon linéaire, va se poser des questions supplémentaires qui sortent du cadre établi. Toute fiction pose des questions. (Si c’est pour ne pas poser de questions, autant aller se coucher tout de suite.)
Bref, si l’on doit passer du texte à une vidéo puis à des mots croisés, on largue inévitablement du monde en route : j’adore d’un amour impérissable et vénérant La Maison des Feuilles, mais je doute que ça devienne la norme demain – et qu’on aille beaucoup plus loin dans le concept non plus. On nous ressort périodiquement le concept de « fiction hypertexte », mais, sérieusement, vous en avez vu beaucoup qui a pris, vous ?
Pardon monsieur, vous pourriez couper votre livre, s’il vous plaît ?
Le corollaire – et la deuxième raison – est que, dans les habitudes de consommation actuelles, différents supports correspondent à différents moments, différents lieux. On écoute des podcasts dans le métro. On lit des gros bouquins cartonnés dans son pieu ou sur une chaise longue. On joue à Mass Effect de préférence vautré dans son canap’ avec une longue soirée devant soi. Et l’on regarde des films posé dans un endroit confortable (bon, OK, au boulot si c’est YouTube). Le son, composante quasiment indissociable de la vidéo, ne peut être consommé confortablement partout, tout comme l’image. Et si une partie de ce contenu nécessite un autre mode de consommation que celui prévu, soit on le saute (= création inutile) soit on éprouve de la frustration (et frustrer le client, c’est mal). (Alors oui, d’accord, je suis au courant il existe des casques, mais admettez que si vous avez une chouette télé et des haut-parleurs à la maison, vous préférerez attendre de regarder votre dernière épisode de série chez vous que sur votre portable pourri entre une grosse madame qui sent le chou et un pervers aviné.)
Sur Facebook, deux réactions hier concernant Level 26 (Anthony E. Zuiker), qui propose des vidéos récapitulatives en fin de chapitre, étaient éloquentes : non seulement c’est vécu comme « ne servant à rien » mais en plus, le lecteur se sent vaguement insulté qu’on lui résume ce qu’il vient de lire.
Rapide comme du texte
La dernière raison, que pas mal de diffuseurs de contenu oublient, c’est qu’il n’y a pas de mode de communication plus rapide que le texte. C’est pour cette raison qu’il n’a pas disparu et ne disparaîtra pas avant la généralisation de la télépathie. Un paragraphe du Monde contient plus d’information que trente minutes du journal de TF1 (mais ça, ça n’étonnera personne). La vidéo est rigolote, l’image est funky, les deux peuvent former d’excellentes illustrations, effectivement meilleures que de longs discours ; mais, à temps égal, un manuel restera toujours plus riche qu’un documentaire. Quand il s’agit d’intellectualiser, rien n’est plus dense que le texte. Sinon, le Web serait déjà peuplé de vidéos idiotes et d’images de chats. (Euh… attendez une seconde…)
Caveat canem
Alors, bien sûr, ces expériences sont intéressantes, il faut les faire, et ça ne m’empêchera pas de jouer si l’occasion se présente avec, parce que diable, c’est rigolo. Oui, le numérique et son interactivité offrent des possibilités enthousiasmantes, comme celle d’avoir un dictionnaire embarqué avec son ebook, de faire une recherche en plein texte, de répéter une phrase étrangère pour vérifier si son accent est passable. Mais arrêtons-nous un instant. En-dehors de quelques usages très ciblés, est-ce qu’on parle vraiment de fiction ici ? Non. Les enrichissements peuvent constituer un plus appréciable. Mais y a-t-il une vraie différence avec un livre illustré ?
Je ne crois pas. Et toute la question se résume finalement à ça, à mon humble avis. C’est chouette, les livres illustrés. Seulement, le jour où l’on a su intégrer à grande échelle des images à un texte, est-ce qu’un type fraîchement émoulu de Sup de Co s’est exclamé « oh putain, c’est l’avenir du livre, plus personne ne pourra jamais écrire à l’ancienne » ? Non. Le livre enrichi, ce n’est rien de plus qu’un livre illustré fait avec des électrons et, comme dans les rayons actuels des librairies, cela correspond à une demande existante et à un marché spécifique, très différents de la littérature « pure ». Alors, par pitié, arrêtez de nous marteler que c’est « l’avenir du livre » et que ça va radicalement changer la littérature. Parce que si c’était le cas, l’invention du vélo aurait entièrement éradiqué la marche à pied.
(Mais nous ne saurions nous passer d’un autre de ces merveilleux éducatels.)


 J’ai commencé l’écriture de cette note dans le train qui m’emmènait à la fac d’Angers pour donner un cours avec d’authentiques lolcats dans le texte et, suite à une histoire fort classique de retards et de correspondances, je me suis retrouvé à sillonner la rame en quête d’un contrôleur. Et, au fil de mon passage, j’ai vu à peu près deux à trois ordinateurs portables par wagon, cinq ou six paires d’écouteurs trahissant des baladeurs MP3, mais un seul Kindle.
J’ai commencé l’écriture de cette note dans le train qui m’emmènait à la fac d’Angers pour donner un cours avec d’authentiques lolcats dans le texte et, suite à une histoire fort classique de retards et de correspondances, je me suis retrouvé à sillonner la rame en quête d’un contrôleur. Et, au fil de mon passage, j’ai vu à peu près deux à trois ordinateurs portables par wagon, cinq ou six paires d’écouteurs trahissant des baladeurs MP3, mais un seul Kindle.