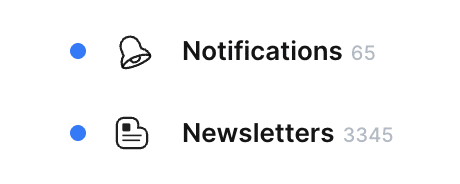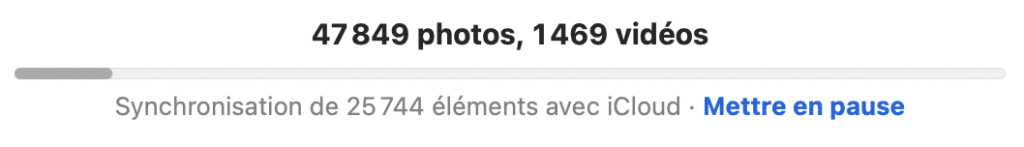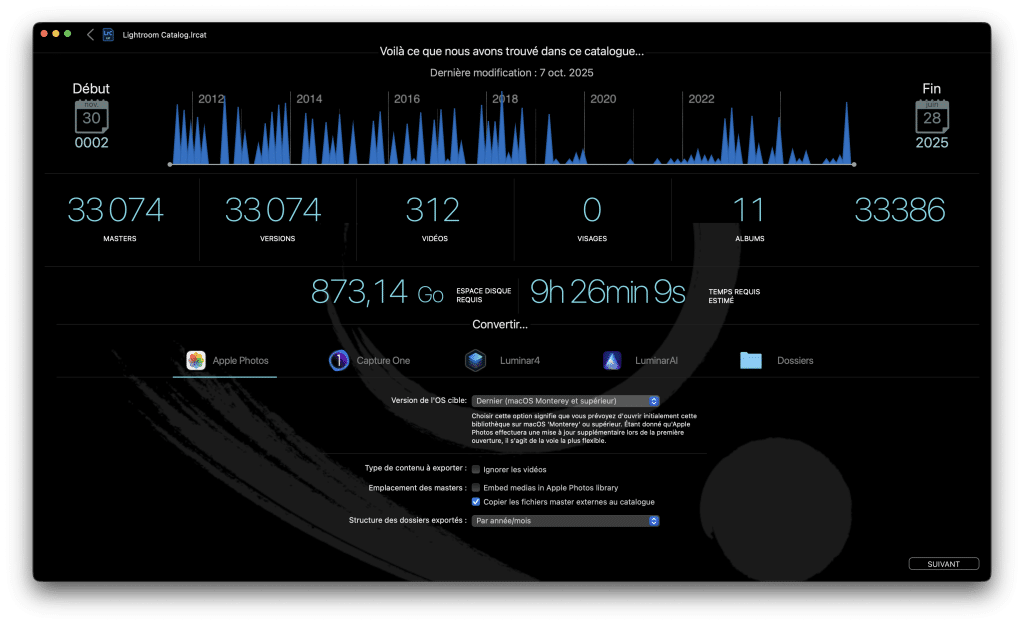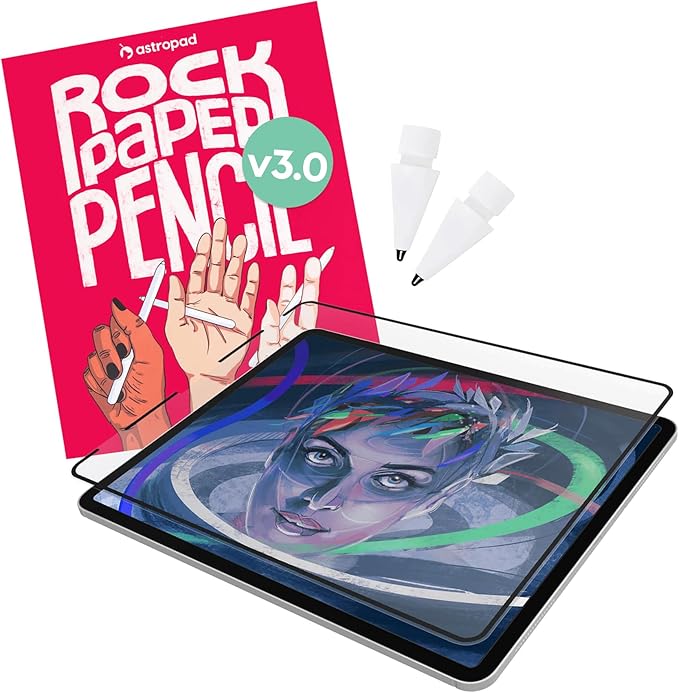Sundial Aeon, le bijou d’electro progressive que vous ne connaissez sans doute pas (Écrire en musique ?)
En electronica progressive, on est un peu embêté dans les années 2020. L’électro verse soit dans l’ambient texturale (SpacewaveCR, Stellardrone, Void Stasis…) soit dans la musique résolument destinée à des espaces qu’on appellera globalement sociaux (house, chillout, trance, techno etc.). J’aime ça, hein, notez, mais l’électro progressive, ou l’électro qui parvient à sortir des rôles précédents pour de l’écouter pure, veine Jean-Michel Jarrre ou Tangerine Dream de la grande époque, est comparativement rare à trouver (Carbon Based Lifeforms, Donbor ?)
Sundial Aeon est la mine que vous vouliez trouver sans le savoir, un « supergroupe » composé de plusieurs personnalités de l’ambient, avec des accointances avec la demoscene et des remixes par une moitié de Future Sound of London, si ça n’est pas du pedigree, je ne sais pas ce qu’il vous faut. Une quinzaine d’albums surtout dans l’esprit direct de Tangerine Dream de la glorieuse période glorieuse Virgin (en particulier Stratosfear et Tangram), mais avec une prodction évidemment contemporaine, lorgnant parfois vers la trance (je ne m’en plaindrai pas), c’est une véritable mine à explorer. Tous les titres d’albums finissant par « is », je vous enverrais notamment pour commencer sur Analysis et Hypnosis, mais les atmosphères varient assez notablement d’un album à l’autre, même s’ils gardent cette claire ascendance progressive qui fera la joie de l’amateur·ice. C’est le morceau suivant qui, un jour que j’avais Di.fm en fond, m’a fait lever le nez et dire: « minute, c’est quoi ça ? »