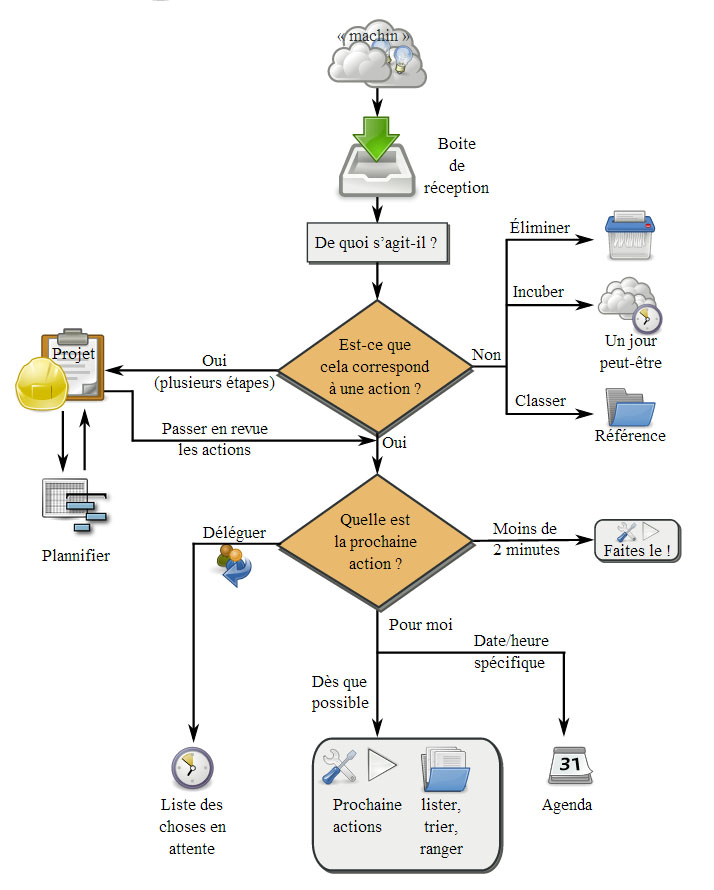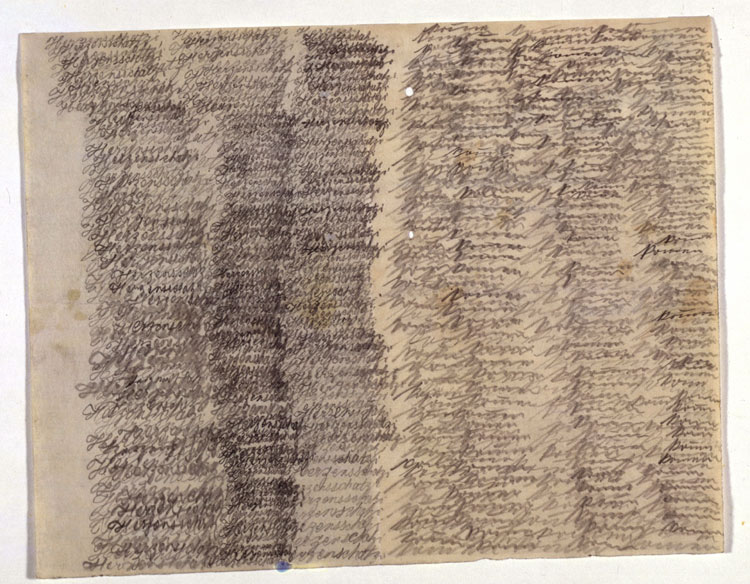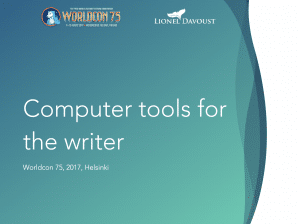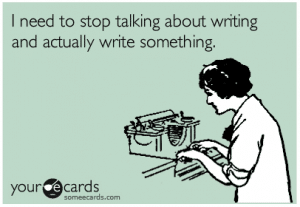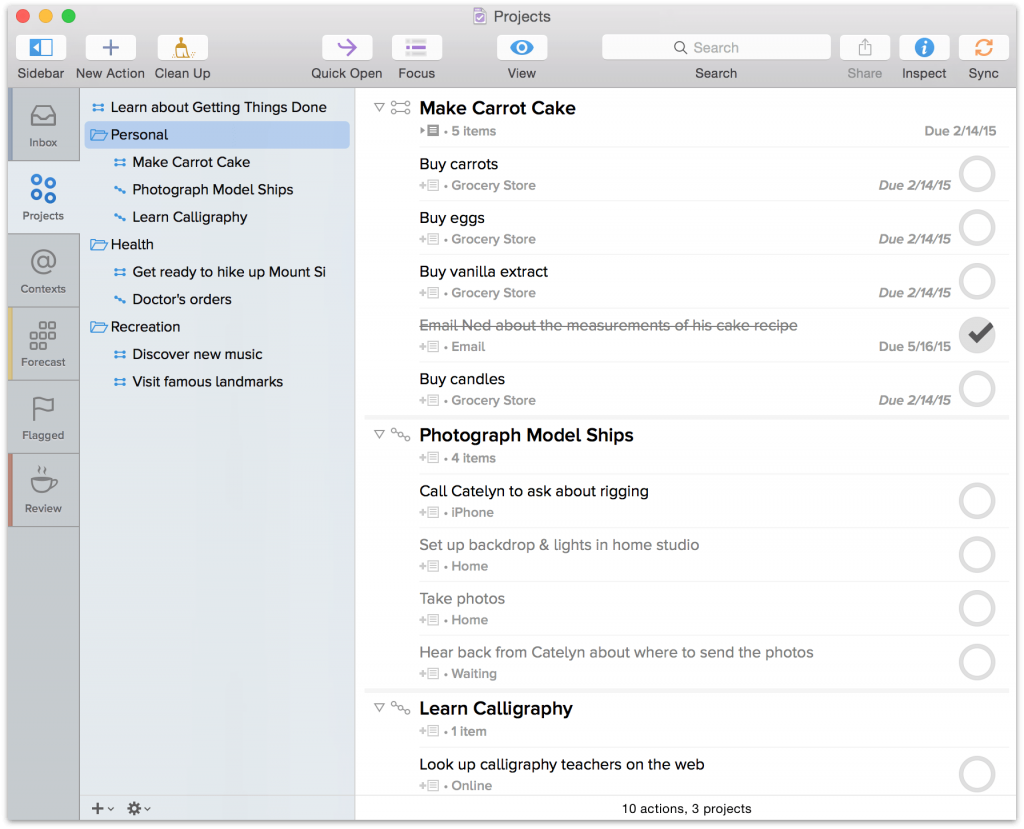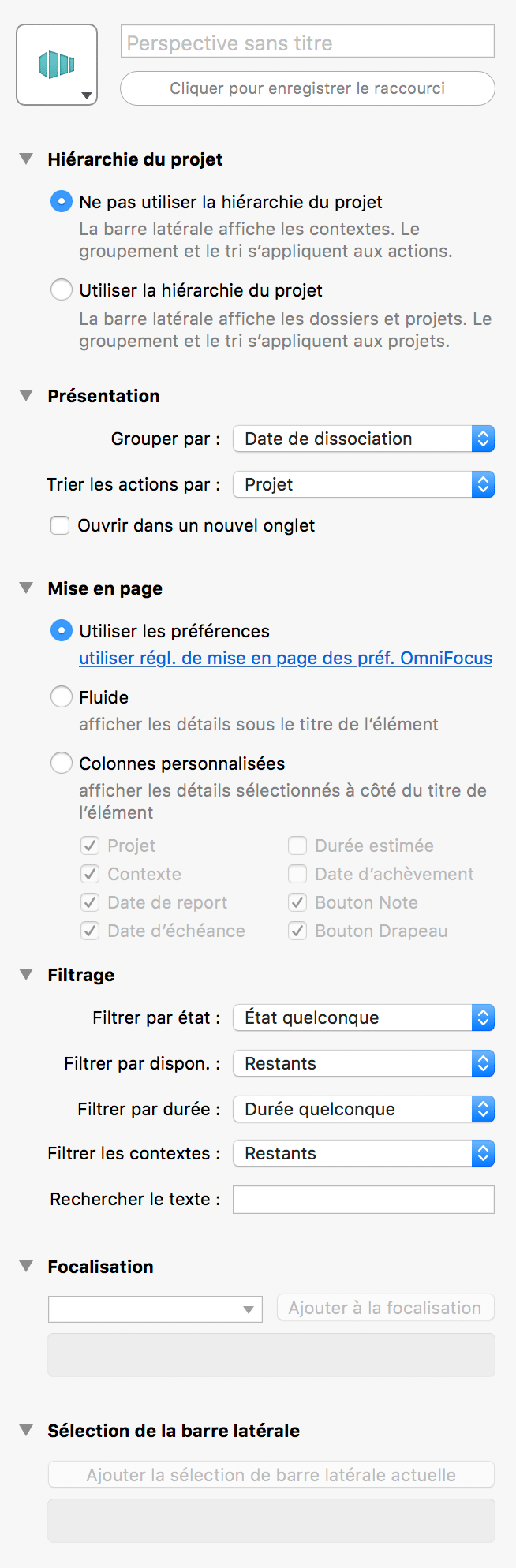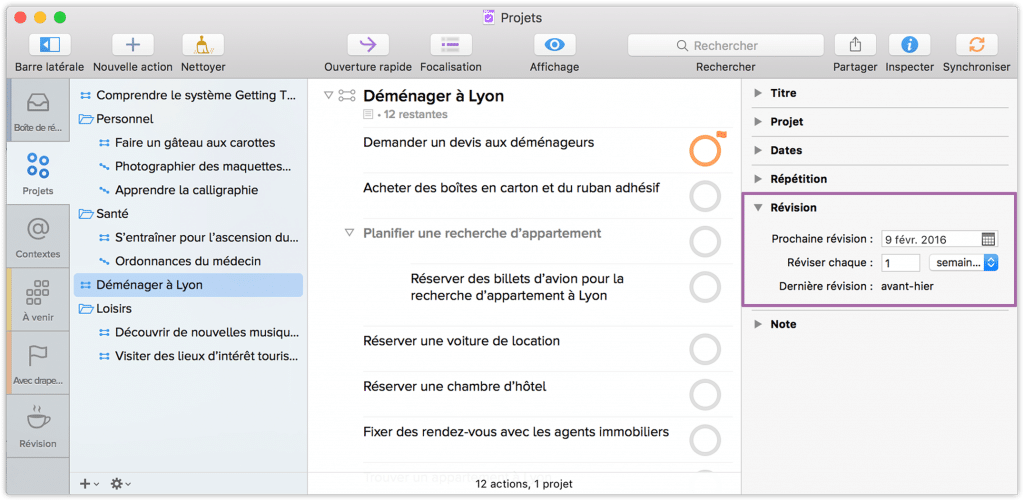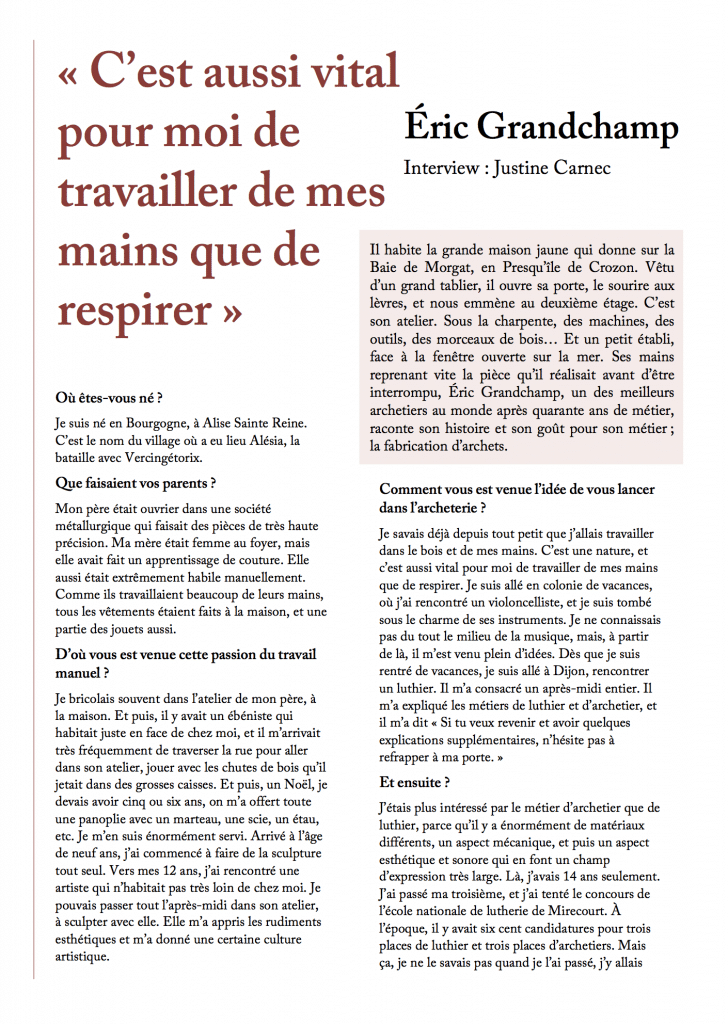On n’écrit (et ne traduit) que du sous-texte

EDIT : Comme me l’a fort justement signalé mon camarade Laurent Genefort au moment d’enregistrer la saison 3 de Procrastination, la notion dont il est question dans cet article n’est pas le hors-texte, mais le sous-texte. L’article a été corrigé par rapport à sa version d’origine.
On l’a abordé en filigrane dans Procrastination, j’en ai parlé par ici de temps en temps, mais plus le temps passe et plus cela m’apparaît avec limpidité : on n’écrit pas des mots, ils n’ont aucune importance. On n’écrit que ce que les mots disent.
OK, dit comme ça, on dirait que j’ai inventé l’eau chaude, mais bougez pas, je m’explique.
La définition la plus claire du métier d’écrivain – en tout cas, celle avec laquelle je me sens le plus en accord – m’a été donnée par Bruce Holland Rogers dans une interview que je lui proposais (et qui sera publiée un jour) :
Mon art réside dans le choix de mots qui engendreront un effet attentivement étudié.
Ce que j’interprète comme : écrire consiste à gouverner les émotions du lecteur (éventuellement avant qu’il ne s’en rende compte). Soit : il ne s’agit pas tant de prêter à voir que de donner à rêver ; il ne s’agit pas de raconter simplement ce que les mots disent, que d’évoquer et déployer sensations et images dans l’esprit du lecteur en n’employant que l’outil du vocabulaire, un peu comme un espace « plus grand à l’intérieur », une sorte de TARDIS tel que le décrit aux Imaginales par Mélanie Fazi dans le cas de la nouvelle. Ce sont, évidemment, les rôles fondamentaux de la comparaison, de la métaphore… Mais cela va plus loin : cela porte avant tout au travers de ce que l’on ne dit pas. Roger Zelazny, grand maître de l’épure, raconte qu’il a commencé à vendre des textes professionnellement quand il a cessé d’expliquer les choses à son lecteur mais les a laissées émerger du contexte du récit (l’émergence, un mot dont on parle décidément beaucoup dans Procrastination). Tous les auteurs ou presque disent que le lecteur fait la moitié du travail, car il construit ses images, ses représentations et son univers au fil de sa découverte ; l’une des difficultés, et peut-être des marques de l’expérience, consiste pour l’auteur à lui en laisser la place. En d’autres termes, l’auteur apprend d’abord à dire, puis, surtout, il apprendrait à en dire le moins possible, et au contraire à laisser habiter.
J’en suis convaincu depuis des années, mais ça m’est récemment apparu avec une lucidité inédite à mesure que je prends de la distance avec l’enseignement en fac de traduction (où je n’ai jamais été qu’intervenant extérieur une quarantaine d’heures dans l’année, hein – une belle aventure, mais que je dois clore peu à peu en raison du temps à ma disposition) et suis donc à même de lâcher des sentences. Comme dit l’autre, on ne travaille vraiment quelque chose que quand on devient capable de l’enseigner à quelqu’un. Or doncques, l’autre jour, il m’est apparu avec une absolue clarté que traduire, ça n’est que traduire le sous-texte. Celui qui traduit seulement les mots, comme celui qui écrit seulement les mots, n’a rien compris à l’exercice. Il s’agit de traduire les fonctions du langage qui créent les atmosphères, les sons, les ressentis, les émotions – et c’est cela, par le biais des outils stylistiques, syntaxiques et de civilisation, qui doit rester identique autant que faire se peut. C’est là que l’on sait si la distance est adéquate avec l’original ; quand il faut s’approcher, quand il faut s’éloigner, pour rester paradoxalement fidèle à l’esprit. Mais les mots peuvent changer, du tout au tout si c’est parfois nécessaire. Ils ne sont pas importants par eux-mêmes. C’est pourquoi la traduction littéraire restera toujours une affaire d’êtres humains, car c’est une affaire de sensibilité ; du moins, le jour où les IA seront capables de faire la même chose, la société aura muté d’une telle manière que l’humanité affrontera des bouleversements probablement bien plus fondamentaux que la survie de la profession.
Les mots sont comme une onde porteuse. Ils ne sont pas la finalité, ils ne sont que le support de l’écriture, du message, de la communication. Ce qui est une imperfection fréquemment fustigée dans des domaines nécessitant la plus grande rigueur comme le juridique, la diplomatie ou la communication au sein du couple (qui a dit « tout ça s’apparentant à la même chose » ?) devient, dans le cadre de la poésie et de la littérature, l’espace pour chacun d’habiter le récit de se l’approprier dans son espace intérieur – le silence ou la pudeur sémantiques, quel que soit le terme qu’on plaque dessus, est là une force.
Ouvrir ces espaces dans lesquels l’on peut se projeter marque à mon sens le plus haut degré de maîtrise de l’écriture, et savoir ajuster leur dosage (afin de proposer une onde assez forte pour transmettre du sens, mais pas trop pour ne pas l’assécher) relève certainement de l’œuvre d’une vie : cerner le contour du silence, une pratique presque zen s’apparentant à l’entretien de jardins de sable et de pierre. Davantage que du lâcher-prise, c’est du lâcher-prose. (Voir ici pour la vidéo virale convenant à la réaction à cette formule)
J’ai peut-être inventé l’eau chaude, mais après tout, c’est un blog, alors le cas échéant, je fais me faire cuire un bain.