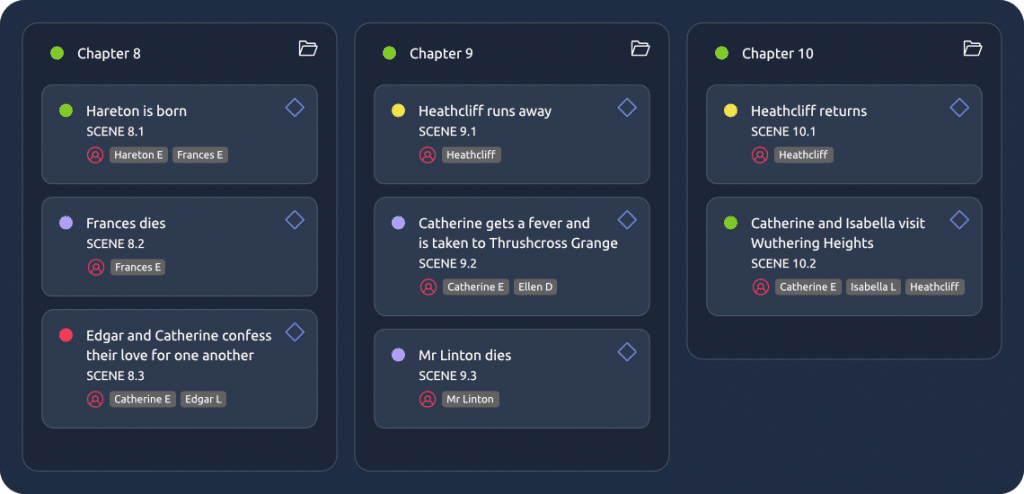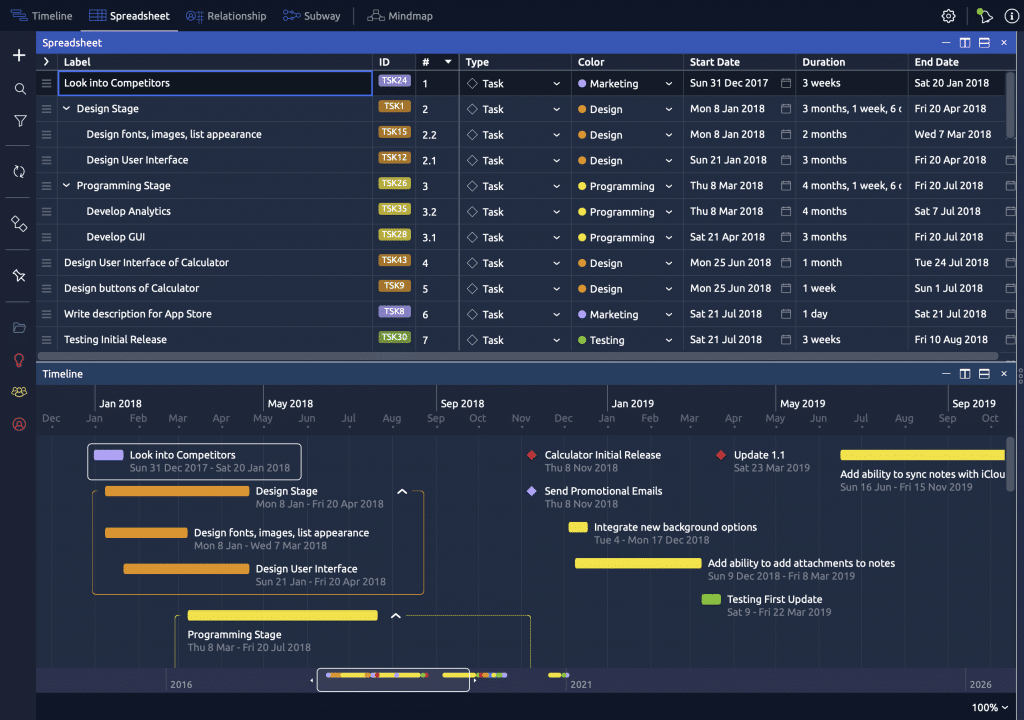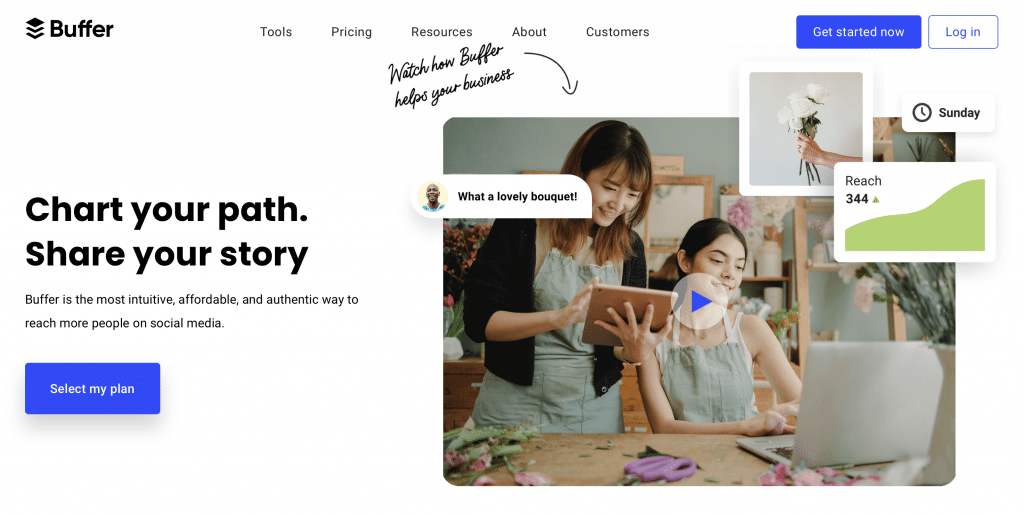Comment trouver une machine à écrire connectée Freewrite en France
Après avoir clamé tout le bien que je pense des machines Freewrite, la question logique s’est bien sûr posée : okay, super, t’es gentil Davoust, mais comment j’en trouve une ? Le site officiel ne livre pas en France.
Alors, techniquement, le site officiel livre en France selon les lois de la mécanique quantique. Parfois, si, c’est bon. Parfois, c’est seulement certains produits. Parfois, c’est jamais.
En conséquence, à moins d’avoir un copain à l’étranger, il faut passer par des revendeurs tiers :
- Amazon (argh) pour du neuf, qui en ce moment propose tous les modèles non collector et même les jeux de touches de remplacement. (Ce n’était pas le cas il y a six mois, j’ignore combien de temps ça va durer)
- Il y a souvent sur eBay des modèles d’occasion ou peu utilisés (par des gens qui n’ont pas accroché au concept) pour des prix un peu plus raisonnables
- Enfin, il existe un serveur Discord autour des Freewrite où passent de temps à autre des annonces pour des modèles d’occasion (parfois customisés).
Bonne chasse !