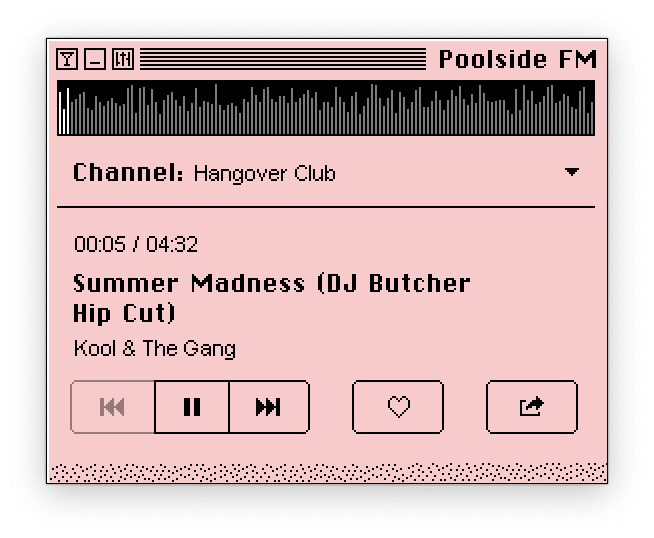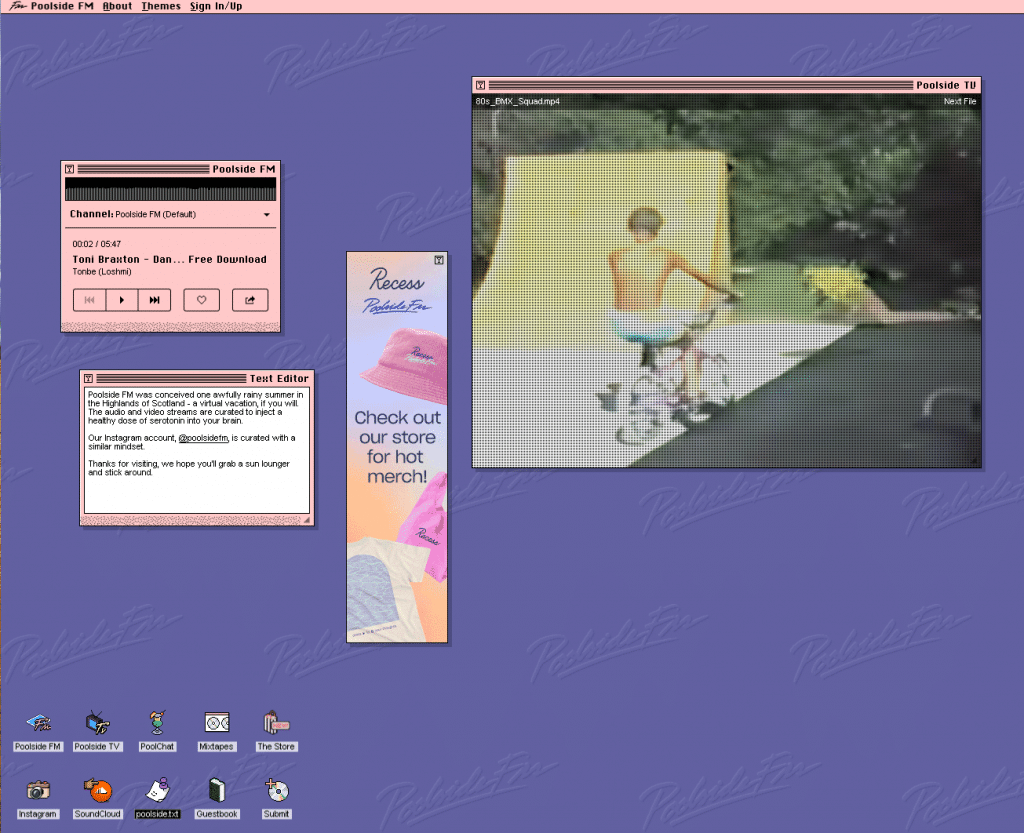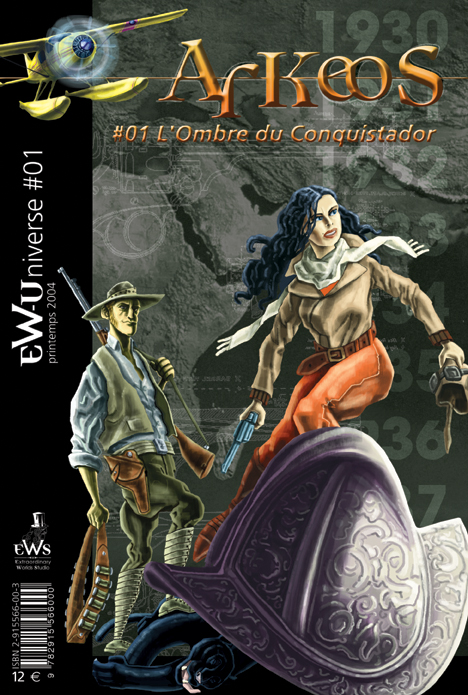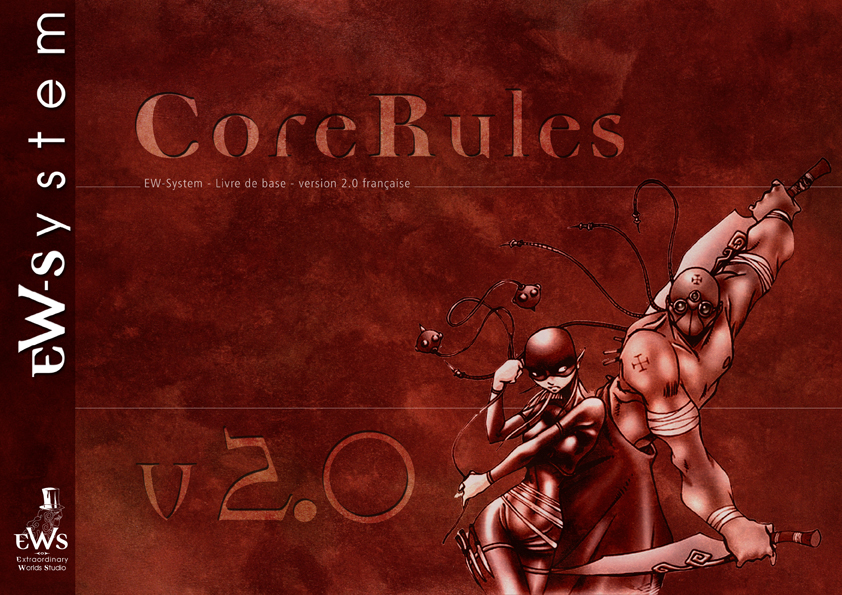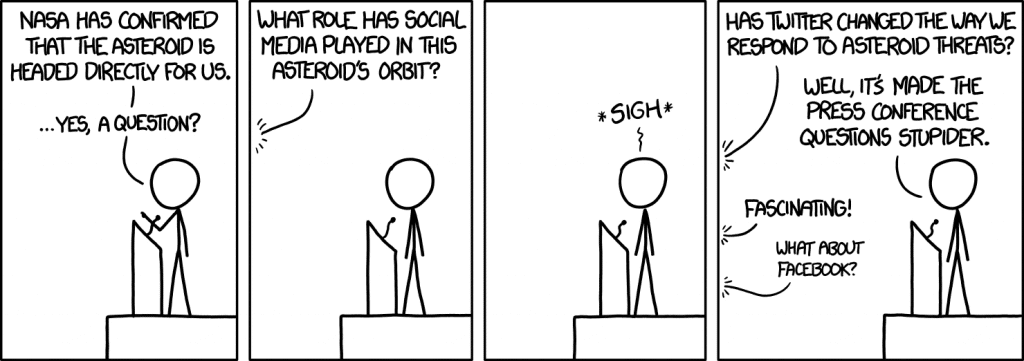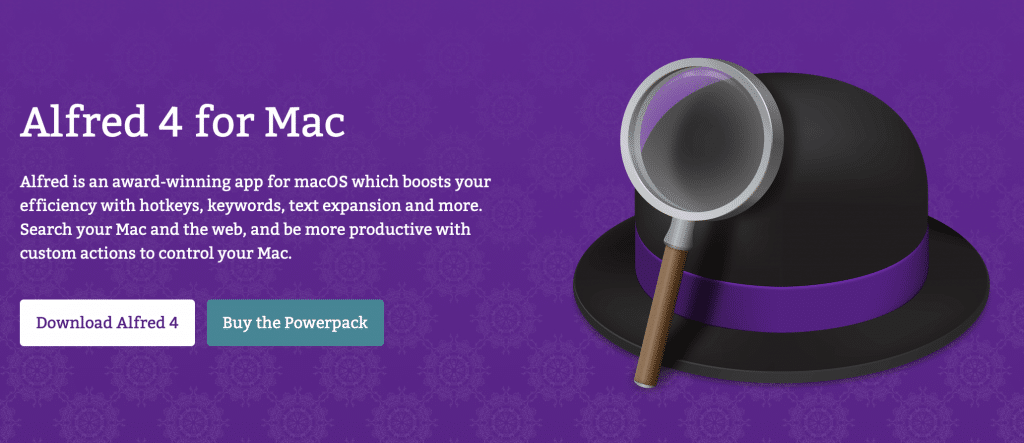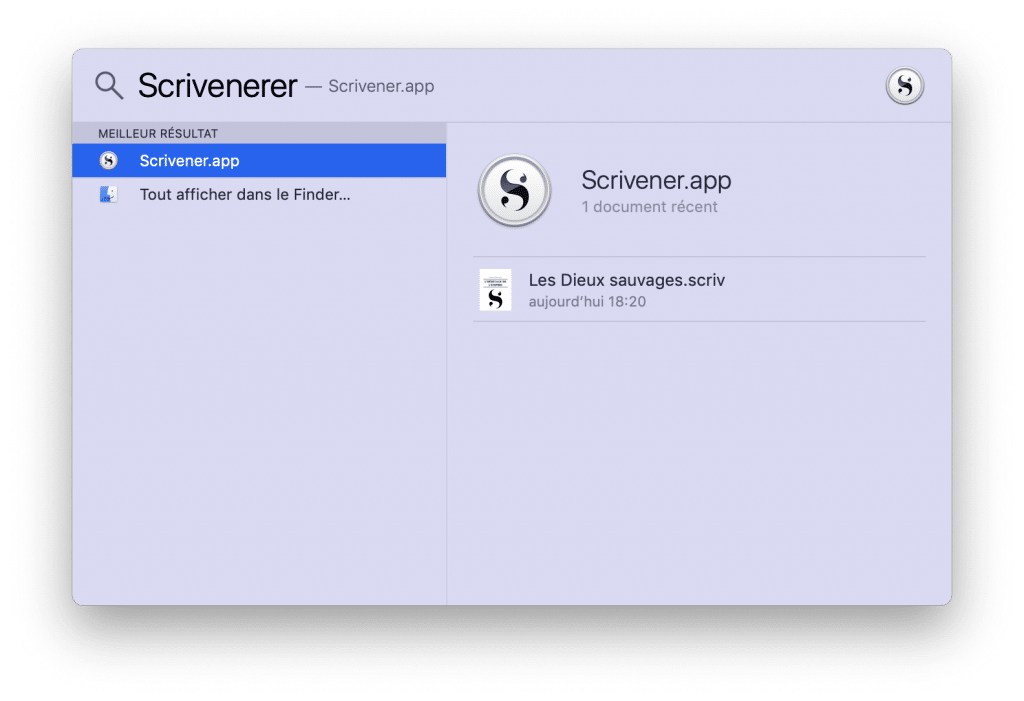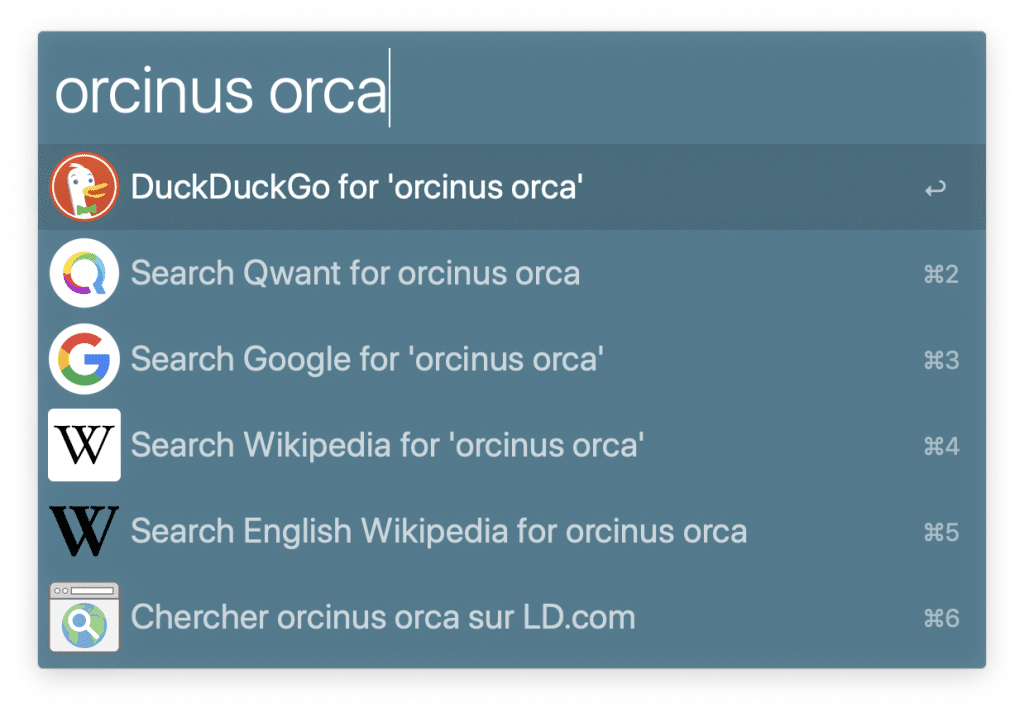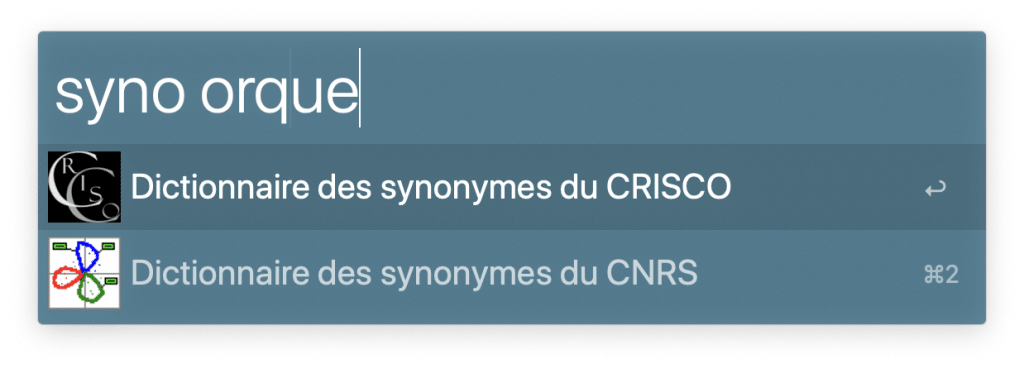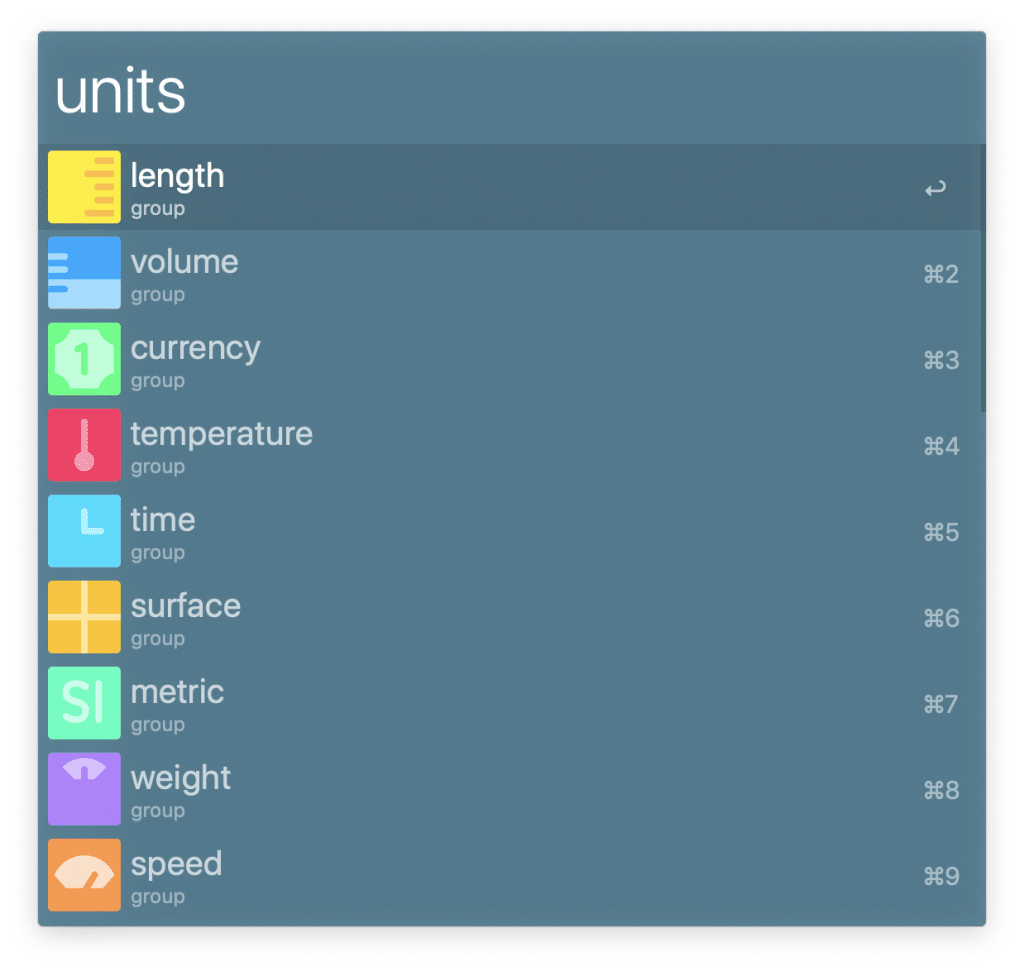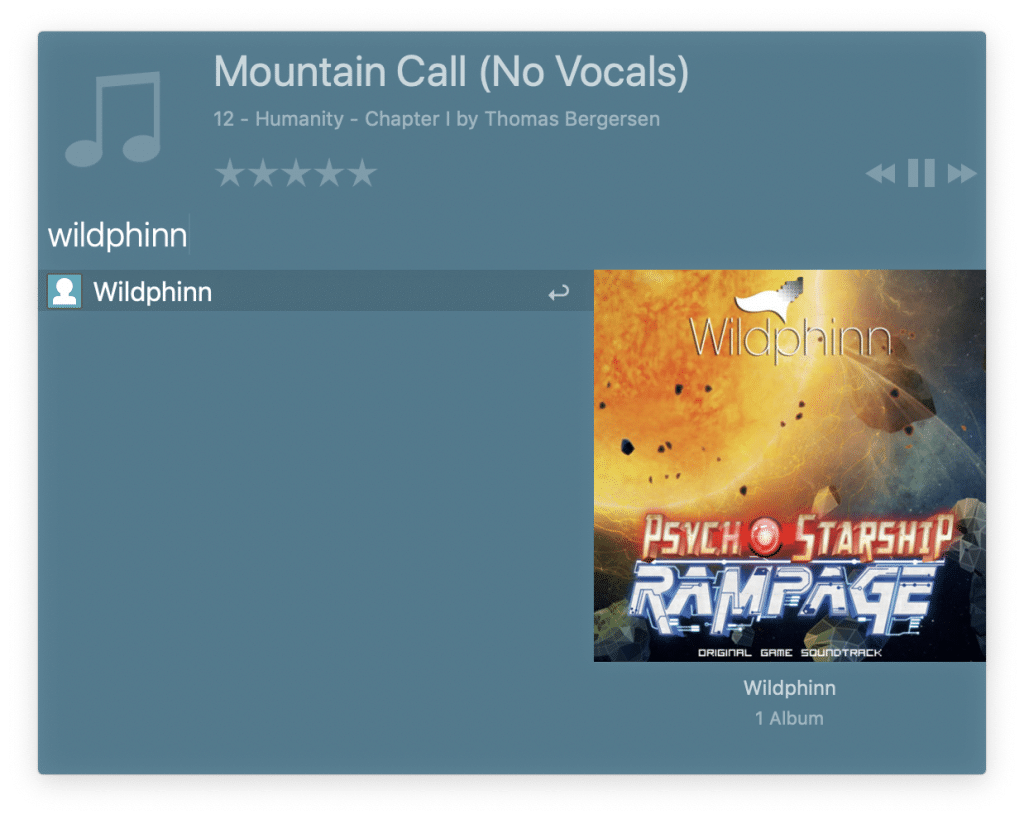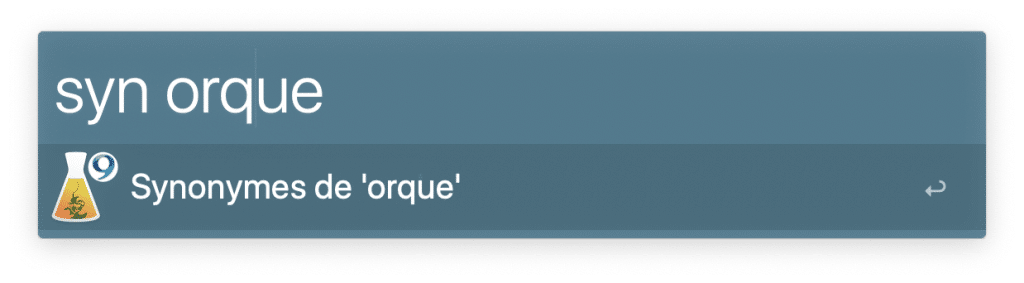Mise à jour de la playlist « Les Dieux sauvages »
… et ça me donne l’occasion de rappeler que, pour mon plaisir ou me remettre dans l’ambiance quand j’ai besoin de m’auto-coudepiéaucuter, ce truc existe et qu’il est librement accessible pourvu que vous ayez un abonnement à Apple Music.

J’aime bien me composer une bande originale fantasmée des bouquins ou des sagas. Une compilation de morceaux qui m’évoquent spécialement l’atmosphère de ce que je suis en train d’écrire, parce que parfois, on tombe sur exactement la bonne ambiance avec le bon état d’esprit. Je la mets à jour régulièrement, mais là, je m’en suis spécialement occupé notamment alors que je termine L’Héritage de l’Empire. Vous pouvez l’écouter ci-dessous avec votre compte ou, plus pratique, l’ajouter directement à votre bibliothèque si cela vous intrigue. La playlist suit globalement la progression de la série, depuis La Messagère du Ciel (I) jusqu’à la fin projetée pour La Succession des Âges (V) :
- La Messagère du Ciel : de Beyond the Veil à Eleven Eight
- Le Verrou du Fleuve : de Dark Star à Existence
- La Fureur de la Terre : de Point Zero à Empty Spaces
- L’Héritage de l’Empire : de Opposing Tides à Supernova
- La Succession des Âges : de Dragon’s Den à Love
- Générique de fin : de Passenger à Omnos (qui, incidemment, avait accompagné toute l’écriture de « Quelques grammes d’oubli sur la neige »).
Si cela vous amuse, voyons si nous entendons la même chose ! Quoi qu’il en soit, quand il y aura sur ce site les portails sur les univers (… un jour…), je détaillerai davantage ce qui correspond pour moi à tel ou tel chapitre.
(Et si ce genre d’expérience vous intéresse, il existe aussi une playlist pour « La Voie de la Main Gauche », l’univers de la trilogie Léviathan.)