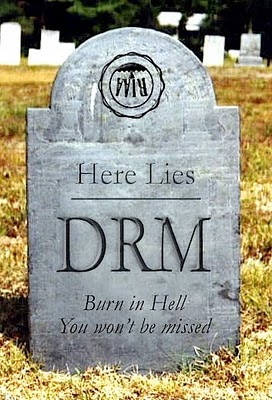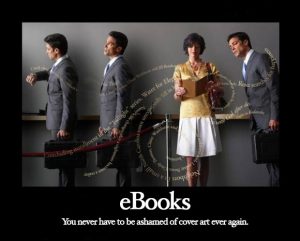Antichrist megastar
Auguste lectorat, je me trouve temporairement à Paris. Je ne fais nul secret de la passion et de l’admiration que je voue à la musique de Therion, le seul groupe de métal symphonique qui fasse vraiment du métal symphonique, c’est-à-dire du métal incorporant des éléments symphoniques au même plan dans la musique et composant effectivement le tout comme un ensemble, au lieu de placer des cordes en fond pour grossir le son des guitares. (Je n’ai rien contre le procédé, mais Therion ne joue simplement pas dans la même cour.)
Je vais m’abstenir d’une litanie de louanges sur un son parfaitement équilibré et une set list faite pour ravir les fans de longue date (l’album Vovin joué en entier – rhaa – quantité d’extraits de Secret of the Runes et Theli) pour partager la raison précise de cette tournée et pourquoi je tenais à ne pas rater ce passage au Trabendo. Christofer Johnsson, l’âme du groupe, avait annoncé cinq ans de pause dans les tournées pour se consacrer à une oeuvre majeure et rêve de longue date, la composition d’un opéra métal. Mais un vrai – avec histoire, scènes, mouvements, et non une de ces centaines de pseudo-opéra rock qui ne sont en réalité que des concepts albums vaguement compliqués sans rien de spécial qui les démarque du reste de la production (je suis désolé, mais je te regarde, Avantasia).
Probablement échaudé par les critiques très négatives reçues par Les Fleurs du Mal (et pourtant, quel album simplement jouissif), Johnsson est revenu sur sa décision pour tourner et tester les morceaux de l’opéra en salle. On en sait donc davantage sur le projet : il s’agira d’un homme, sauveur du monde puisqu’il a mis fin au crime, à la pauvreté dans le monde. Seulement, il décide de supprimer la religion également, la considérant comme responsable des maux du monde. Les clergés, refusant de se laisser faire, déclarent que cet homme est l’Antéchrist… et le monde sombre à nouveau dans le chaos des guerres. Un thème classique pour un groupe qui a fait ses débuts dans un death metal lorgnant vers le black, mais, connaissant Therion, on devine une intrigue qui sera tout sauf moralement tranchée, et on peut assurément compter dessus.
Trois extraits proposés : l’ouverture, un passage sur le choix du dieu auquel se vouer et un, chaotique, sur le naufrage du monde dans le conflit. L’avis est simple : c’est magnifique. On sent (notamment sur Sitra Ahra, encensé par la critique mais à mon sens desservi par une trop grande complexité et trop d’idées à la minute) que Johnsson aspirait clairement à cet espace et à cette envergure pour s’exprimer à son aise, et que le format « album » était devenu trop étroit pour lui. Ces extraits réalisent l’alchimie unique de Therion quand le groupe est à son sommet : une alliance de bonnes idées mélodiques, avec une concision et une simplicité trompeuses. Les mouvements sont clairs, le son puissant, et les atmosphères puissamment évocatrices. On se trouve à l’exact milieu entre l’efficacité sonore de Vovin ou de Lemuria / Sirius B et la maturité de composition et la complexité de Deggial ou Gothic Kabbalah. Pas de date de sortie annoncée pour cet opéra, mais une chose est sûre, cela promet d’être le chef-d’oeuvre de la formation ; l’attente sera longue. Plus aucun groupe ne pourra prétendre réaliser un « opéra métal » après cela sans fournir la même quantité de travail et présenter la même maturité musicale. Et franchement, ce n’est pas plus mal.