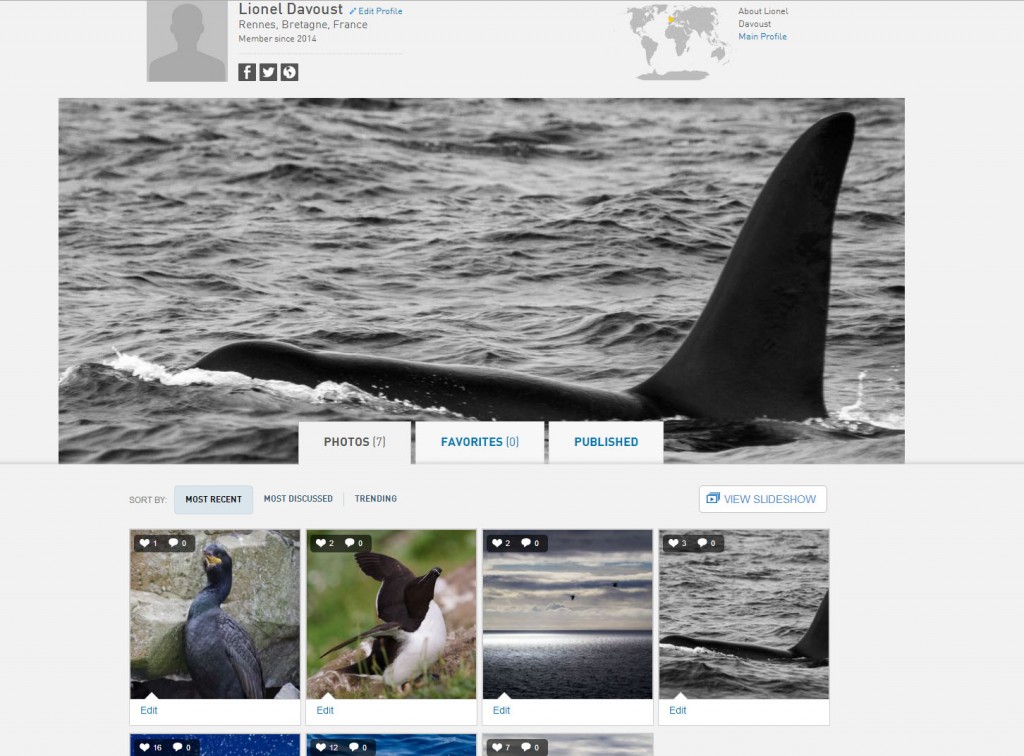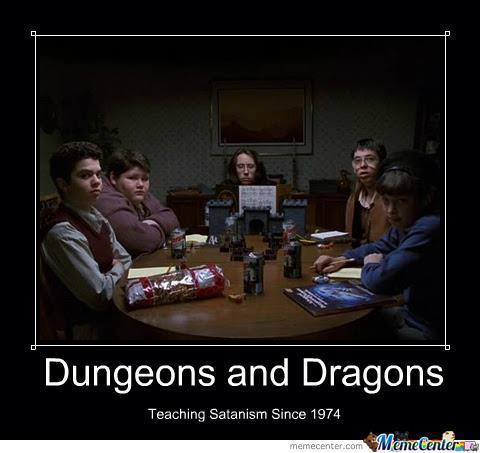Doutez de tout, y compris de ce que je vous dis
Celle-là, je l’ai évidemment piquée à Bouddha, hein. (Elle a longtemps été accrochée dans mon bureau.)
Petit article de mise au point général sur le blog et notamment ce qui s’y trouve concernant la technique d’écriture, afin de clarifier, voire répondre à certaines critiques qui peuvent revenir à mes oreilles. Ces articles sont toujours plus fréquentés, ce qui signifie que de nouveaux visiteurs découvrent toujours davantage l’endroit, ce qui me fait grand plaisir (bienvenue). En revanche, le problème d’un blog, c’est que la discussion se déroule sur la durée (en l’occurrence, depuis des années), et que le ton peut parfois surprendre les nouveaux arrivants, ou, tout simplement, les visiteurs occasionnels peuvent se méprendre sur le discours.
Cet endroit serait un livre, une introduction en clarifierait les présupposés, mais comme on est sur le web, je ne peux guère que consigner tout ça dans un article et m’efforcer de le rendre visible au maximum. Et je me suis rendu compte à ma grande surprise que je ne l’avais jamais vraiment fait ici.
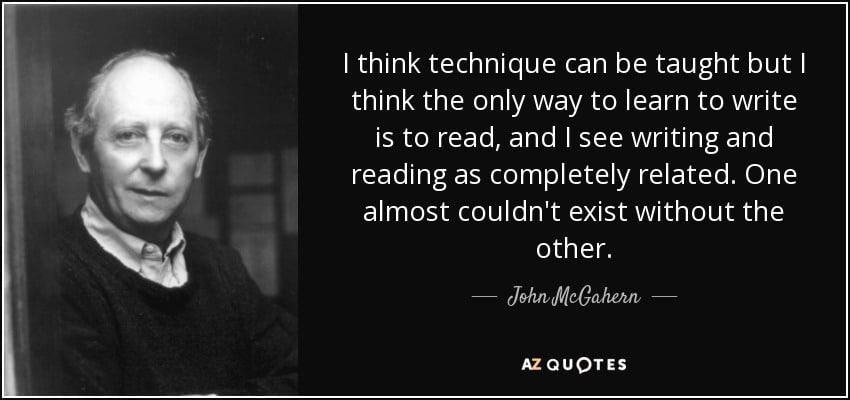
L’approche technique de l’écriture
Ce blog parle entre autres de la technique de l’écriture. Ces articles sont écrits dans une seule optique, qui s’enracine dans leur genèse.
Quand j’aspirais à faire mes premières armes professionnelles, autour de l’an 2000, je ne savais absolument pas par quel bout prendre le travail titanesque que représente un roman. Je pensais qu’il devait bien y avoir des bases techniques qu’il était possible d’acquérir (comme les principes de la perspective pour le dessin, ou de l’harmonie pour la musique, par exemple), et j’en ai trouvé, mais presque tout se trouvait en langue anglaise, rédigé par des Américains. J’ai ruminé, testé cette matière, qui a structuré mes idées, m’a guidé dans certaines voies plus ou moins fécondes, mais j’en ai toujours retiré des leçons (ne serait-ce que : ça ne marche pas pour moi, et j’ai compris pourquoi). Selon le principe que dans les métiers de création, on ne peut que rarement renvoyer l’ascenseur à ceux qui vous ont mis le pied à l’étrier (car ils restent toujours plus expérimentés que vous), on ne peut payer sa « dette karmique » qu’en s’efforçant de hisser ceux qui viennent après nous. (« You can never pay back, only pay forward. »)
Je m’efforce donc de proposer ici ce que j’aurais aimé trouver quand j’ai commencé.
Cependant, j’écris nécessairement de mon propre point de vue, et si je crois à une approche plutôt opérante de l’écriture (étant en cela orienté par mes propres présupposés d’écrivain structurel), elle n’est en aucune manière la seule. Le seul principe gouvernant la recherche de l’écriture, par lequel je commence toujours toute intervention, c’est : apprendre à écrire, c’est apprendre à se connaître. Il vaut mieux travailler dans le sens qui nous convient qu’à rebrousse-poil (duh). Sachant par ailleurs que cette cible – se connaître – est nécessairement mouvante ; avec le temps, avec les situations, avec les parcours personnels. La façon de travailler, ce que l’on souhaite aborder, traiter, suivre, les thèmes qui émergent, le rythme, tout cela est gouverné par un seul but : faites ce que vous voulez tant que vous obtenez un livre dont vous soyez content.
La technique ne fera pas de vous un bon écrivain, mais elle peut éventuellement vous garder d’être mauvais. La technique, à force de persévérance, pourra peut-être vous permettre de terminer une histoire ; en débordant sur le développement personnel et la psychologie, elle pourra peut-être vous aider à appréhender ce qu’il y a en vous pour faire apparaître vos motivations au grand jour ; elle peut peut-être simplement constituer un parcours d’introspection constant (c’est mon cas) ; mais elle ne garantit en rien que votre travail soit intéressant ni publiable d’entrée, et je ne vous fais certainement pas cette promesse. En revanche, elle peut peut-être vous éviter un certain nombre de pièges « connus », vous permettre de décoder les conventions acquises par des siècles d’évolution littéraire, prendre de la hauteur, et vous mettre le pied à l’étrier ne serait-ce qu’en vous proposant une direction à essayer, ce qui constitue une amélioration par rapport à pas de direction du tout. (Je reprends ici pas mal ce que j’ai déjà dit dans le tout premier épisode de Procrastination.)
Ce site est un blog
Ce site n’est pas un livre, un manuel, des tablettes gravées dans le marbre où Ma Parole A Force De Loi. C’est un blog, où je ne fais que proposer, diffuser, des réflexions parfois bien abouties (jusqu’à ce qu’elles changent), parfois moins. Parfois, c’est écrit un peu vite parce que je me suis promis de publier un article et je ne les relis pas autant qu’un roman ou une nouvelle (la création de fiction restant mon travail principal). Parfois, je suis au taquet, ravi d’une découverte ou d’un mécanisme que j’ai fini par élucider, et je meurs d’envie de partager mon enthousiasme avec le vaste monde. Cela peut sembler péremptoire. Je le répète : c’est un blog. C’est parfois émotionnel. Je n’écris pas un roman ni un manuel, je lance des os à ronger. Rongez-les – ou pas. Tout ce que je dis est écrit de mon point de vue, et le but, c’est de stimuler la réflexion chez les auteurs, notamment ceux qui se forment (parce que les pros ont déjà leurs outils, même si nous apprenons tous, je crois, toute notre vie).
Derrière toute affirmation, gardez à l’esprit que c’est toujours écrit par une personne avec une approche donnée, en construction perpétuelle comme l’est toujours la création, que les outils d’hier peuvent être dépassés demain (tout comme vous ne vous récitez pas l’alphabet en lisant ceci ; vous avez intégré l’écrit au point de devenir un réflexe), et qu’il serait juste un peu ridicule d’écrire à chaque fois « à mon avis personnel de moi-même et écrit simplement de mon point de vue dont voici l’historique [insérez ici cinquante pages biographiques] ». Je m’efforce de rester dans la proposition et non le finalisme, mais je compte bien conserver une grande liberté de ton (c’est une des raisons pour lesquelles, après environ dix ans de blogging, ça continue à m’amuser), et donc, ayez l’amabilité de faire la part des choses, le cas échéant, en vous rappelant l’esprit dans lequel c’est écrit, et gagnons du temps ensemble.
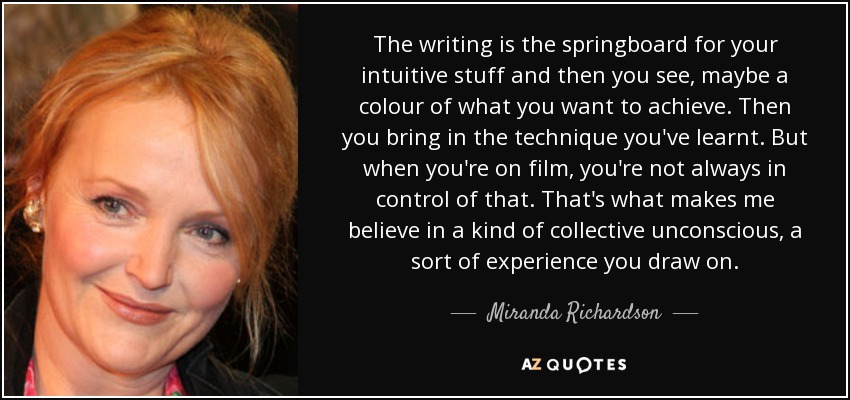
Rapport de transparence
Il m’est revenu que ce blog, en filigrane, n’était qu’une plate-forme pour me permettre de refourguer des activités commerciales, notamment des interventions. J’avoue que je le prends très mal. Je consacre beaucoup d’énergie à essayer de trouver des solutions équitables, win-win en bon langage de marketeux, qui permettent de proposer du contenu de qualité, tout en rentabilisant un peu l’endroit, sans conflit d’intérêt, sans entacher la confiance que nous avons établie. Car je pourrais consigner tous les jours, auguste lectorat, le temps que je passe ici au lieu de faire des choses qui me rapportent vraiment de l’argent, mais je ne vais pas entrer là-dedans ; sache simplement que c’est : trop.
Dans l’intérêt de la transparence, je vais donc dévoiler totalement ce que je retire, de près ou de loin, de ces articles et du blog en général.
Du plaisir et du karma. Alors déjà, oui, j’aime bien faire mumuse sur Internet. Et surtout, il y a l’aspect dette karmique cité plus haut : je n’ai pas le temps de lire les textes des jeunes auteurs, par exemple. Alors je m’efforce plutôt de proposer des choses, publiquement et librement, qui puissent toucher le plus grand nombre.
Une forme de fidélité. Ce n’est pas nouveau : c’est en toutes lettres dans la charte des commentaires. L’idée, c’est que si vous aimez ce que vous lisez ici, peut-être aurez-vous envie d’essayer un bouquin un jour, et ça me permet de continuer à faire tourner la boutique. Mais rien n’est obligatoire, je ne place aucun contenu derrière une inscription obligatoire à une liste de diffusion, un paywall ou toutes les pratiques modernes d’Internet. Je ne crois pas vous noyer de « hé j’ai sorti un nouveau livre RT plz plz plz » : je pars du principe que si je propose des trucs intéressants, qu’il m’intéresse aussi de traiter, vous resterez, et on sera tous contents (win-win). Je ne retiens personne, je n’oblige personne à venir lire ou commenter. J’observe une grande liberté de parole ici et ça comporte un double tranchant : vous pouvez aussi trouver que je suis un gros connard et jurer de ne jamais me lire. C’est la vie. Au moins, je m’efforce d’être sincère, y compris dans mes erreurs, et d’admettre quand j’ai tort, voire de m’en excuser (c’est arrivé plusieurs fois et ça se reproduira)1.
Le cas des interventions / du coaching etc. Je n’ai aucune structure pour réaliser des ateliers d’écriture, des interventions, des masterclasses. Je ne démarche pas pour cela, et je mets presque un point d’honneur à ne pas le faire, justement parce que je ne souhaite pas que le blog devienne une forme de « produit d’appel ». Pour cette raison, j’en fais moins d’une demi-douzaine par an. Ce n’est donc pas une source principale de revenu (même si elle existe et que je ne crache pas dessus). La façon dont le marché de ces interventions fonctionne, auguste lectorat, est le suivant : je pourrais très largement mieux gagner ma vie en laissant tomber le blog et en animant des ateliers dans ma ville. Je pourrais faire du coaching littéraire – certains collègues le font et gagnent leur vie avec (et très bien pour eux) – pour ma part, ainsi que je l’ai annoncé, je ne le fais pas, malgré des demandes régulières. Parce que je considère – mais c’est ma réponse, pas celle du voisin – que mon métier reste de créer. Je crois qu’on me demande des interventions parce que, tout simplement, je peux avoir une pensée construite sur l’écriture, et que cela intéresse des gens qui se trouvent être des commanditaires. Mais ça n’est en aucun cas calculé. Je te parle à toi, auguste lectorat, pas à des commanditaires.
Les liens affiliés. À travers la boîte à outils de l’écrivain, je touche une commission sur certaines commandes de logiciels recommandés. Je m’en suis longuement expliqué ici, mais le raisonnement est le suivant : j’écris de toute façon des tests de logiciels qui m’aident dans le boulot, donc, si vous êtes convaincu.e, autant que je touche quelques dollars au passage, ce qui ne vous coûte rien de plus, et qui, moi, m’aide à payer l’hébergement et à continuer à traiter ces outils en profondeur avec des trucs, astuces, cas d’usage et à légitimer un tant soit peu le temps déraisonnable que je passe ici. Win-win.
J’ai un site depuis plus de dix ans et il n’y JAMAIS eu de bouton « donation », JAMAIS eu de pubs (et là aussi, des offres, j’en reçois). Je voudrais monétiser cet endroit, oh, je pourrais parfaitement le faire, surtout à plus de 10 000 lectures uniques par mois. Mais ça n’est pas l’esprit du lieu, je ne veux pas que ça le devienne, ce n’est pas ce que je veux créer et c’est pour ça que globalement, on s’y sent tous à peu près bien, enfin, je crois.
Je ne vous retiens pas
Ce n’est pas dit de manière agressive. Je l’ai dit, je le répète, tout ceci est subjectif, et lisez toujours les articles, tout particulièrement sur la technique littéraire, avec le grain of salt – la mesure de prudence – qu’il est, de toute façon, toujours de bon aloi d’observer dans ce genre de situation. La majorité de ceux qui vous disent qu’il y a une seule et unique manière de faire veulent vous vendre quelque chose. Qu’il soit dit ici et une fois pour toutes que s’il y a « une » manière de faire, c’est pour moi seulement (et encore, ça évolue avec le temps) ; que je pense qu’un certain nombre de conseils peuvent bénéficier à un grand nombre, mais il y a toujours le contre-exemple, et c’est peut-être vous. Très bien. À vous de voir, vous êtes vous, j’en sais rien, moi.
Tout ce que vous devez faire, c’est : tester, essayer, garder une attitude proactive vis-à-vis de votre pratique créatrice. N’importe quoi tant qu’il y a un résultat dont vous êtes content. C’est la seule chose à faire. Ou pas de résultat, même, si vous ne voulez pas de résultat, vous faites ce que vous voulez, hein.
Bref, le reste n’est que des moyens. Les moyens ne sont que des indications, envers lesquels il s’agit de conserver le juste mélange, propre à chacun, d’assurance (« non, ça ne me va pas, à moi ») et d’humilité (« je ne sais pas, alors je vais écouter avant de juger »).
Le stylo est, et a toujours été, dans votre camp.
Bonne écriture !
- Il y a certains articles notamment politiques, avec le recul des années, dont je regrette la forme. Ils sont toujours dans les archives, parce que je ne vais pas vous raconter combien je suis lisse et parfait, né hier soir, avec tout le passif et les leçons données par l’existence. ↩

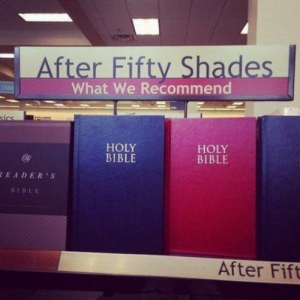
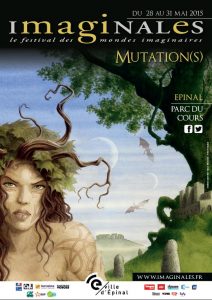
 C’est une question qui revient souvent, et qui paraît simple en apparence, mais à laquelle on trouve soit des réponses très vagues (« mets-toi à écrire, travaille, fais des efforts, mange macrobiotique ») soit très commerciales (« facile ! achète mes cours par correspondance qui feront de toi un auteur de best-seller, seulement 99,99 € ! »). Il faudrait donc tenter de taper entre les deux :
C’est une question qui revient souvent, et qui paraît simple en apparence, mais à laquelle on trouve soit des réponses très vagues (« mets-toi à écrire, travaille, fais des efforts, mange macrobiotique ») soit très commerciales (« facile ! achète mes cours par correspondance qui feront de toi un auteur de best-seller, seulement 99,99 € ! »). Il faudrait donc tenter de taper entre les deux :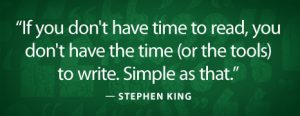 Apprendre seul
Apprendre seul