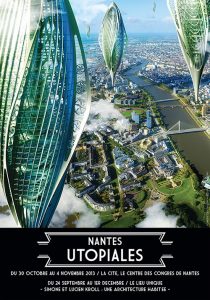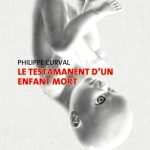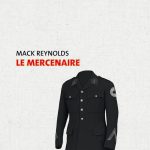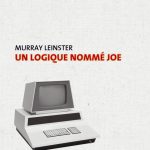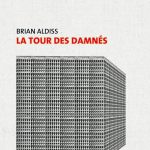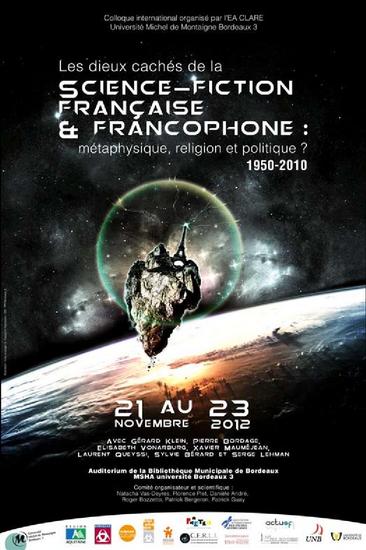Continuités des hypothèses imaginaires (une idée en l’air)
Alors que je propose à l’université d’Angers, entre autres, quelques cours sur la traduction de l’imaginaire, et que je me trouve donc à définir rapidement les trois grands genres (SF, fantasy, fantastique) de la façon classique, une vague idée me vient (précisément sous la douche) (le lendemain matin, hein, pas pendant le cours) sur la façon dont nous les définissons et sur les insuffisances soulevées moult fois par ces définitions (car très hybrides et en évolution constante). En tant qu’ancien scientifique, j’aime bien épingler des papillons, et donc des catégories si possibles moins mouvantes, si l’on tient vraiment à catégoriser (ce qui est d’une utilité peut-être discutable, mais jouons le jeu). Peut-être que quelqu’un a déjà eu cette idée, auquel cas je suis trop génial : j’ai réinventé l’eau chaude, et tout seul, s’il vous plaît. Circulez.
Or doncques. D’abord, on convient que les trois grands courants ont une histoire assez différente et suscitent des impressions distinctes, ce qui entraîne leur séparation. Habituellement (et rapidement), on les distingue ainsi :
- La SF se fonde sur une extrapolation rationnelle à présupposé scientifique ;
- La fantasy propose une hypothèse imaginaire rationnelle, mais à présupposé magique ;
- Le fantastique met en scène le glissement de la réalité consensuelle vers l’irrationnel.
Voir la classique parabole du chat de Denis Guiot.
Ce qui m’ennuie à mesure que j’expose ces définitions, c’est :
- Leur hybridation en tous sens (le cas le plus prégnant étant la fantasy urbaine, qui propose un glissement – fantastique – vers un univers merveilleux – fantasy, mais aussi la science-fantasy, etc.) ;
- La cousinade manifeste entre SF et fantasy (présupposés rationnels, même si dans des règles différentes), qui fait dire à Terry Pratchett « La SF, c’est de la fantasy avec des boulons », alors que le fantastique procède d’une toute autre démarche. Pour trois genres censément apparentés – au sein de l’imaginaire -, c’est un peu bancal.
Du coup, je te livre en pâture, auguste lectorat, cette autre proposition de grille, fondée sur la constatation générale et partagée que l’imaginaire emploie un biais métaphorique (le « pas de côté ») pour parler de notre réalité présente (voir aussi la bulle de présent exposée par Sylvie Denis dans sa préface à l’anthologie Escales 2001).
Il me semble que la SF tire sa pertinence d’une extrapolation en rapport avec la recherche scientifique et les tendances du monde actuel, quand la fantasy la tire d’une extrapolation des symboles de nos cultures. De façon grossière, la SF relève plutôt de l’expérience de pensée (prospective) quand la fantasy relève plutôt de l’expérience initiatique (mythologie). Par conséquent, peut-être pourrait-on simplement définir les genres par la projection, ou non, d’un potentiel cheminement raisonnable entre notre réalité consensuelle et celle du monde imaginaire dépeint. En termes biologiques, la question est : puis-je tracer un cheminement évolutif vraisemblable entre la réalité telle qu’on la connaît aujourd’hui et le monde fictif qui m’est dépeint ?
Si l’on peut projeter un tel cheminement (via extrapolation technique, politique, sociale, scientifique…), c’est de la science-fiction.
Si c’est impossible (en raison d’un présupposé possédant sa propre cohérence, mais qui viole ouvertement la réalité telle qu’on la considère globalement – il s’agit de magie, donc, ce qui postule une rupture de continuité évolutive), c’est de la fantasy.
Le fantastique recouvre toujours la même idée de glissement.
Les trois catégories appartiennent maintenant à leur propre dynamique, qui se définissent toutes, cependant, à partir de l’idée d’évolution. Le monde décrit dans la fiction résulte d’un cheminement visible à partir du présent, tracé dans la continuité (SF) ; ou bien il y a rupture (fantasy) ; ou bien le propos même est ce cheminement de l’actuel vers un ailleurs (fantastique). Plus (tellement) d’innombrables justifications malaisées pour classer les hybridations : la fantasy urbaine appartient bien à la fantasy dans cette optique (ce que nous pressentons tous), puisque son propos consiste à dépeindre ce monde imaginaire merveilleux, même si les protagonistes le découvrent au fil du récit ; elle se place en rupture par rapport au contemporain conventionnel (les elfes, dans la réalité consensuelle, n’existent pas). Elle se fixe souvent elle-même comme mission, d’ailleurs, de réenchanter le monde, et elle emploie le merveilleux pour ce faire.
C’est peut-être une idée stupide et facilement démontable, mais un blog (je le rappelle quand même au vu de récentes échauffourées) représente un carnet de notes et non un essai documenté, et c’est aussi à cela qu’il sert dans le cas présent – jeter des embryons d’idées dans la grande marmite de l’inconscient collectif au cas où elles seraient pertinentes pour celui-ci.
Sortez les torches.