Le festival Imaginales annonce la rémunération complète de toutes les interventions en 2019
Les choses évoluent ! Le mouvement #payetonauteur s’est lancé cette année quand Livre Paris a annoncé ne pas rémunérer les interventions des écrivains – décision sur laquelle l’organisation est finalement revenue après une conséquente levée de boucliers des auteurs (et de leurs représentant.e.s !) mais aussi des lecteurs (merci !), à la satisfaction générale.
Or, les Imaginales viennent tout juste d’annoncer qu’à partir de 2019, toutes les interventions seront rémunérées sur le festival. Elles le sont déjà en partie – l’évolution est progressive, nécessitée par des adaptations de modèle et de budget, dans le cadre d’un événement qui conserve, rappelons-le, sa totale gratuité. Je ne vais pas paraphraser l’annonce qui développe en grand détail la situation et le raisonnement. Je suis simplement ravi de voir un festival auquel je suis très attaché s’engager résolument dans cette direction, tout en conservant sa mission d’événement culturel avec une entrée toujours gratuite, et je pense qu’il faut saluer l’équipe organisatrice, la ville qui soutient énormément le festival, ainsi que les sponsors et les pouvoirs publics qui rendent tout cela possible.
On aura l’occasion de reparler de la question des rémunérations (et des modèles qui se dessinent) dimanche matin à 10h au Magic Salon Perdu pour une table ronde avec Samantha Bailly, Sara Doke, Stéphanie Nicot, Stéphane Wieser et moi-même.
Pour ma part, j’aime beaucoup lire dans l’annonce des Imaginales que les droits d’auteur doivent rester la première source de revenu des auteurs. C’est ce à quoi j’aspire en effet ; je considère que le livre, et par extension sa chaîne, représentent mon cœur de métier.

 Sur
Sur  Je reçois de loin en loin quelques questions sur le métier de la traduction, et je voudrais remercier Marielle Carosio, qui termine son parcours en métiers du livre, pour les siennes, excellentes et qui m’ont donné l’occasion de faire ce que j’avais envie de faire depuis un moment : proposer un petit tour d’horizon de là où j’en suis arrivé dans mes réflexions sur le métier sur son approche et sa technique, pour servir, eh bien, à qui cela pourra servir, surtout à un moment où je traduis de moins en moins et viens de mettre un terme à la majorité de mes interventions extérieures en M2 à la fac d’Angers (on peut pas tout faire, ma bonne dame. Je vous parle beaucoup sur ce blog, ma bonne dame, il faudra quand même que je vous rencontre un jour.)
Je reçois de loin en loin quelques questions sur le métier de la traduction, et je voudrais remercier Marielle Carosio, qui termine son parcours en métiers du livre, pour les siennes, excellentes et qui m’ont donné l’occasion de faire ce que j’avais envie de faire depuis un moment : proposer un petit tour d’horizon de là où j’en suis arrivé dans mes réflexions sur le métier sur son approche et sa technique, pour servir, eh bien, à qui cela pourra servir, surtout à un moment où je traduis de moins en moins et viens de mettre un terme à la majorité de mes interventions extérieures en M2 à la fac d’Angers (on peut pas tout faire, ma bonne dame. Je vous parle beaucoup sur ce blog, ma bonne dame, il faudra quand même que je vous rencontre un jour.) Splendide nouvelle, et merci à toutes les organisations et acteurs (avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, présidée par Samantha Bailly, en fer de lance) : Livre Paris a annoncé que toutes les interventions, ateliers ET tables rondes, seront bel et bien rémunérées. Merci également à l’événement d’avoir su réviser sa position et comprendre la situation ! Cela valait bien un petit mot. Voir
Splendide nouvelle, et merci à toutes les organisations et acteurs (avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, présidée par Samantha Bailly, en fer de lance) : Livre Paris a annoncé que toutes les interventions, ateliers ET tables rondes, seront bel et bien rémunérées. Merci également à l’événement d’avoir su réviser sa position et comprendre la situation ! Cela valait bien un petit mot. Voir 

 Oyez, oyez, braves gens. (Ça marche mieux que ois, ois, auguste lectorat.) Oyez mes aventures fantastiques, car en vérité je vous le dis : je suis passé de l’autre côté du miroir. J’ai vu l’avenir du futur, et j’ai la réponse à toutes les questions que vous vous posez. Que deviendra le marché du livre ? J’ai mis un pied dans les terres qui s’étendent par-delà le présent, et je le sais.
Oyez, oyez, braves gens. (Ça marche mieux que ois, ois, auguste lectorat.) Oyez mes aventures fantastiques, car en vérité je vous le dis : je suis passé de l’autre côté du miroir. J’ai vu l’avenir du futur, et j’ai la réponse à toutes les questions que vous vous posez. Que deviendra le marché du livre ? J’ai mis un pied dans les terres qui s’étendent par-delà le présent, et je le sais.

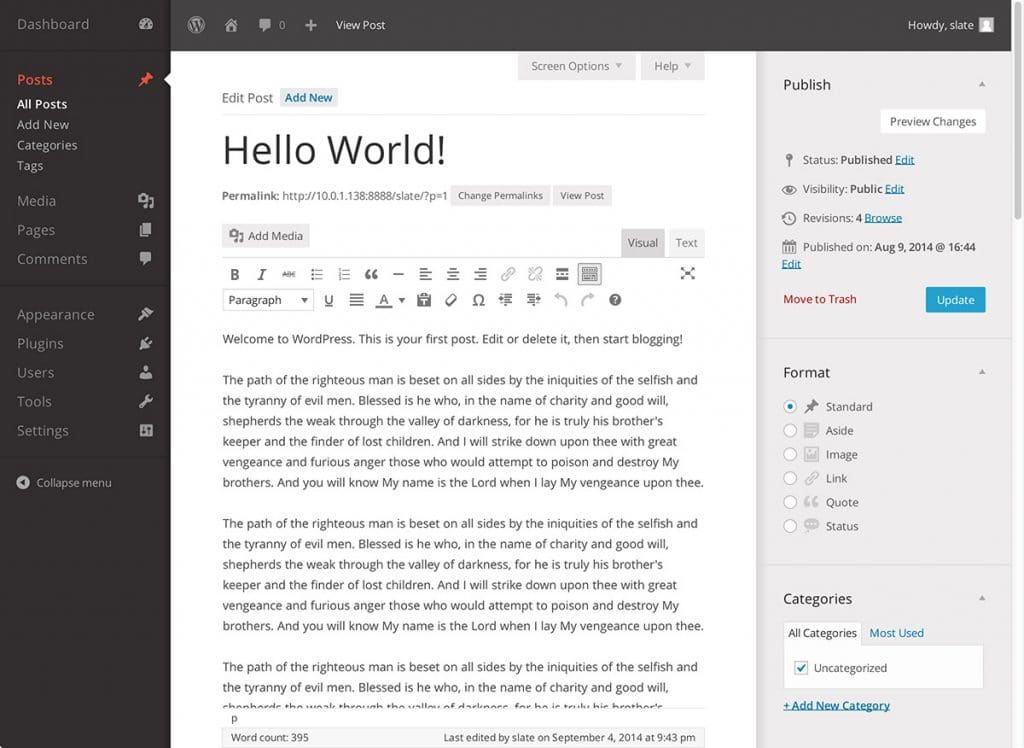

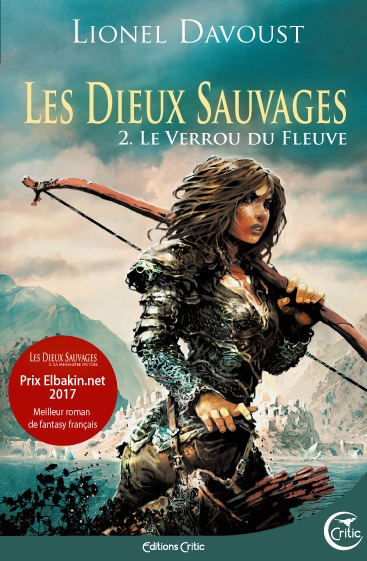
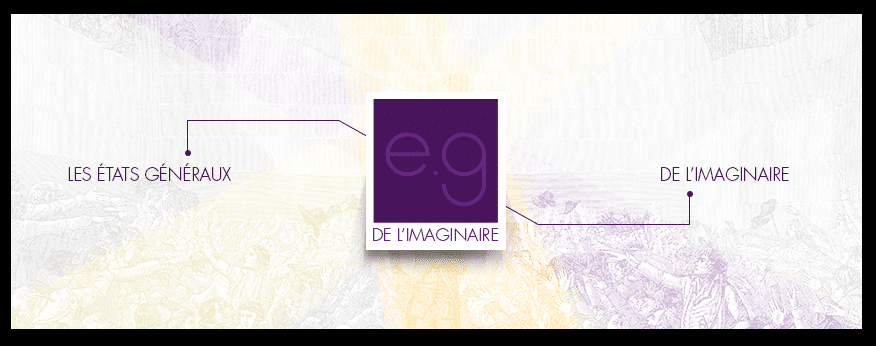

 Beaucoup de tristesse de voir les éditions
Beaucoup de tristesse de voir les éditions 
